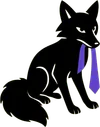Marx était-il stylé ? Entretien avec Vincent Berthelier

Vincent Berthelier est spécialiste des rapport entre style, littérature et politique . Il est l’auteur d’un ouvrage remarqué sur Le Style réactionnaire ainsi que d’une contribution sur la littérature et l’extrême droite dans l’ouvrage collectif de l’Institut La Boétie Extrême droite : la résistible ascension. Dans Le style de Marx (Éditions sociales, 2025) il s’intéresse à plein de points qui résonnent avec des questions que nous nous posons à Frustration : l’usage de l’ironie, les “portraits au vitriol”, la parole des “premiers concernés”, être rigoureux tout en restant accessible le plus largement… On a pu discuter de tout cela avec lui.
Pourquoi le style de Marx ?
On lit souvent Marx comme un théoricien de l’économie ou de la politique. Pourquoi était-il important, ou en tout cas intéressant, selon toi, de prendre son œuvre par le biais du style ?
Je lisais Marx depuis longtemps. Il y avait ce séminaire de lecture de Marx à l’ENS, auquel j’assistais, mais moi j’étais en littérature : je n’étais ni philosophe, ni économiste, ni historien. Je n’appartenais pas à une discipline canonique qui mobilise habituellement le marxisme. À partir de ce séminaire, on a lancé un autre espace de travail, davantage orienté vers la critique et la théorie littéraires. Ce n’était pas un séminaire stricto sensu marxiste, mais un lieu où l’on pensait la littérature à partir d’un point de vue matérialiste, historicisé, contextualisé, en tenant compte des déterminismes sociaux et économiques. De mon côté, j’avais travaillé en thèse sur la question du style, sur un corpus très différent au départ, puisque c’était l’extrême droite. Ce travail est devenu ensuite Le Style réactionnaire, publié chez Amsterdam. Et donc, par effet de contrepoint, je me suis dit que cette réflexion sur le style pouvait aussi s’appliquer à l’autre versant politique.

Il y a eu ensuite un élément très concret : une éditrice des Éditions sociales, Marina Simonin, est tombée sur un vieux livre de Ludovica Silva, Le style littéraire de Marx, écrit en espagnol. La question s’est posée de le traduire (la maison d’édition Verso le faisait en anglais) et elle m’a demandé ce que j’en pensais. Le sujet était passionnant, mais le livre assez daté. J’ai proposé soit une postface conséquente, soit, finalement, d’en faire un livre à part entière. C’est comme ça que le projet est né. Ça, c’est la cause matérielle.
Ensuite, sur l’intérêt spécifique de cette approche pour Marx : évidemment, ce n’est pas l’angle le plus immédiatement politique. Mais étudier le style d’un auteur, quel qu’il soit, c’est toujours se situer au point de jonction entre le politique et l’individuel. Le style, c’est à la fois un répertoire de procédés déjà là – donc quelque chose de collectif, lié à des tendances d’époque, à des traditions littéraires parfois très anciennes – et en même temps quelque chose d’individuel : la manière dont un auteur se réapproprie ces formes, les ressaisit, parfois pour exprimer une pensée nouvelle, qui peut elle-même être collective ou traversée par une sociabilité très particulière. En cours de rédaction, je me suis évidemment demandé quel pouvait être le sens politique de tout cela. À mon avis, il se joue précisément dans cette articulation entre l’individuel et le collectif. J’essaie de la travailler à plusieurs endroits du livre, et surtout dans la conclusion, en réfléchissant à ce que l’étude du style permet de penser d’une subjectivité révolutionnaire. Qu’est-ce que ça veut dire, par exemple, d’être un intellectuel prussien, mais à la marge de la Prusse, loin de Berlin, dans sa partie occidentale ; d’être pris dans la tourmente du XIXᵉ siècle, avec tout un ensemble d’aspirations, et de traverser ensuite l’Europe – la France, l’Angleterre – à la recherche d’une liberté très concrète : de mouvement, d’expression, de publication ? Je ne pense pas que réfléchir au style de Marx soit, en soi, une question brûlante. Il ne faut pas se faire d’illusions là-dessus. Mais je crois que c’est un bon moyen de réfléchir à notre propre subjectivité quand on est engagé, quand on est traversé par un désir révolutionnaire, quand on est pris dans les contradictions de l’histoire.

Le style, chez Marx, prend différentes formes d’expression, et ces formes renvoient à la fois à des tâches politiques distinctes et à des problèmes politiques difficiles à résoudre. Je ne suis évidemment pas le premier à poser ces questions : elles ont déjà été abordées par d’autres critiques. Mon objectif était aussi d’en proposer une synthèse. Mais surtout, il s’agissait d’entrer non pas seulement dans la pensée de Marx – sur laquelle il existe des bibliothèques entières – mais dans ce que son style dessine comme trajectoire d’engagement. Et ça, je pense que ça peut nous parler assez directement. Prenons un exemple : la contradiction liée à la position sociale de Marx. Il vient d’une classe moyenne supérieure, il est fils d’un avocat libéral ; ce n’est pas un bourgeois au sens strict, contrairement à Engels (ndlr : le cofondateur du marxisme avec Marx), mais sa situation est ambiguë. Son père, juif converti, a subi l’antisémitisme et une certaine marginalisation. Marx n’est pas prolétaire, mais il a connu des moments de grande précarité. Au fond, sa situation ressemble à celle de beaucoup d’étudiants, de profs précaires – un vivier sociologique important de militants aujourd’hui. Des gens qui se retrouvent dans une position contradictoire : par exemple, quand tu vas à la campagne, que tu croises des gens qui gagnent très peu d’argent, avec des modes de vie et des références très éloignés des tiens, mais que tu sais qu’il y a malgré tout des intérêts économiques et politiques communs à défendre. Comment tu gères ça ? Est-ce que tu parles « pour » ? Est-ce que tu te tais au nom de la légitimité des autres, au risque de mettre de côté ce que tu as toi intégré ?
Chez Marx, ces tensions s’expriment de manière discrète, sans prendre la forme d’une culpabilité infinie – qui me semble être aujourd’hui une modalité dominante chez les militants. Cette idée qu’on serait toujours déjà un mauvais dominateur, coupable de « violence symbolique ». Il y a sans doute un surinvestissement de cette notion aujourd’hui. Marx propose, à sa manière, des pistes de résolution autour de la question du porte-parolat, de la théorisation de situations sociales que l’on ne vit pas soi-même. Ce sont des enjeux très contemporains, qui peuvent être pensés grâce à Marx, non pas en réactivant directement ses grands concepts (exploitation, mode de production capitaliste, etc.), mais en se ressaisissant de sa position de penseur engagé, de sa situation concrète.
Prenons un exemple concret. Le Manifeste du Parti communiste est l’un des textes politiques les plus lus au monde. Est-ce que ça a avoir avec sa puissance stylistique ?
D’une manière générale, sur la question du style, je suis assez déflationniste. C’est-à-dire que je pense qu’il est très important de ne pas lui accorder une importance excessive. Le style ne peut pas être décorrélé du reste : du contenu, du contexte, des conditions matérielles de production et de circulation des textes. Il ne s’agit donc pas d’étudier le style pour le style, comme une pure création formelle coupée du monde social. On peut – et on doit – étudier le style historiquement et politiquement, mais sans lui attribuer des vertus qu’il n’a pas.

Prenons Le Manifeste du Parti communiste. C’est un texte au rayonnement international absolument colossal, inutile de le démontrer. Mais si l’on cherche à comprendre pourquoi il a été aussi connu, les causes sont multiples et ne pèsent pas toutes du même poids. La première question, très concrète, c’est celle des intermédiaires : qui a permis que le texte soit publié, puis republié ? Car n’importe quel livre est publié une première fois ; ce qui fait la différence, c’est ce qui lui permet de circuler, de ressortir, d’être réédité. De ce point de vue-là, le fait que Marx ait été érigé en figure théorique centrale, presque en prophète, par les bolcheviques (ndlr : des communistes russes, dirigés par Lénine, qui ont pris le pouvoir lors de la Révolution d’Octobre 1917) , et que ceux-ci aient réussi une révolution dans un pays immense, doté d’un potentiel économique considérable, pèse évidemment bien plus lourd que le style du texte. On peut faire une expérience de pensée : imaginons que Marx n’ait pas eu le temps de terminer Le Manifeste et qu’on soit resté avec le Catéchisme communiste d’Engels, ce texte dialogué au style très différent. Les idées y sont globalement les mêmes, puisqu’il s’agit d’un travail commun et de la ligne politique qu’ils cherchent à impulser au sein de la Ligue des Justes (ndlr : organisation révolutionnaire au XIXᵉ siècle, principalement active à Paris et en Allemagne), puis de la Ligue des communistes (ndlr : une organisation politique internationale de travailleurs au XIXᵉ siècle, issue de la Ligue des Justes) . Rien n’interdit de penser que ce texte-là aurait pu circuler et passer à la postérité. Son style est pourtant complètement différent. Dans Le Manifeste, on reconnaît immédiatement la patte de Marx : cette tendance à faire parler différentes instances, ce côté marionnettiste, l’ironie permanente… Des choses que l’on trouve beaucoup moins chez Engels, pourtant aussi bon écrivain et narrateur lorsqu’il se fait historien.
Si l’on regarde les livres qui ont eu une diffusion mondiale massive – la Bible, le Coran, le Petit Livre rouge – on voit bien que leur succès ne repose pas sur une supposée lisibilité stylistique. La Bible et le Coran sont, pour beaucoup de lecteurs, des textes difficiles, parfois presque illisibles. Le Petit Livre rouge est un objet très étrange : on y trouve des envolées lyriques issues de paraboles chinoises, mêlées à des extraits de discours de congrès dont on ne sait pas toujours quoi faire – et pourtant il a été lu, récité, étudié de manière quasi religieuse. Lorsqu’un texte est porté par une force politique massive, il peut devenir un étendard quel que soit son format. C’est en ce sens que je me dis déflationniste.

Cela dit, on peut reposer la question autrement, du côté de l’usage vivant des textes. Là, le style redevient important. En quoi un texte comme Le Manifeste peut-il fonctionner comme un répertoire de slogans, ou comme un texte dans lequel des communautés politiques se reconnaissent ? À ce niveau-là, il y a bien des éléments stylistiques qui produisent des effets. Si l’on reprend le Petit Livre rouge, par exemple, certaines métaphores – le « tigre en papier », etc. – constituent de véritables lieux d’élaboration stylistique, qui appellent la reprise, la citation, la réappropriation. Et là, effectivement, le style joue.
Bientôt “Le Style de Mao” ?
(Rires.) Ce n’est pas le plan, mais c’est très intéressant. En ce moment, je travaille sur les questions de circulation internationale des textes, et aussi sur l’histoire des formes. Le cas de Mao est fascinant. Il écrivait de la poésie classique à la manière des Song (ndlr : une dynastie qui a régné en Chine entre 960 et 1279) , donc des formes qui ont mille ans. Un style ancien, très archaïque. C’est un peu comme si Mélenchon écrivait aujourd’hui des poèmes à la manière de Villon (ndlr : poète français de la fin du Moyen Âge), voire des épopées façon La Chanson de Roland (ndlr : poème épique de la fin XIe siècle) : il faut imaginer le degré d’archaïsme. Mao écrivait en vers très réguliers, et même ses adversaires politiques ne remettaient pas en cause la qualité formelle de ses poèmes.

Ce qui est amusant, c’est la réception en France. Quand ces textes ont été traduits, les situationnistes et les anti-maoïstes disaient qu’ils étaient nuls. Mais ce n’est pas du tout ça : c’est simplement très difficile d’accès. C’est un peu comme la poésie des Tang (ndlr : poèmes datant de la dynastie Tang, 618-907) : quand on ne connaît pas le système, ça paraît imbittable. Avec Mao,on a affaire à un leader communiste qui défend l’éducation des masses, la simplification du chinois, le remplacement du chinois littéraire par le chinois parlé – et qui, parallèlement, écrit dans un chinois hyper archaïque, sous des formes très élitistes. C’est un objet profondément contradictoire, et c’est pour ça que c’est passionnant.
Puisqu’on parle de la circulation, est-ce que les ouvriers du XIXᵉ siècle lisaient vraiment Marx dans le texte ou plutôt indirectement via des journaux et des cercles de lecture ? Est-ce que la pensée de Marx auprès d’eux se diffusaient via la lecture des textes ou plutôt par l’oral ?
De manière générale, les ouvriers du XIXᵉ siècle ne lisaient pas beaucoup Marx. Le véritable triomphe de Marx, c’est surtout après la Révolution d’Octobre (ndlr : révolution en Russie qui porte les bolcheviks au pouvoir en 1917). Cela dit, ce n’est pas entièrement faux non plus de dire qu’il est lu de son vivant : il est très présent, par exemple, dans les cercles dirigeants de la social-démocratie allemande.

La circulation de ses idées se fait donc, mais de manière très inégale. On peut penser à Jules Guesde (ndlr : journaliste et homme politique français, fondateur du socialisme marxiste en France), par exemple, qui lit Marx, le rencontre, et avec lequel Marx collabore pour la rédaction de l’introduction du programme du Parti ouvrier français (POF). Mais est-ce que ce programme a réellement été lu par les ouvriers ? Rien n’est moins sûr. D’ailleurs, aujourd’hui encore, qui lit les programmes politiques ?
Si l’on regarde la période 1848–1870, on peut dire qu’en réalité, presque personne ne lit Marx. Ceux qui le lisent le font surtout à travers le New York Daily Tribune (ndlr : un des journaux les plus influents du XIXᵉ siècle aux États-Unis), où il publie énormément : c’est probablement là que ses textes sont le plus lus de son vivant. À côté de ça, il publie très peu de livres. Contribution à la critique de l’économie politique est un ouvrage savant, et Marx s’attend d’ailleurs à être reçu comme économiste parmi les économistes, avec une réception scientifique. C’est aussi vrai pour Le Capital. Il y a le cas particulier de l’édition française du Capital et sa préface où Marx explique comment lire le livre pour les ouvriers français. Il y a donc cette attente d’un lectorat ouvrier. Mais, en réalité, Marx lui-même semble plutôt penser son travail comme une version solide, rigoureuse, destinée à être ensuite vulgarisée par d’autres. Marcello Musto le montre bien dans sa biographie des dernières années de Marx : tout en préparant la suite du Capital et ses différentes éditions, Marx surveille de très près les versions vulgarisées qui circulent – souvent sans son autorisation, sous forme de piratages. Le scénario est presque toujours le même : il lit, dit d’abord « c’est nul, il y a des erreurs partout », puis finit par conclure « bon, ce n’est quand même pas si mal ».

Du côté des ouvriers, l’accès direct aux textes de Marx reste très limité. Il y a des cours qu’il donne dans des associations ouvrières, à Paris ou à Bruxelles, mais ils sont fréquentés par un petit nombre d’ouvriers et d’ouvrières, souvent des artisans allemands. Là, la transmission est essentiellement orale.
Il faut aussi prendre en compte la circulation des textes au sein de l’Internationale (ndlr : une organisation mondiale qui regroupait des partis politiques socialistes, sociaux-démocrates et travaillistes). Salaires, prix et profit, par exemple, est issu d’une discussion avec un ouvrier. Même si l’Internationale compte des intellectuels bourgeois et petits-bourgeois comme Marx et Engels, il s’agit bien d’une organisation ouvrière, y compris sociologiquement. Il y a donc une audience ouvrière, mais elle est restreinte et très située.

Si l’on résume : les « gros livres » de Marx ne sont quasiment jamais lus directement par les ouvriers, sauf par une toute petite minorité. Il existe toutefois des figures d’ouvriers très éduqués – typographes, autodidactes, militants – un peu à la manière de Proudhon (ndlr : un penseur français considéré comme le père de l’anarchisme) , qui prennent le temps de se former, écrivent parfois leurs mémoires, et qui, dans les cercles militants, entendent forcément parler de Marx. Ceux-là peuvent le lire. Mais il faut se représenter les conditions matérielles : Le Capital, imprimé en gothique, six cents pages… Même après la première traduction française, en 1875, l’accès reste difficile. Quant au Manifeste, il faut du temps avant qu’il soit retraduit et largement republié. Beaucoup de ces textes ne deviennent vraiment disponibles qu’après la Commune (ndlr : un gouvernement révolutionnaire des travailleurs qui a brièvement dirigé Paris en 1871), au moment où la figure de Marx émerge dans le débat public et médiatique.
C’est quoi le rapport de Marx à la littérature ? Est-ce qu’il s’inscrit dans un héritage particulier au niveau du style, en tant qu’écrivain ?
Marx a beaucoup d’héritages littéraires. Déjà, ses premiers textes, ce sont des poèmes. Ils ont été traduits il y a moins de dix ans par L’Insomniaque, une petite maison anarchiste de Montreuil. Ce sont des poèmes très romantiques, de jeunesse, échevelés, pleins de fougue juvénile.

Mais Marx n’est pas seulement un poète de jeunesse. Il est aussi un lecteur boulimique. Il connaît à la fois les classiques – Don Quichotte, Goethe, Shakespeare, Balzac – et la littérature contemporaine de son époque, des best-sellers comme Dumas ou Eugène Sue (ndlr : écrivain français du XIXᵉ siècle, célèbre notamment pour Les Mystères de Paris). Victor Hugo, il connaît de loin : il lui reconnaît son talent mais le juge politiquement idiot. On trouve une allusion à Quasimodo dans ses écrits, donc il a sans doute lu Notre-Dame de Paris à Paris. Il lit aussi le pamphlet de Hugo sur la Commune.
Pour autant, Marx ne s’inscrit pas dans un courant littéraire particulier. Les partis communistes ont longtemps présenté Marx et Engels comme partisans du réalisme, opposés au romantisme « dégénéré » bourgeois. Mais ce réalisme est une construction a posteriori. À l’époque où Balzac meurt, le réalisme littéraire est à peine en train de se forger, et dans les textes de Marx, les références réalistes balzaciennes ne sont pas si centrales. Ses références principales sont plutôt Shakespeare et Don Quichotte, et il est amateur des grands romans pré-modernes, cette forme de roman foisonnant et extravagant. Dire qu’il est partisan du réalisme littéraire comme doctrine est exagéré, même s’il est vrai que Marx n’est pas un partisan de l’art pour l’art : il considère que la littérature peut et doit réfléchir le monde, ce qui était une position courante à l’époque, et pas du tout spécifique au réalisme ou au marxisme.
Marx, écrivain plurilingue
Marx écrit en allemand, en français et en anglais, et lit couramment de nombreuses langues. Est-ce que ce plurilinguisme est important pour comprendre son écriture et sa politique ?
Oui, clairement : le plurilinguisme est important pour comprendre à la fois l’écriture de Marx et sa politique.

Pour l’écriture, d’abord. Quand on lit les textes les plus spontanés dans la langue originale – les lettres, les brouillons… – on tombe sur quelque chose de très frappant : une prose étrange, qui mélange en permanence plusieurs langues. Marx passe de l’allemand au français, glisse des citations latines, parfois de l’anglais. On a parlé à ce propos de « babélisme » – l’expression n’est pas de moi – et c’est un trait dont il faut absolument tenir compte si l’on veut parler du style de Marx.
À partir de là, la question devient : pourquoi écrit-il comme ça ? Et c’est là qu’on arrive, indirectement, à la politique. Ce mélange de langues ne s’explique pas seulement par le nomadisme de Marx – un phénomène assez courant chez les militants du XIXᵉ siècle. Il y a aussi quelque chose de plus social, presque ludique : un côté cuistre, potache, lié à l’habitus (ndlr : l’ensemble des dispositions qui façonnent nos façons de penser, d’agir et de percevoir le monde) de l’étudiant en philosophie. Marx est docteur en philosophie, ce qui, à l’époque, est extrêmement rare. Il appartient à un monde savant où l’on se fait des clins d’œil érudits, des blagues de « geeks » de bibliothèque, en jouant avec les langues. D’autant plus que cette maîtrise est souvent livresque : quand Marx arrive à Paris, par exemple, il a du mal à parler français et fréquente surtout des Allemands. Mais ce qui est frappant, c’est que la place des langues évolue en fonction de sa vie. Lorsqu’il arrive à Londres, l’anglais s’intègre progressivement à ce fatras linguistique, alors qu’il était presque absent jusque-là. Et ces langues ont des connotations politiques. Écrire en allemand avec du latin, c’est afficher une culture savante ; y ajouter du français, c’est signaler un rapport à la France, à l’héritage de la Révolution, à un certain libéralisme politique. Quand Marx commence à utiliser l’anglais, il adopte aussi la langue de l’économie politique – une langue qu’il ne maîtrisait pas au départ, puisqu’il lit d’abord Smith (ndlr : un économiste écossais qui fonde la pensée libérale moderne avec sa théorie du marché) et Ricardo (ndlr : un économiste classique qui a théorisé la valeur du travail et l’avantage comparatif) en traduction française.

C’est là que le plurilinguisme devient pleinement politique. Marx apprend des langues pour comprendre les situations concrètes. Il se met à l’espagnol pour suivre une crise révolutionnaire en Espagne ; il apprend le russe lorsqu’il commence à percevoir que quelque chose d’important s’y joue, après avoir longtemps tenu ce pays à distance par russophobie. Il fait venir des livres sur les communes agraires russes, simplement pour s’informer à la source, à une époque où il n’y a ni internet ni circulation fluide de l’information. Pouvoir accéder directement aux textes, sans intermédiaires, est un privilège politique majeur.
Cela lui permet aussi d’occuper une position centrale dans un vaste réseau de correspondants : militants, responsables politiques, agitateurs de toute l’Europe. Même si le pouvoir réel de l’Internationale reste limité, cette capacité à dialoguer dans plusieurs langues joue un rôle crucial dans la diffusion de ses idées. Marx devient une sorte de cheville ouvrière – sans mauvais jeu de mots – de cet espace international.

Il y a chez lui une tension intéressante : à la fois un internationalisme affirmé et une manière très XIXᵉ siècle de parler des peuples, de leurs « caractères » : l’esprit français, anglais, allemand, etc. Cela ne le gêne pas particulièrement. Mais en même temps, parce qu’il a traversé ces contextes, il sait très bien que les situations politiques ne sont pas les mêmes selon les pays, et que les programmes doivent être adaptés. Cette vision de surplomb, plurinationale, le protège d’un certain dogmatisme. C’est d’ailleurs assez ironique, quand on sait que Marx est souvent accusé de rigidité doctrinale. En réalité, il ne cesse de rappeler que l’analyse doit être articulée aux situations concrètes, et que les programmes politiques n’ont pas vocation à être identiques partout. On sait à quel point, plus tard, certaines traditions issues de la Troisième Internationale (ndlr : aussi appelée Komintern, une organisation créée en 1919 pour coordonner les partis communistes à l’échelle mondiale) ou du trotskysme ont souffert de l’application mécanique de formules figées à des contextes où elles ne fonctionnaient pas. De ce point de vue, le plurilinguisme de Marx n’est pas un détail biographique : c’est une condition centrale de sa pratique politique.
Le renversement : écrire contre l’ordre établi
Tu consacres un chapitre entier à une figure de style apparemment technique : l’antimétabole. Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il s’agit et pourquoi cette utilisation par Marx ?
L’antimétabole, c’est une figure de style très simple : une répétition inversée. On prend une formule A–B, et on la retourne en B–A. L’exemple le plus célèbre, c’est La Philosophie de la misère de Proudhon qui devient, chez Marx, Misère de la philosophie, en 1847.

Comme toutes les figures de style, l’antimétabole est transhistorique. On en trouve chez Platon, chez Hérodote (ndlr : historien grec antique), dans la poésie chinoise classique : c’est une structure extrêmement simple, une forme de répétition. En elle-même, cette figure n’a donc aucune signification politique ou philosophique. Mais la question intéressante, c’est : pourquoi Marx en fait-il un usage aussi massif ?
D’un point de vue stylistique, il faut rester prudent. On peut adopter une lecture « déflationniste » : Marx et Engels utilisent beaucoup l’antimétabole, mais ils ne sont pas les seuls. Les Jeunes Hégéliens (ndlr : un groupe de penseurs allemands du XIXᵉ siècle qui critiquaient la religion et la société à partir de la philosophie de Hegel) y recourent aussi abondamment. On peut donc y voir une mode d’écriture, un marqueur de groupe, une forme de reconnaissance interne – comme il en existe constamment dans l’histoire littéraire et militante. On pourrait faire un parallèle contemporain : certaines métaphores circulent aujourd’hui dans les milieux militants, finissent par devenir des tics de langage, des signaux d’appartenance, parfois au prix d’un appauvrissement de leur sens. Autrement dit, toutes les formes stylistiques ne sont pas nécessairement le produit d’une nécessité philosophique profonde ; elles peuvent relever de dynamiques de réseau, d’imitation, de circulation.

Cela dit, l’objectif du chapitre était justement de ne pas s’arrêter à cette explication. Si l’antimétabole est peut-être en partie une mode, qu’est-ce qui permet malgré tout de lui attribuer une signification plus profonde chez Marx ?
D’abord, il y a des origines philosophiques : hégéliennes, puis feuerbachiennes. Chez Feuerbach (ndlr : un philosophe allemand qui critique la religion), par exemple, l’antimétabole accompagne le geste de renversement de l’idéalisme en matérialisme. Ce n’est pas exactement la dialectique au sens strict – c’est-à-dire l’idée que la réalité est contradictoire et avance par le dépassement de ses propres contradictions – mais plutôt un geste de retournement conceptuel. Chez Marx, cette figure apparaît de manière inégale selon les textes. Elle est très présente dans Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte, un texte central à la fois pour le matérialisme historique appliqué et pour la philosophie politique. Là, l’antimétabole se prête particulièrement bien à l’écriture polémique : Marx décrit un monde renversé, absurde – un « crétin » qui prend le pouvoir – et la figure stylistique épouse ce renversement. Elle donne une forme linguistique au sentiment d’un monde à l’envers. Mais, en même temps, Marx ne s’arrête pas à ce premier niveau. Le cœur de son analyse consiste justement à dépasser l’apparence du monde renversé pour en expliquer les causes matérielles et les intérêts de classe qui s’y jouent.

En réalité, la dialectique stylistique de Marx se trouve plutôt ailleurs : dans le mouvement conceptuel du Capital, où l’on passe de la marchandise à la monnaie, puis au capital – un enchaînement de catégories qui mime le mouvement réel du système. C’est là que se joue la dialectique, davantage que dans les formules de retournement. Il reste un moment où l’antimétabole prend une portée politique et poétique forte : la fin du livre I du Capital, et « l’expropriation des expropriateurs ».
La transformation de la propriété privée morcelée en propriété privée capitaliste est naturellement un processus plus difficile que la transformation de la propriété capitaliste en propriété sociale. Dans le premier cas, il s’agissait de l’expropriation de la masse du peuple par un petit nombre d’usurpateurs ; ici, il s’agit de l’expropriation d’un petit nombre d’usurpateurs par la masse du peuple.
Ce passage fonctionne comme une conclusion provisoire, un épilogue, un morceau de bravoure. Marx y concentre une énergie polémique et révolutionnaire dans une structure de répétition inversée. Le fait qu’il place cette formule à la fin d’un ouvrage dense, aride, technique, n’est pas anodin. Il sait que les lecteurs lisent souvent l’introduction et la conclusion, et que ces passages peuvent circuler comme slogans, comme archives, comme ressources militantes. Cette page cite d’ailleurs Le Manifeste du Parti communiste, qui est encore peu disponible à l’époque. Cette antimétabole inscrit dans la langue l’idée même de renversement social.
Une écriture de combat
Tu montres que Marx est souvent polémiste, prend un style parfois frontal, voire carrément violent. Tu montres aussi que chez Marx la polémique, ses portraits au vitriol, ne sont pas gratuits. Quelle fonction ont-ils ?
Elles répondent à une logique précise : Marx cherche à dépasser l’individu pour atteindre le type, le social, le structurel.
Dans certains contextes particuliers, comme la Commune de Paris, il tient compte des qualités individuelles : qui sera un bon chef ? On retrouve ici des portraits personnalisés, comme ceux de Thiers (ndlr : un homme politique français du XIXᵉ siècle, président de la République et responsable de la répression de la Commune de Paris) ou ses commentaires sur Blanqui (ndlr : un révolutionnaire français du XIXᵉ siècle, partisan d’une insurrection immédiate pour instaurer le socialisme) – il pensait que s’il avait été là il aurait pu tenir l’insurrection plus longtemps. Mais dans l’ensemble, l’individu est analysé comme représentatif d’un type, et ces types permettent de saisir des réalités sociales plus générales. C’est un geste littéraire, présent depuis Don Quichotte jusqu’aux personnages de Balzac ou de Molière : passer de l’individuel au général pour comprendre le monde.

Marx utilise beaucoup les antonomases : transformer un nom propre en nom commun, de l’individu au général. Par exemple, dans L’Idéologie allemande, Sancho Panza (ndlr : le fidèle et naïf écuyer de Don Quichotte) devient un type universel appliqué à Max Stirner (ndlr : un philosophe allemand qui défend l’individualisme radical et la liberté personnelle contre toute autorité). Cette méthode relie le plaisir littéraire de Marx à une fonction analytique : il construit des types qui incarnent des structures sociales et politiques.
La polémique a aussi un rôle très concret dans la vie militante. On peut citer le pamphlet monumental contre Carl Vogt dans les années 1860. Vogt, socialiste et scientifique, qui était aussi un mouchard de Napoléon III (ndlr : l’empereur des Français de 1852 à 1870, connu pour son régime autoritaire) avait calomnié Marx. Marx rassemble tous les documents, démonte point par point les écrits de Vogt, utilise des antonomases et des types caricaturaux de la littérature pour le ridiculiser. Sur le plan théorique, l’intérêt est limité. Mais sur le plan militant, c’est une défense procédurière de sa réputation. Le même habitus procédurier se retrouve ailleurs, par exemple dans Les Révélations sur le procès des communistes de Cologne ou Le Chevalier de la noble conscience face à August Willich (ndlr : militaire et révolutionnaire allemand du XIXᵉ siècle, engagé dans les révolutions de 1848 et plus tard général dans l’armée de l’Union pendant la guerre de Sécession). Dans ces textes, Marx défend ses camarades et expose la mauvaise foi et les manipulations de ses adversaires. C’est un geste de militant face à l’État autoritaire : pour survivre dans un contexte répressif, il faut réunir les preuves, monter les dossiers, jouer sur le formalisme, tout en sachant que c’est souvent vain. Cette polémique a également une fonction pour la postérité et le capital militant : démonter la réputation de l’autre permet de consolider la sienne, de laisser une trace écrite pour l’histoire, et de marquer la légitimité d’un positionnement au sein du mouvement. Marx peut ainsi combiner un plaisir littéraire de « démontage » avec une stratégie politique et militante concrète.
Tu insistes sur le fait que l’ironie de Marx est « manifeste », jamais élitiste. Est-ce que tu peux nous expliquer cette distinction que tu fais ?
L’ironie est un concept complexe. C’est une notion très ancienne : on la trouve déjà dans l’Antiquité, chez Platon, avec l’ironie socratique. Socrate dit des choses qui donnent l’impression qu’il se moque, mais ce n’est pas forcément de l’antiphrase – il ne dit pas l’inverse de ce qu’il pense, il le dit de manière détournée. De la même façon, dès l’Antiquité, des commentateurs réfléchissent à l’ironie du Christ. Donc on a affaire à une notion très ancienne, avec des strates successives de sens.
À cela s’ajoute l’ironie romantique allemande, qu’on trouve notamment chez Goethe, et que Hegel (ndlr : un philosophe allemand qui pense l’histoire et les idées comme un mouvement dialectique) tente d’analyser : une ironie propre à la modernité, liée à la relativisation des valeurs, au fait qu’un sujet moderne a conscience de la pluralité des systèmes de pensée, et peut donc mettre à distance toutes les certitudes.
Si on veut une définition minimale, on peut dire que l’ironie consiste, pour l’énonciateur, à mettre une distance par rapport à ce qu’il dit. Cette distance peut prendre plusieurs formes : dire le contraire, parler sur un certain mode, reprendre des paroles existantes sans qu’on sache à quel point on y adhère, ou encore jouer sur des degrés d’accord ambigus. C’est d’ailleurs pour ça que l’ironie est souvent suspecte dans les milieux militants : on lui reproche de ne jamais abolir complètement le premier degré, de laisser planer un doute sur la position réelle de celui qui parle. Et comme cette distance doit être interprétée par le lecteur ou l’auditeur, l’ironie implique un travail de décryptage. Cela peut produire des malentendus, voire un effet d’exclusion – certains comprennent, d’autres non – et créer une forme d’incertitude interprétative permanente.
Or, Marx ne correspond pas à ce modèle. Ce qu’on observe chez lui, ce n’est pas une ironie qui dissimule le fond de la pensée. Marx ne cherche pas à multiplier les niveaux de sens pour laisser le lecteur dans une suspension infinie. Ce n’est pas un écrivain qui cultive l’ambiguïté ou la prolifération interprétative. Au contraire, son ironie est liée à son activité de polémiste et de propagandiste. Il a des positions philosophiques et politiques très nettes, et ses conclusions restent toujours lisibles. L’ironie lui sert à railler l’adversaire.
Dans le livre, je le compare à d’autres figures de l’ironie, notamment Heinrich Heine (ndlr : poète et écrivain allemand du XIXᵉ siècle, célèbre pour son ironie, son lyrisme et sa critique politique), que Marx lisait. Heine, lui, entretient une forme d’incertitude sur ses valeurs et ses positions : on ne sait jamais complètement ce qu’il pense, et ce flou peut être lu comme une ironie moderne, post-romantique, fondée sur la relativisation des valeurs. Ce n’est pas du tout le cas chez Marx. C’est pour ça que je situe son ironie plutôt du côté de Voltaire ou de Brecht (ndlr : dramaturge allemand), que de Flaubert ou de Heine. Chez Voltaire ou Brecht, l’ironie reste orientée, polémique, dirigée contre des cibles précises. Alors que chez Flaubert – et encore plus du côté de certaines formes d’humour – on peut aller vers une relativisation plus large, où les valeurs elles-mêmes sont mises en suspens, voire où l’auteur se prend lui-même pour cible (à travers la figure de Frédéric Moreau). Il existe tout un spectre entre ironie et humour, avec des formes très différentes, et il me semblait intéressant de situer Marx dans cette cartographie.
Faire parler les autres
Tu dis que Marx a une écriture “polyphonique”. Qu’est-ce que cela signifie ? Et quelle fonction politique cela a ?
La polyphonie, ça veut dire qu’il y a plusieurs voix. Mais c’est une notion assez plastique. Si on la prend au sens strict, un roman polyphonique, c’est par exemple un roman à la Faulkner (ndlr : un écrivain américain du XXᵉ siècle, connu pour ses romans sur le Sud des États-Unis et sa technique narrative complexe), avec plusieurs narrateurs, plusieurs points de vue. Si on élargit, la polyphonie, c’est simplement le fait qu’une œuvre produite par un seul auteur fasse entendre plusieurs voix.

La notion a pris une dimension politique notamment avec Bakhtine (ndlr : un historien et théoricien russe de la littérature), qui s’est intéressé aux romans de Dostoïevski. Pour lui, ces romans sont polyphoniques parce qu’ils font entendre plusieurs voix idéologiques qui se confrontent sans qu’une seule domine. À côté de Bakhtine, il y a Volochinov, un grand linguiste soviétique, qui défend l’idée que tout discours social est traversé par des voix autres : aucun énoncé n’est purement individuel, toute parole est chargée de social. Ces théories ont circulé massivement dans les années 1960, notamment en France, où elles ont été reprises dans des contextes très divers : études littéraires, linguistique, psychanalyse lacanienne, marxisme critique. Il y avait derrière ça l’idée que le sujet n’est pas un bloc unifié – quand je parle, “ça parle” à travers moi, on entend plusieurs strates de discours sociaux. Et politiquement, cette notion a aussi servi à dé-dogmatiser certaines lectures marxistes de la littérature. Plutôt que de réduire une œuvre à un simple reflet des structures économiques, on pouvait dire : la sphère esthétique est traversée par des idéologies, mais elle les met aussi à distance, elle les fait dialoguer. La polyphonie permettait donc de conserver une grille marxiste tout en évitant un réductionnisme trop rigide. Avec le temps, la notion s’est un peu dégradée, parfois associée à une sorte de pluralisme démocratique mou : la littérature comme espace de coexistence pacifique des voix. On le voit par exemple dans certaines formes contemporaines de roman policier très polyphonique, mais politiquement assez centristes (comme le montre l’essai de Lucie Amir).
Appliquée à Marx, la polyphonie pose un problème intéressant. D’abord, il faut rappeler un point : même si Marx fait parler plusieurs voix, c’est toujours lui le chef d’orchestre. Il peut mettre en scène des bourgeois, des ouvriers, des inspecteurs, mais au final, c’est lui qui cadre et dirige la confrontation. Et c’est frappant dans Le Capital. Marx cite énormément : ses adversaires, des économistes, des discours ouvriers, des inspecteurs de fabrique. Il fait parler des figures typiques : “l’ouvrier”, “le bourgeois”, des personnages abstraits qui incarnent des positions de classe. Il raisonne par types plutôt que par individus singuliers. En même temps, Le Capital est un objet assez étrange : c’est un ouvrage scientifique, extrêmement sourcé, rigoureux, qui adopte des protocoles d’écriture très modernes pour l’époque; mais c’est aussi un livre fait de collages, de citations, de superpositions de voix. Ce n’est pas un traité classique du XIXᵉ siècle. Et pourtant, ce n’est pas non plus un texte postmoderne (ndlr : une attitude critique qui remet en cause les grands récits et les vérités universelles) : la voix théorique principale n’est jamais dissoute. Un moment clé pour comprendre cette polyphonie, c’est le chapitre 8 du Capital, sur la journée de travail. Marx y décrit des situations absolument horribles, et notamment l’exploitation d’enfants de 6 ou 8 ans, leur abrutissement cognitif ainsi que leur destruction physique et morale. C’est un chapitre profondément chargé moralement. Or Marx, par principe, ne veut pas faire de morale. Il veut analyser l’histoire comme une confrontation de forces sociales et refuse le mélodrame de certains socialistes de son temps. Mais en même temps, il ne peut pas ne pas en parler. C’est ce qui motive la colère, l’indignation, l’engagement politique. Alors comment faire ? La solution formelle qu’il trouve, c’est la délégation de la voix morale. Plutôt que de s’indigner directement, il fait parler d’autres et en particulier des inspecteurs de fabrique, qui occupent une position sociale intermédiaire. Ces voix expriment l’indignation à sa place. Marx s’efface momentanément, tout en intégrant cette indignation dans son dispositif théorique. C’est une polyphonie qui lui permet d’assumer politiquement l’émotion sans compromettre sa posture scientifique.
Il y a un autre enjeu : faire parler les ouvriers. Marx est confronté à un problème : l’ouvrier “réel” n’est pas spontanément marxiste. En France il est souvent proudhonien, en Angleterre chartiste (ndlr : militant du mouvement ouvrier britannique du XIXᵉ siècle réclamant le suffrage universel et des réformes démocratiques), en Allemagne parfois millénariste chrétien. Et même quand il est révolutionnaire, sa formulation peut être jugée par Marx théoriquement “limitée”. Alors que faire ? Donner directement la parole aux ouvriers, au risque que cela contredise sa théorie ? Ou fabriquer une figure idéale de l’ouvrier, qui exprime la conscience de classe telle que Marx la conçoit ? Dans Le Capital, Marx oscille entre ces options : parfois il fait parler un ouvrier abstrait, typique ; parfois il cite des ouvriers réels, des discours chartistes. Et plus tard, il tente une autre solution avec son questionnaire ouvrier (en français et en anglais) – notamment étudié par Juliette Farjat : un dispositif qui donne la parole aux travailleurs, mais dans un cadre structuré par sa théorie. C’est pour lui une forme de compromis entre autonomie ouvrière et exigence théorique.
Sur le sujet de faire parler les autres, tu utilises toi même des épigraphes (des courtes citations) en début de chapitre ?
À la base, c’est un truc que j’avais commencé un peu par hasard : je notais des petites citations en me disant “tiens, ça ferait bien dans le bouquin”. Au début il y en avait trois ou quatre, puis je me suis dit qu’il faudrait qu’il y ait ce genre de citations tout au long du livre. Ça correspondait aussi à un moment de mes lectures. J’étais dans une phase de poésie chinoise, en parallèle de mon travail sur Marx. Et je me suis dit : tiens, il y a peut-être quelque chose à faire avec ça. J’espère que ça ne fait pas trop cuistre, genre “j’étale ma science” — mais c’était vraiment lié à mes centres d’intérêt du moment.
En lisant Marx, notamment Le Manifeste, il y a ce passage très célèbre où il explique que le capital étend les rapports capitalistes au monde entier et qu’il faut faire émerger une littérature mondiale. C’est un passage énormément commenté, surtout chez les littéraires aujourd’hui : la notion de littérature mondiale prend de plus en plus d’ampleur – et ça m’intéresse beaucoup. Je me suis donc mis à chercher des citations un peu partout, en me disant : moi, je viens des études littéraires françaises, ma culture est très européenne, très eurocentrée. Et en même temps, je me posais la question : comment penser l’internationalisme depuis ce point de vue ? Comment faire coexister l’esprit de cosmopolitisme propre à la littérature – cette ouverture au monde – avec une réflexion politique sur l’internationalisme ? J’en parle aussi parce que j’avais lu dans Frustration un article sur la manière de penser l’internationalisme aujourd’hui sans tomber dans une forme de campisme un peu débile. Je ne pense pas que les études littéraires puissent répondre directement à cette question, mais elles peuvent l’enrichir.
C’est une question qui devrait davantage traverser les études littéraires. Quand on fait des lettres, on se retrouve très vite dans un cadre franco-centré, mais en réalité, même quand on fait de la littérature française, on ne lit jamais uniquement de la littérature française. On n’étudie pas Baudelaire sans s’intéresser un peu à Edgar Poe, on n’étudie pas Claude Simon (ndlr : 1913‑2005 est un écrivain français, associé au courant du Nouveau Roman, prix Nobel de littérature en 1985) sans penser à Faulkner : tous les auteurs sont pris dans des réseaux d’influences internationales. Et en même temps, je voyais que chez les doctorants en lettres, on finit souvent notre thèse sans avoir jamais lu une ligne de littérature indienne, chinoise ou arabe – des littératures millénaires qu’on ignore complètement. Donc l’idée des épigraphes, c’était aussi de faire de petites incursions dans des littératures non européennes (pas seulement, d’ailleurs : il y a aussi le poète latin Horace, par exemple). Mais l’idée générale, c’était d’imaginer une sorte d’anthologie possible des lectures d’un Marx du XXᵉ ou du XXIᵉ siècle : qu’est-ce qu’il aurait pu lire ? Qu’est-ce qu’il aurait pu apprécier ?
Il y a donc de la poésie russe (pas communiste, d’ailleurs), de la poésie arabe classique, un écho à une anecdote racontée par Marcello Musto, où Marx arrive en Algérie et on lui raconte une petite fable locale sur un savant qui ne sait pas nager. Il y a le Japon, la Chine, des lieux importants de l’élaboration du marxisme au XXᵉ siècle. À travers ces épigraphes, j’ai essayé de dessiner un écho discret à l’idée de littérature mondiale chez Marx, et d’ouvrir le texte à un horizon plus large. C’est une forme volontairement non explicitée, allusive, un peu obscure parfois et aussi un plaisir d’écriture.
Un entretien réalisé par Rob Grams le 22 janvier 2026.
Photomontage par Farton Bink.

Rob Grams
Rédacteur en chef adjoint