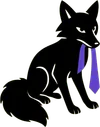C’est quoi être « internationaliste » aujourd’hui ?

L’internationalisme apparaît souvent comme une notion abstraite : on s’en revendique volontiers mais on ne sait pas trop comment le mettre réellement en place, ni des fois ce qu’il signifie vraiment. Depuis deux ans, toutefois, avec le génocide à Gaza, celui-ci a repris un sens plus évident. Mais on l’a vu aussi via la solidarité avec les victimes d’autres guerres : résistance ukrainienne à l’invasion russe, bombardements israéliens contre le Liban, massacres génocidaires au Soudan… D’une manière générale, alors que nos vies sont déterminées par “l’international”, pas seulement en raison des guerres, mais du fait d’un capitalisme entièrement globalisé, reposant sur des relations Nord-Sud coloniales ou néocoloniales, et produisant une catastrophe climatique elle aussi mondiale, notre approche politique reste bien souvent très “nationale” et l’idée d’aborder l’internationalisme ressemble à une volonté humanitaire morale très louable mais un peu hors-sol. Le fait qu’en France, on nous fasse croire que le seul vrai moment politique qui nous permettrait d’agir serait l’élection présidentielle, une élection par définition intrinsèquement “nationale”, n’aide pas beaucoup. En mars 2025 sortait aux éditions Zones un “manifeste internationaliste” intitulé Révolutions de notre temps, rédigé par une soixantaine de révolutionnaires à travers le monde, réuni par le réseau Les Peuples Veulent. Celui-ci permet de donner des pistes. Regardons ça de plus près.
L’internationalisme permet de tirer des leçons de ce qui s’est passé ailleurs
L’un des objectifs du livre, qui met en commun des expériences révolutionnaires de nombreux pays, est aussi celui de l’internationalisme : apprendre des autres, de ce qui a fonctionné comme de ce qui ne fonctionne pas. Ce Manifeste internationaliste propose donc de regarder en face la défaite, non pas pour s’y complaire, non pas pour déprimer, mais au contraire pour la voir comme “la naissance d’un mouvement mondial de révolte” et “préparer les victoires à venir”. Des multiples tentatives révolutionnaires insurrectionnelles et révolutionnaires à travers le monde depuis 2011, quelques points flagrants ressortent.
La contre-révolution se nourrit des crises internationales
L’un des constats de Révolutions de notre temps est que la “contre-révolution”, c’est-à-dire la fascisation, se structure, s’institutionnalise et se perfectionne au fil des crises internationales, qu’elles soient militaires, sanitaires ou écologiques.
Le cas syrien, sur lequel l’ouvrage revient à plusieurs reprises, en offre une illustration. La « loi d’urgence », en vigueur pendant plus de quarante ans avant la révolution de 2011, était officiellement justifiée par la menace militaire israélienne. En réalité, elle a surtout servi d’outil central à la répression de toute opposition intérieure, jusqu’aux massacres et bombardements de populations civiles. L’état d’exception n’y apparaît pas comme une suspension temporaire du droit, mais comme un mode ordinaire de gouvernement.

Les militants et militantes montrent que cette logique ne se limite pas aux régimes ouvertement autoritaires. L’usage de l’état d’urgence comme justification légale de l’absence d’État de droit s’est progressivement généralisé à l’échelle mondiale. La gestion de la pandémie de Covid-19 a constitué, à cet égard, un moment de bascule : “militarisation des villes, fermeture immédiate des frontières, explosion des contrôles policiers, surveillance électronique et restriction des déplacements, mise en place de systèmes de délation, détentions à domicile”. Dire cela ne signifie pas que le Covid n’était pas un danger pour les populations ou qu’aucune mesure ne devait être prise mais que les crises, y compris pandémiques, sont utilisées par les États pour tester des dispositifs totalitaires – un phénomène bien connu de l’anthropologie anarchiste, par exemple dans L’Oeil de l’Etat (1998) de James C. Scott.
Ces expérimentations de dispositifs dictatoriaux – qui sont toujours initialement justifiées par “une bonne cause” – créent une sorte d’ “effet de cliquet”, c’est-à-dire qu’une fois qu’ils ont prouvé leur efficacité, on peut être à peu près certain qu’ils seront utilisés à d’autres occasions. Le “passe sanitaire” dont on nous avait juré qu’il n’existerait que pour la pandémie a été réutilisé sous une nouvelle forme pendant les Jeux olympiques de 2024. Pendant ces derniers a été testée la vidéosurveillance algorithmique et le même risque de sa généralisation dans les prochaines années est à craindre. Et pour cause : suite à un vote des députés le 17 décembre 2025, cette mesure à été prolongée jusqu’en 2027 au prétexte… des JO d’hiver de 2030…

L’ouvrage insiste sur ce point : “il ne manque qu’un argumentaire bien ficelé ou une crise bien exploitée” pour réactiver ces mécanismes. À ce titre, il alerte sur les usages politiques à venir de la crise écologique. Déjà largement intégrée aux discours de certains courants libéraux ou conservateurs, l’écologie pourrait demain servir de justification à un nouveau tour de vis autoritaire. Si nous ne prenons pas en main nous-mêmes la cause écologique, tout laisse à penser que la gestion par l’État et le capital de la catastrophe tendra vers le fascisme.
L’impasse de stratégies essentiellement électorales et institutionnelles
Révolutions de notre temps développe une critique sévère des stratégies qui font de la conquête électorale et institutionnelle l’horizon principal — voire exclusif — des luttes. L’ouvrage rappelle un constat récurrent de l’histoire politique : les classes dominantes, de droite comme de gauche, préfèreront toujours concéder “un changement cosmétique” et quelques réformes limitées plutôt que de laisser advenir une révolution susceptible de menacer réellement leur pouvoir et leurs richesses.
Dans ce cadre, “la résignation des sociaux-démocrates” joue un rôle central, et c’est pourquoi nous n’arrêterons jamais de la dénoncer à Frustration. En affirmant qu’il serait désormais impossible de transformer en profondeur la société — y compris après des victoires électorales — elle contribue à préparer le terrain pour le fascisme. Les colères populaires, privées de débouchés réels, deviennent alors une proie facile pour l’extrême droite.

D’une manière plus générale, les autrices et auteurs soulignent la défiance profonde suscitée par les organisations historiques de la gauche. “Nombreuses et nombreux sont celles et ceux qui ont été désillusionné·es” par celles-ci “en raison de leurs tendances bureaucratiques, de leurs tentatives de récupération du mouvement ou de leur volonté de les diriger”. Elles et ils ajoutent : “l’intervention des organisations porte toujours le risque de limiter le déploiement du soulèvement, de brider la radicalité de ses demandes, sa créativité et parfois même ses institutions populaires naissantes”. Ce constat s’applique très bien aux deux derniers gros mouvements sociaux que la France a connus, à savoir la lutte contre la réforme des retraites en 2023 puis le mouvement du 10 septembre en 2025.
Selon l’ouvrage, ces dernières années ont confirmé les dangers d’une stratégie concentrant l’essentiel de ses forces sur la voie institutionnelle, au détriment de la construction d’une autonomie politique et matérielle. Il ne s’agit pas forcément de délaisser complètement le combat électoral mais à minima de bien prioriser, de bien hiérarchiser, de mettre les choses à leur juste place : “celles et ceux qui surestiment leur force en pensant pouvoir mener de front les voies de la rue et celles de l’institution s’épuisent trop souvent”. Les trajectoires de Syriza en Grèce ou de Podemos en Espagne sont mobilisées comme exemples emblématiques de cette impasse, avec pour conséquences : “déconnexion du mouvement populaire, politiques de compromis néolibérales, déception et sentiment de trahison, démobilisation de l’énergie de la rue”
Un soulèvement doit agréger différentes luttes et inventer ses méthodes
Révolutions de notre temps insiste sur un point fondamental : quel que soit l’élément déclencheur d’une révolte (hausse des prix, violence policière, fraude électorale, décision autoritaire…) celle-ci reste limitée si elle ne parvient pas à agréger, dans son sillage, d’autres colères sociales. Un soulèvement ne change d’échelle que lorsqu’il dépasse sa cause initiale pour devenir un moment de convergence, capable de fédérer des luttes hétérogènes autour d’un même horizon.

L’ouvrage déconstruit aussi l’idée d’un soulèvement « pur » sur le plan idéologique : c’est ce que les bourgeois “de gauche” frileux et paresseux – que ce soit au moment des Gilets jaunes ou du 10 septembre – n’ont pas compris et ne comprendront jamais. Les moments de révolte populaire sont par nature composites, traversés de contradictions, de désaccords et d’expérimentations parfois chaotiques. Mais c’est aussi ce qui en fait des occasions de décupler les forces et de changer d’échelle, en sortant des cadres habituels de l’action. “Dans certains contextes, l’intervention d’organisations politiques peut être nécessaire” que ce soit pour empêcher la récupération du mouvement par l’extrême droite ou pour l’aider à atteindre ses objectifs. À une condition toutefois : qu’elles fassent corps avec le mouvement plutôt que de chercher à imposer leur agenda, leur « ligne », ou leur culture militante.
Les autrices et auteurs, dont une partie conséquente vient de régions du monde où les soulèvements ont dû faire face à des répressions extrêmement sanglantes, abordent aussi, sans romantisme, la question de la lutte armée. Elles et ils rappellent qu’elle “est un rarement un choix stratégique” car c’est en réalité “le niveau de violence de l’État qui détermine si et quand les révolutionnaires sont contraint-es de prendre les armes”. L’arrivée des armes dans un soulèvement met les révolutionnaires dans des situations extrêmement délicates : déjà l’approvisionnement nécessite souvent des alliances dangereuses et, même ainsi, l’armement auquel ils accèdent est presque nécessairement insuffisant pour faire face aux arsenaux des États militarisés modernes : “la nature profondément asymétrique de la confrontation avec les appareils d’État et les superpuissances militaires placent les révolutionnaires dans une situation de désavantage significatif”. Enfin, “lorsque les armes interviennent, un soulèvement populaire peut facilement se transformer en une cacophonie d’autoritarismes concurrents, et nous livrer au pouvoir de seigneurs de guerre de toute sorte”. La leçon qu’elles et ils tirent de ces constat est que, dans une situation comme celle-ci, l’objectif prioritaire est plutôt d’empêcher l’ennemi d’utiliser ses armes, c’est-à-dire, si cela est possible à un moment, “désactiver le plus largement l’appareil militaire” (“bloquer les casernes”, “désarmer les institutions”, entraver les chaînes de commandement…).
Renverser les gouvernants ne suffit pas
Ce que les insurgés constatent le plus souvent c’est que renverser un gouvernement, changer une constitution ou faire tomber un régime ne suffit pas à transformer les structures profondes du pouvoir. Les structures économiques, étatiques, militaires et idéologiques de la domination survivent généralement aux chutes spectaculaires de dirigeants.

Le livre donne l’exemple du Sri Lanka en 2022. Le pays se trouvait alors au bord du basculement : bâtiments gouvernementaux occupés, président en fuite à l’étranger… “Les révolutionnaires avaient gagné la première manche. Mais, ne sachant que faire des ministères, ils et elles les rendirent.” L’effondrement du pouvoir en place n’avait pas été accompagné d’une réflexion suffisamment aboutie sur ce qui devait lui succéder. Longtemps, le « Grand Soir » a constitué un imaginaire important de la révolution. Mais “les échecs répétés à provoquer des changements profonds et durables par « la prise du pouvoir central » ainsi que les éternels appels des vieilles organisations à attendre que « les conditions soient réunies »” ont conduit nombre de militantes et militants à abandonner “la chute du régime comme horizon stratégique” unique.
L’ouvrage propose alors de penser la révolution non pas comme un moment unique et final, mais comme un processus qui se déploie dans une “constellation d’événements, d’actes, d’interventions, d’idées, de sentiments et de pratiques quotidiennes”. Autrement dit, la révolution ne se réduit pas à la conquête de l’État, mais aussi — et peut-être surtout — dans la transformation concrète des rapports sociaux.
Chercher l’autonomie
Pour l’ouvrage, aucune rupture durable avec l’ordre établi ne peut advenir sans “une prise en main collective de nos besoins élémentaires” : “sûreté”, “santé”, “logement”, “alimentation”. C’est dans ces dimensions matérielles, dans la construction d’une autonomie à la fois matérielle et politique, que se joue des possibilités réelles. En se dotant de moyens propres pour répondre aux besoins vitaux, les mouvements cessent d’être entièrement tributaires des institutions qu’ils contestent.
“Universalisme libéral” vs internationalisme
Ce “manifeste internationaliste” permet de bien distinguer l’internationalisme de “l’universalisme libéral”, son “rival apolitique”. Il explique : “l’incroyable prétention de l’Occident à définir un horizon universel pour l’humanité a produit et justifié des dizaines de millions de mort-es, des génocides, des épistémicides, la mise en esclavage et le déplacement de millions de personnes. Rarement on aura vu une escroquerie intellectuelle aussi macabre et efficace.” Il donne l’exemple de la déclaration universelle des droits de l’homme proclamée en 1948, la même année que… la Nakba, c’est-à-dire l’exode forcé de centaines de milliers de Palestiniens et la destruction de leurs villages lors de la création de l’État d’Israël. L’universalisme occidental proclame l’inaliénabilité des droits humains tout en les refusant concrètement au plus grand nombre.

Les exemples contemporains abondent : “les États-Unis ont envahi l’Afghanistan, l’Irak et bombardé de nombreuses régions du Moyen-Orient au prix de plus d’un million de morts”, au nom de la démocratie. “L’État colonial israélien commet sciemment un génocide en Palestine avec la bénédiction de l’Occident”, parfois accompagné d’une propagande pseudo-progressiste (empowerment féminin, pinkwashing etc.).
Concernant le droit international, les autrices et auteurs reconnaissent “un usage contradictoire” de celui-ci. Instrument des puissances impérialistes pour justifier leurs interventions, sanctions ou guerres, il est aussi utilisé par “les peuples autochtones ou colonisés” qui ont régulièrement recours au seul droit qui leur soit reconnu, le « droit à l’autodétermination », comme levier dans le bras de fer qui les oppose à leurs gouvernements nationaux ou forces d’occupation”. Mais pas d’illusions : ce “paratonnerre” juridique protège rarement lorsque les revendications des peuples entrent en contradiction avec “les intérêts des puissances dominantes”.
Dépasser le mythe de la “démocratie”
Cette lecture permet d’interroger le mythe même de la “démocratie” : “l’ « idéal démocratique » tel qu’il s’affiche encore en Occident n’arrive plus à dissimuler son imposture tant elle crève les yeux”. Les autrices et auteurs donnent l’exemple du début de la campagne présidentielle américaine en 2024, avant l’arrivée de Kamala Harris pour remplacer un candidat démocrate en “quasi-mort cérébrale”, où deux hommes riches “plus que septuagénaires s’accrochaient au pouvoir en rivalisant de tacles sur leurs symptômes de sénilité respectifs, en lieu et place de débats politiques sur l’avenir du monde”. Elles et ils font le parallèle avec “la cinquième candidature présidentielle d’un Bouteflika momifié” en Algérie qui avait “déclenché la révolte de 2019”.

L’ouvrage rejette donc l’idée que la démocratie serait “une invention occidentale qui irait des assemblées athéniennes à la République française, jusqu’à s’exporter à coups de bombes en Afghanistan et en Irak”. Précisément, cette capture de l’idée de démocratie en a fait “un repoussoir dans de nombreuses parties du monde”. Ce qu’il faut réinvestir c’est avant tout “l’idée du pouvoir au peuple”.
Refuser le “campisme” et la “realpolitik” au profit d’un “internationalisme par le bas”
Ce livre permet aussi d’apporter une clarification majeure : l’internationalisme, l’anti-impérialisme, n’est pas se ranger bêtement derrière n’importe quelle Etat ou puissances contestant l’hégémonie américaine (ou, aujourd’hui, le génocide commis par Israël).
Comprendre les choix complexes dans lesquels les peuples révoltés sont pris
Face aux grandes puissances, les mouvements révolutionnaires sont confrontés à des dilemmes permanents et très concrets que le “campisme” (le fait de soutenir systématiquement un pays ou un camp dans un conflit international) ne permet pas d’appréhender avec intelligence. Le livre donne des exemples très concrets : “la résistance palestinienne” contrainte “de prendre l’argent de l’Iran et du Qatar”, les Kurdes du PYD en dépendance vis-à-vis du “régime syrien”, de “son allié russe” et parfois des Etats-Unis, les insurgés d’Afrique de l’Ouest s’appuyant sur la Russie ou la Chine pour “se débarrasser de la France”, la résistance ukrainienne plaçant “sa survie entre les mains de l’Occident”… Ainsi l’ouvrage interroge : “dépendre des grandes puissances reste une question de survie pour nombre de révolutionnaires ces dernières années, comment les condamner ? En leur demandant de continuer à vivre écrasé-es, de capituler ou d’attendre les bombardements passivement ?” La seule alternative est précisément de construire “une réelle solidarité populaire internationale”.

Pour montrer la bêtise du campisme, ce manifeste donne l’exemple des révoltes à Hong Kong en 2019-2020 : pour les campistes, “la solidarité (…) se fonde moins sur ce qui se passe sur le terrain que sur les prises de position des Etats-Unis. Si les Etats-Unis soutiennent une cause, comme la rébellion à Hong Kong, en tout opportunisme, alors ce soulèvement ne mériterait pas notre soutien.” Plutôt qu’une approche pseudo “real-politik” façon “Kissinger”, “éthiquement déplorable et stratégiquement contre-productive”, il s’agit plutôt de “naviguer dans les contradictions du réel”.
Sortir d’un “campisme” surplombant et penser à pourquoi des peuples se battent
Révolutions de notre temps dénonce ainsi les approches géopolitiques binaires et surplombantes héritées de la guerre froide, qui réduisent le monde à l’affrontement de blocs et considèrent les États et leurs coalitions comme les seuls agents capables de faire bouger les lignes.

L’ouvrage critique particulièrement certaines tendances de la « gauche anti-impérialiste », qui, dans leur logique binaire, ont soutenu “implicitement ou explicitement les régimes iranien, russe et syrien”, présentés comme des « remparts » contre l’impérialisme occidental. Dans cette perspective, “les révolutions syrienne ou iranienne ne pouvaient dès lors qu’être jugées « libérales » ou « pro-occidentales » et donc « manipulées ». Quand elles ne sont pas tout simplement pointées comme des complots ourdis par des pays étrangers, évidemment occidentaux, pour compromettre la « souveraineté nationale » des régimes en place.” Ainsi “dans ces récits, le peuple, ses formes d’organisation, ses actions autonomes, ses voix multiples, ses luttes internes, même de classe, comme les massacres commis contre lui par ces régimes et leurs allié-es disparaissent derrière de mauvaises abstractions.” Lorsqu’un mouvement populaire essaye de prendre en main son destin, les campistes se hâtent de plaquer leurs “analyses déconnectées du terrain, dépossédant les premiers concernés” de leur capacité à agir et à se définir. Ainsi, la résistance populaire en Ukraine, les féministes en Iran ou les insurgés en Syrie sont résumés à de simples « agents de l’impérialisme ». Malheureusement une partie de la gauche française dite de rupture n’échappe pas à cette critique. C’est peut-être même là une de ses plus grandes faiblesses, d’autant plus que le soutien à des régimes tyranniques et sanguinaires qui massacrent des populations, envahissent des pays entiers, est, pour les mêmes raisons, tout aussi impopulaire dans “l’opinion” que le soutien à l’impérialisme américain et ses alliés.
L’ouvrage insiste sur un point central : considérer l’Occident comme la seule puissance impérialiste et “les États-Unis comme LA source de tous les maux” (le “biais caractéristique de ces positions “campistes””) conduit à relativiser les crimes d’autres régimes (syriens, russes, chinois, iraniens…) sous prétexte de contrer l’hégémonie occidentale. “Pourquoi faudrait-il dénoncer la colonisation israélienne en Palestine d’un côté, et fermer les yeux sur la guerre contre-insurrectionnelle en Tchétchénie, sur l’invasion de la Géorgie ou de l’Ukraine par la Russie et inversement ?” interroge-t-il. Ces révolutionnaires insistent : “contrairement à ce qu’essayent de nous faire croire les tenants d’une gauche autoritaire et étatiste (…) lier les combats au lieu de les opposer ne nous affaiblit pas mais augmente notre puissance”. Ils rappellent, à raison, qu’un ““sous-impérialisme”, c’est toujours de la merde et du sang ». D’ailleurs, un jour, un de ces “sous-impérialismes” pourrait bien remplacer les Etats-Unis à la tête de “l’Empire” sans que cela ne soit si salvateur pour les populations. Et pour cause, même “des bourgeoises nationales et les élites politiques issues”, par exemple, de “mouvements d’indépendance (…) ont souvent cédé à l’autoritarisme” et “pris leur part des fruits de l’exploitation post-coloniale”.
Comment être internationaliste concrètement ?
Être internationaliste relève de pratiques matérielles, politiques et culturelles bien concrètes. La première forme d’entraide est, sans surprise, matérielle : ressources financières, équipements, soutien logistique, capacités de soin, d’hébergement ou de survie. Sans ces appuis concrets, les discours de solidarité restent largement incantatoires.
Mais l’entraide ne se limite pas à l’aide matérielle directe. Elle passe aussi par “le relais des voix des personnes et des groupes aux prises avec la réalité du terrain révolutionnaire”, “les faire passer à travers les mailles des filets médiatiques” pour “peser sur l’opinion” (c’est ce que nous essayons de faire de plus en plus, à notre petite échelle, à Frustration).
L’internationalisme s’incarne enfin dans l’action depuis là où nous sommes : “c’est bloquer ici une usine d’armement pour réduire là-bas l’intensité des bombardements, c’est harceler ici une multinationale pour compromettre là-bas ses projets extractivistes”. On a vu des actions de ce type avec les blocages de livraisons d’armements envers Israël, par exemple en France, au Royaume-Uni, en Italie (que nous avions relayés grâce à des camarades sur place)… L’ouvrage rappelle que les grandes victoires historiques contre le colonialisme (en Irlande, au Vietnam, en Algérie…) “ont été obtenues par les insurgé·es sur leurs terres, mais aussi en gagnant les cœurs dans les centres des empires, jusqu’à ce que les populations de ces pays, elles-mêmes, exigent la fin des guerres et de l’occupation”.

Agir depuis le « ventre de la bête » n’est donc pas secondaire : c’est une condition pour “élargir le front” et “délocaliser les lieux d’affrontement”. Dans cette perspective, la “première tâche est d’organiser la rencontre. Multiplier, partout dans le monde, les liaisons entre les différents foyers du mouvement révolutionnaire naissant” ; trouver et mutualiser “des ressources matérielles et financières” ; “structurer, dès que possible, un réseau d’entraide” capable d’intervenir rapidement “lors d’événements exceptionnels”. L’objectif est clair : favoriser le retour d’un internationalisme populaire, non aligné, en lien avec les luttes réelles plutôt qu’englué dans le jeu des superpuissances.
Malgré une écriture qui emprunte parfois au style un peu lyrique poético-militant (l’insistance, toujours très intellectuelle, sur les “corps en lutte” par exemple), à laquelle je suis, à titre personnel, peu sensible, Révolutions de notre temps a plusieurs mérites. Tout d’abord, contre le campisme et l’universalisme occidental, celui de rappeler le sens concret de l’internationalisme : tisser des solidarités matérielles, politiques et culturelles, apprendre des combats d’ailleurs, et agir ici pour peser là-bas. Être internationaliste, c’est donc agir concrètement, partout où l’on est, pour que les luttes locales trouvent écho, soutien et relais dans un réseau mondial de résistances. On se demande souvent ce qu’est être révolutionnaire aujourd’hui : pour l’être et espérer qu’un jour les choses changent, ici comme ailleurs, l’internationalisme est une nécessité.

Rob Grams
Rédacteur en chef adjoint