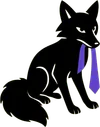Médecins en France, portrait d’une bourgeoisie qui s’ignore

On dit souvent que le médecin est « le plus beau métier du monde ». Cette formule, répétée depuis l’enfance dans les récits familiaux et institutionnels, installe le médecin dans un espace de révérence morale. On ne « travaille » pas comme médecin ; on sert, on soigne, on accomplit une vocation.
La médecine française continue de se penser hors des rapports sociaux ordinaires. De Molière à Grey’s Anatomy ou encore Hippocrate, la figure traverse les siècles avec la même articulation entre savoir, pouvoir et prestige. La médecine change ; la position sociale du médecin, moins.
Depuis quelques années, quelque chose vacille dans cette aura. L’après-Covid, l’essor des déserts médicaux, les retards diagnostiques, les urgences saturées ont fissuré l’image du médecin comme figure tutélaire du soin. La médecine n’est plus seulement ce qui soigne ; elle est aussi ce qui refuse.
C’est ce que j’appelle ici – à la suite du philosophe Alexandre Monnin – le non-soin : non pas l’absence totale de soins, mais une orientation active vers le renoncement et le tri, par lesquels certaines vies sont soignées, d’autres moins, d’autres pas du tout. Le patient devient un profil de risque non plus un sujet à accompagner.
Du biopouvoir au non-soin
Pour saisir ce glissement, il faut élargir le cadre. Michel Foucault parlait de biopouvoir : un pouvoir qui gère la vie. Mais gérer suppose encore d’investir. Ce qu’on voit aujourd’hui, c’est autre chose, ce que le politologue camerounais Achille Mbembe appelle la nécropolitique : un pouvoir qui s’exerce par l’administration de la mort, qui décide « qui pourra vivre et qui doit mourir ». Le nécropouvoir ne tue pas toujours directement ; il expose à la mort, abandonne, crée des « mondes de mort » – des espaces où des populations entières sont maintenues dans un statut de « morts-vivants ».

La pandémie de Covid-19 a révélé que ce cadre s’appliquait aussi à nos sociétés. Barbara Stiegler et François Alla, dans Santé publique année zéro, ont montré comment la crise sanitaire avait exposé la faillite d’un système incapable de penser la prévention. Le tri aux urgences, les protocoles de réanimation ont rendu visible ce qui fonctionnait déjà à bas bruit : une logique de sélection des vies dignes d’être soignées. De plus en plus de soignants témoignent de cette violence institutionnelle quotidienne.
Cette logique s’inscrit dans une mutation plus large. La numérisation du soin transforme le patient en flux de données. En France, le Health Data Hub – la plateforme nationale censée centraliser les données de santé de millions de Français – est hébergée par Microsoft, soumise au droit extraterritorial américain. Amazon développe des pharmacies en ligne, Apple collecte des données de santé via ses montres. Ainsi, le diagnostic devient algorithme, le soin devient un service optimisable : scores de risque, tri automatisé des patients, priorisation administrative ou encore optimisation des flux hospitaliers. Et ce tri se fait à bas bruit. Les technologies donnent aujourd’hui au capitalisme nécropolitique une capacité inédite à gérer les corps, en rendant le non-soin plus discret, plus rationnel, et donc plus acceptable.
Dans ce moment de bascule, les médecins occupent une position décisive. Non parce qu’ils seraient seuls responsables, mais parce qu’ils se tiennent au point exact où se décide le soin ou le non-soin. Et c’est précisément là que le voile humaniste de la vocation opère avec le plus de puissance, rendant invisible la dimension de classe de leur position.
La grève de janvier 2026 : défendre le soin ou défendre ses intérêts ?
Du 5 au 15 janvier 2026, une grève massive des médecins libéraux s’est organisée contre le Projet de loi de financement de la Sécurité sociale 2026, définitivement adopté par l’Assemblée nationale le 16 décembre 2025. Au cœur des revendications : le refus de la régulation de l’installation, la défense des honoraires, et la contestation de l’article 26 bis sur le secteur 3 – mais aussi, pour une partie des praticiens, la dénonciation d’une Sécurité sociale jugée de plus en plus comptable dans la gestion des arrêts et des prescriptions. Un dispositif adopté dans un PLFSS contre lequel une partie de la gauche n’a même pas voté.
L’article prévoit qu’à partir de 2027, les prescriptions des médecins non conventionnés ne seront plus remboursées. Autrement dit, consulter un médecin en secteur 3 prive le patient de remboursement. Le remboursement devient conditionné au statut du prescripteur plutôt qu’aux besoins du malade : un non-soin institutionnalisé.
L’UFML-Syndicat (Union française pour une médecine libre, syndicat fondé en 2012 sur une ligne de défense intransigeante de la médecine libérale, hostile à toute forme de régulation étatique) dénonce une « rupture d’égalité entre patients ». Mais cette indignation masque un paradoxe : le secteur 3 est précisément le segment où les médecins ont choisi de s’extraire du système solidaire pour pratiquer des tarifs sans plafond. Défendre simultanément la liberté tarifaire totale et le remboursement des prescriptions, c’est vouloir la rente privée et la garantie publique.
Cette mobilisation prolonge celle du printemps 2025 contre la loi Garot, qui prévoyait une autorisation préalable de l’ARS (Agence régionale de santé, l’administration chargée de piloter la politique de santé dans chaque région) pour toute nouvelle installation en zone suffisamment dotée. France Assos Santé, la fédération d’associations de patients qui représente les usagers dans les instances de santé, rappelait dans un communiqué du 28 mars 2025 : « La majorité des professionnels de santé autres que les médecins ne disposent pas d’une telle liberté non régulée ! L’installation des pharmacies, sages-femmes, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes […] sont soumis à une régulation dans les zones suffisamment dotées. »
La population n’a pas été consultée : c’est au nom d’un « nous » que les médecins parlent, sans définir qui est inclus. Ce qu’ils défendent, ce n’est pas seulement le droit de soigner, c’est la préservation de leur liberté d’exercice et de leurs revenus – c’est une position de classe.
Une position de classe construite historiquement
Pour comprendre cette grève, il faut remonter. Le métier de médecin n’est pas un donné naturel ; c’est une position sociale construite historiquement. L’historien Patrice Pinell, dans La genèse du champ médical (2009), montre que le pouvoir médical est une configuration institutionnelle. Dès le XIXe siècle, la profession se dote d’un ethos : la « liberté médicale » – liberté d’installation, liberté de prescription, refus du salariat.
Le moment 1945 constitue un tournant majeur : la Sécurité sociale collectivise la demande de soins. Mais l’offre de soins, elle, n’est pas socialisée. Les médecins acceptent le conventionnement à condition de ne pas devenir salariés.
Le numerus clausus, instauré en 1971, prolonge cette logique. Ce dispositif, limitant l’accès aux études médicales, organise la rareté comme ressource de classe : moins de médecins, plus de patients par praticien, donc plus de revenus et de pouvoir de négociation. Quarante ans plus tard, cette rareté organisée produit les fameux « déserts médicaux ». Mais la profession peine à se voir comme responsable.
Le Conseil national de l’Ordre des médecins parachève le dispositif. Créé en 1940 sous le régime de Vichy, maintenu après la Libération, il est l’organe de régulation interne de la profession. Il veille au respect de la déontologie, mais aussi à la « confraternité » – un principe qui interdit la critique publique entre confrères. C’est à partir de là que deux fiertés françaises se côtoient – « le plus beau métier du monde » et « le meilleur système de santé au monde » – sans jamais se confondre.
Réflexes de patron et fétichisme du soin
Le modèle libéral repose sur le paiement à l’acte : chaque consultation, chaque geste médical donne lieu à une facturation. Ce système, contrairement au salariat, lie directement le revenu du médecin au nombre d’actes réalisés. Il produit des structures mentales.
« Avec ton cabinet, tu développes très vite des réflexes de patron », observe le Dr Zoé, médecin généraliste et membre de la PaduTeam. « Tu peux te raconter que tu es orienté vers le patient – mais quand tes conditions d’existence dépendent d’un fonctionnement de patronat, ça structure ta pensée. »
Ce qui traverse aujourd’hui les métiers du soin est d’abord une crise de sens – sur ce que « soigner » veut dire, sur comment ce travail est organisé, valorisé, réparti. C’est cette crise qui rend nécessaire de parler du fétichisme du soin.
Le soin apparaît comme un acte individuel – celui du médecin – alors qu’il est le produit d’une chaîne collective : aides-soignantes, infirmières, secrétaires médicales, brancardiers, aidants familiaux… Le paiement à l’acte transforme la valeur d’usage (guérir, accompagner) en valeur d’échange (consultation, cotation, dépassement). Le geste clinique devient une marchandise ; le patient un coût. Avec en son centre, la consultation – facturée toutes les 15 minutes – qui est devenue l’unité de production.
La violence comme fabrique de classe
La violence des études de médecine prolonge cette logique. L’enquête Santé mentale 2024 des syndicats d’étudiants et d’internes en médecine documente : 22 % des étudiant·es déclarent avoir subi du harcèlement sexuel, 6 % des agressions sexuelles, dans le cadre de leurs études. Deux tiers des violences sexistes ont lieu à l’hôpital, et dans la moitié des cas, l’agresseur est un médecin thésé.
Cette violence prolonge celle documentée par l’Observatoire féministe des violences médicales. Comme le déclarait sa cofondatrice Johanna-Soraya Benamrouche devant le CESE : « Les violences médicales s’expriment en toute impunité, banales parce qu’elles prennent naissance dans un environnement marqué par de nombreux biais racistes et sexistes, tels que le syndrome méditerranéen” – ce préjugé selon lequel les patients perçus comme arabes ou maghrébins exagéreraient leur douleur.
La violence en formation fabrique une classe. L’anthropologue Emmanuelle Godeau l’a montré : le bizutage médical fonctionne comme un rite initiatique qui « fait » les médecins. Ceux qui tiennent intériorisent la hiérarchie comme légitime – et le tri comme pensable.
Un changement générationnel est pourtant en cours. Au 1er janvier 2025, les femmes sont devenues majoritaires parmi les médecins : 50 % des effectifs, 52 % chez les généralistes, 60 % chez les moins de 40 ans. L’exercice exclusivement libéral recule (42 % contre 51 % en 2012), l’exercice mixte – comprenant une activité salariale – progresse. Mais ces évolutions ne suffiront pas sans rupture avec le modèle.
Le non-soin n’est pas une abstraction théorique. L’association Gras Politique recueille depuis des années des témoignages de grossophobie médicale sur sa « liste non safe ». Une patiente raconte : « Réaction de ma gynécologue après ma fausse couche : voyez le bon côté des choses, vous allez avoir plus de temps pour maigrir. »
Quand Gras Politique publie ces listes, comment réagit la profession ? L’Ordre des médecins ne propose pas d’enquête mais rappelle aux praticiens les voies de poursuite pour diffamation. Daria Marx, cofondatrice de Gras Politique : « Nous sommes régulièrement dénoncé·es à l’Ordre des médecins, mais nous avons pris le parti d’être hors-la-loi. »
Ces prises de parole montrent surtout à quel point la profession peine encore à reconnaître comme légitime la critique venue de celles et ceux qu’elle soigne.
Nemesis médicale : profession contre profanes
La sociologue Anne-Chantal Hardy montre dans sa thèse que « l’incapacité de la profession médicale à produire une réflexion indépendante sur son action signale fondamentalement l’ampleur de ses sujétions ». Cette difficulté tient notamment à ce qu’Eliot Freidson, pionnier de la sociologie médicale, décrivait comme l’autonomie paradoxale des professions : elles vivent selon leurs propres normes tout en revendiquant une autorité morale sur le reste de la société.
Hardy prolonge cette analyse : toute société de professionnels produit en miroir une société de profanes, « des individus dont la parole n’est pas reconnue en dehors de leur champ d’expertise ». La médecine occidentale s’est construite sur cette frontière, en marginalisant savoirs populaires, sages-femmes, compétences paramédicales, expériences profanes de la maladie – mais aussi, dans le contexte colonial, les pratiques de soin non européennes, disqualifiées au nom de la rationalité médicale.
Cette séparation explique la difficulté persistante à reconnaître la parole des patients : les listes de témoignages sont vécues comme une menace parce qu’elles contestent le monopole professionnel de l’évaluation légitime du soin. Or celui qui définit la maladie, l’arrêt ou le traitement détient un pouvoir direct sur les trajectoires de vie.

C’est là que se révèle la dimension de classe de la profession médicale : concentration de capital économique, culturel et social – une domination d’autant plus efficace qu’elle se vit comme dévouement. Elle se lit aussi dans la répartition de la richesse collective. Les médecins libéraux captent une part de la richesse socialisée par les cotisations – ce que l’économiste Nicolas Da Silva appelle la Sociale, le salaire différé des travailleurs. Ils bénéficient du financement collectif tout en refusant le contrôle démocratique. Cette articulation entre pouvoir médical, financement collectif et pénurie organisée fait de la profession médicale une classe de gestion du non-soin, occupant un entre-deux vital où se décide qui sera accompagné, qui sera laissé s’user, et qui basculera dans une survie sociale minimale.
Le non-soin n’est pas un accident du système : il en est le produit. Ainsi, le capitalisme nécropolitique n’a pas besoin de forcer les médecins : il leur propose d’automatiser ce qu’ils faisaient déjà. À l’échelle mondiale, cette logique prend des formes différentes mais obéit à la même matrice : certaines vies valent l’investissement, d’autres non.
Le non-soin à l’échelle mondiale
Aux États-Unis, le programme MAHA (Make America Healthy Again) porté par Robert F. Kennedy Jr. procède par démantèlement : coupes dans Medicaid (le programme d’assurance santé pour les plus pauvres, qui couvre près de 90 millions d’Américains), licenciements massifs dans l’administration sanitaire, gel de financements pour la recherche.

À l’autre extrémité, le génocide en cours à Gaza montre ce que le BMJ Global Health (revue médicale britannique de référence) a nommé le « healthocide » ou santécide : la destruction délibérée d’un système de santé comme arme de guerre. Plus de 1 700 soignants tués, des centaines d’attaques contre des structures médicales, la moitié des hôpitaux hors service.
Sortir le soin de la propriété médicale
La France occupe un entre-deux plus feutré : hausse de la mortalité infantile depuis 2012, rationnement des soins en EHPAD, attaques répétées contre l’AME (Aide médicale de l’État, le dispositif qui permet aux étrangers en situation irrégulière d’accéder aux soins – régulièrement menacé de restriction ou de suppression), désertification médicale croissante.
Face à cela, des alternatives existent. Il y a des collectifs comme l‘ASAP (Assemblée pour des soins antiracistes et populaires) qui pense le soin depuis les luttes contre les discriminations. Les chttps://frustrationmagazine.fr/le-media-bourgeois-gazeentres de santé communautaires – La Case de Santé à Toulouse, le Jardin à Bron – expérimentent d’autres modèles : médecins salariés, équipes pluridisciplinaires, usagers participant à la gouvernance.
Mais ces évolutions ne suffiront pas sans rupture avec le fétichisme du soin. Le soin n’est pas l’acte solitaire du médecin : c’est une chaîne collective, largement féminine, souvent racisée, invisibilisée et sous-payée.
La lutte des classes passe ici par les corps : qui peut se reposer et être soigné, et qui doit continuer malgré tout.
Il ne s’agit pas d’être contre la médecine ni contre la science. Il s’agit d’arracher le soin à sa propriété professionnelle exclusive pour le replacer dans la lutte contre une organisation capitaliste qui transforme les corps en variables d’ajustement et accélère la production de vies jetables. Or la profession comme corps – ses syndicats, son Ordre, ses porte-parole – continue trop souvent de défendre des privilèges au nom d’une vocation qu’elle n’interroge jamais. Tant qu’une fraction sociale décidera seule qui mérite d’être soigné, le non-soin restera la norme.
J’écris depuis une position traversée : ancien étudiant en médecine, malade chronique, issu de minorités raciale et sexuelle qui rencontrent la médecine dans la suspicion, la douleur et la négociation. Comme l’écrivait Audre Lorde : « Prendre soin de moi n’est pas de l’indulgence, c’est de l’auto-préservation – et c’est un acte de guerre politique. » Le soin n’est pas une vertu individuelle. C’est une organisation collective du vivant – et donc un champ de lutte.
Kendrys Legenty