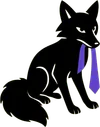Pourquoi la gauche trahit (et comment l’en empêcher)

En juin 2022, un cadre de la France Insoumise me l’assurait : durant les négociations qui ont conduit à la création de l’éphémère Nupes, les échanges entre les insoumis et les socialistes avaient été étonnamment constructifs. Les représentants socialistes à la table des négociations avaient fait un vrai travail de remise en question des années Hollande, me disait-il, et s’engageaient sincèrement dans un réancrage à gauche pour faire face, avec ses alliés insoumis, communistes et écologistes, au second mandat d’Emmanuel Macron. Sur internet, les militants enthousiastes dressaient des lauriers à Olivier Faure, passé d’obscur cadre sans charisme à figure gauchiste.
Trois ans plus tard, cet automne 2025, le budget de la sécurité sociale, amené par un gouvernement sans majorité et au nom d’un président dont même les proches disaient, en septembre dernier, qu’il allait devoir partir, est adopté grâce au vote du PS, l’abstention des écologistes et des voix et des abstentions du groupe communiste. Les députés de ces trois partis ont pourtant été élus en juillet 2024 sur le programme et le positionnement politique du NFP, résolument opposé à Macron. Mais grâce à ces partis, une loi de coupes budgétaires, qui fait payer aux malades du cancer une partie plus importante de leurs soins, qui limite les arrêts de travail et qui exonère de cotisations des heures supplémentaires a été adoptée. Mais en plus, le macronisme a été reconduit deux ans de plus, et avec elle l’idée que la colère du peuple de 2023 et septembre dernier, ainsi que le résultat des urnes de juillet 2024 n’ont aucune espèce d’incidence sur le règne d’un président mandaté par la classe dominante. Et l’idée qu’un programme de gauche n’engage décidément jamais ladite gauche.

Ce n’est pas la première fois que la gauche trahit : c’est l’énième fois, et ça n’a débuté ni en 2025, ni en 2012 et ni même en 1983 : la SFIO soutenait la colonisation durant une bonne partie du XXe siècle, c’est un ministre de l’Intérieur socialiste, Jules Moch, qui envoyait l’armée réprimer la grève des mineurs de 1948 et dès 1914 les socialistes ont trahi leur programme pacifiste pour se rallier aux bourgeois dans le soutien à la guerre mondiale. La gauche trahit et cela fait partie de sa (mauvaise) image populaire. La droite, elle, ne trahit pas : puisqu’elle prône le maintien ou l’exacerbation de la lutte des classes en faveur des plus riches, elle n’a aucune difficulté à appliquer son programme. A l’opposé, la gauche trahit et la gauche déçoit, en France comme ailleurs dans le monde.
Par conséquent, être de gauche de nos jours revient à adopter une drôle de foi religieuse : celle qui consiste à espérer ne pas être déçu. On allume régulièrement un cierge en hommage à tel homme, telle femme politique, en espérant qu’elle ne nous trahisse pas. En 2024, place de la République à Paris, des centaines de gens scandaient ainsi, à destination des partis de gauche sortis victorieux des élections législatives : “Ne nous trahissez pas !” C’est dire comme nous avons conscience du problème. Mais pourquoi trahissent-ils, au juste ? Est-ce seulement une question de personne ou le problème est-il plus profond ?
Trahir : mode d’emploi
Comment justifier son vote d’une loi de financement de la sécurité sociale absolument opposée au programme, pourtant modéré, sur lequel on a été élu ? Car les députés PS l’ont certainement oublié – comme un peu tout le monde à vrai dire – mais le programme du NFP comportait l’embauche de soignants, la réduction du temps de travail et le rétablissement de l’ISF, entre autres, c’est-à-dire l’inverse de ce que contiennent les deux budgets discutés cet automne au Parlement. Plusieurs combines pour se dépatouiller d’une telle contradiction existent :
1 – Dire qu’on ne fait pas le “grand soir” :
C’est une justification classique et centenaire de la gauche qui trahit. Le “grand soir”, ce terme initialement forgé par l’extrême-droite pour stigmatiser les idéaux révolutionnaires, est devenu la formule préférée des socialistes et écologistes. Elle permet d’opposer à un idéal révolutionnaire caricaturé (personne n’a jamais dit que le changement social se ferait en un soir, même les plus radicaux pensent la Révolution comme un processus long) une posture réfléchie, progressive, “réformiste” du changement social. On renonce à des grandes choses illusoires pour en obtenir des petites. Sauf que la gauche qui trahit n’obtient rien : le quinquennat de François Hollande a fait régresser les services publics et le système de santé. L’opposition socialiste et écologiste au macronisme n’ont en rien arrêté la destruction de la sécurité sociale. Ce qui aurait été le cas si le PS avait refusé de soutenir Lecornu ou de voter son budget : le gouvernement serait à nouveau tombé et nous aurions vécu une crise institutionnelle sans budget.

La gauche qui trahit n’est pas réformiste comme elle prétend l’être, à l’opposé d’une gauche qui serait révolutionnaire. Dans le paysage politique, la gauche réformiste c’est la France insoumise : elle veut transformer le système progressivement – et à la marge – via les institutions existantes. Mais que veulent le PS et les écologistes ? Survivre. Ils n’ont pas plus de stratégie que cela. Ce n’est en réalité pas au “grand soir” qu’ils s’opposent en agissant ainsi, mais à toute mesure de gauche.
2 – Se la jouer “réaliste” et “responsable” :
“Oui mais sans vote du budget, ce sera le chaos et à la fin tout le monde en pâtira.” Face aux contraintes institutionnelles, le PS et les écologistes tentent de refermer toute imagination : ils referment le champ des possibles en invoquant des contraintes institutionnelles. Le “compromis” budgétaire serait inévitable, car nous avons besoin d’un budget pour la France. C’est une véritable fake news, inspirée du célèbre “shut down” américain : de l’autre côté de l’Atlantique, l’État fédéral est obligé de fermer boutique si le budget n’est pas voté. Ce n’est pas le cas en France et encore moins concernant le budget de la sécurité sociale : avant les années 1990, la discussion budgétaire sur le PLFSS (Projet de loi de financement de la sécurité sociale) n’existait pas car la sécu n’était pas financée par l’État via l’impôt mais uniquement par des cotisations sociales prélevées sur le patronat et les salaires. Ce sont les socialistes qui ont créé une loi annuelle de financement de la sécurité sociale, s’appuyant sur l’existence de la contribution sociale généralisée, cet impôt qu’ils ont créé pour financer la sécurité sociale, mettant fin à des années d’autonomie des caisses de sécu vis-à-vis de l’État, et donc des gouvernements (autonomie dont les fondateurs de la sécu expliquaient qu’elle était essentielle à sa survie car empêchant la sécu de subir des coupes budgétaires de la part de gouvernements bourgeois).
Mais même dans ce contexte contemporain, l’absence de budget n’empêcherait pas les remboursements de médicaments, la prise en charge des arrêts maladies, le versement des prestations sociales diverses, le prélèvement des cotisations… La seule conséquence négative, nous dit Public Sénat, ce serait l’augmentation des déficits en l’absence de mesures de “régulation” du gouvernement, c’est-à-dire de contraintes budgétaires, de réduction des remboursements, de baisses des prestations, etc. Autant dire que l’absence de budget de la sécurité sociale aurait en fait été une bonne chose pour la population. Concernant le budget de l’État, dont la discussion parlementaire débute en ce moment, c’est la même chose. Il n’y aurait pas de blocage mais les nouvelles dépenses attendues n’auraient pas lieu car le budget resterait identique à l’année passée : au revoir les 6,7 milliards d’euros supplémentaires pour l’armée si cela devait arriver, se désole le Monde. Le “réalisme” de ceux qui sont prêts à tout pour voter ces textes, au prix de leur trahison, est en fait un conservatisme et un bourgeoisisme : il ne s’agit pas de sauver les gens mais de sauver le fonctionnement ordinaire des institutions de la République bourgeoise. Se faisant, socialistes et écologistes ferment notre imaginaire collectif derrière l’idée que rien ne se passera jamais d’autre que ce que l’on connaît.
3 – Techniciser et dépolitiser :
Oui mais il est excessif de parler de trahison car socialistes et écologistes ont obtenu des grandes choses ! N’ont-ils pas obtenu la suspension de la réforme des retraites de 2023 comme le répètent les cadres socialistes ? N’ont-il pas obtenu une hausse de l’objectif national des dépenses de l’Assurance maladie, ce fameux “Ondam” dont la cheffe de fil des écologistes de l’Assemblée nationale nous dit qu’il a été plus haut que prévu grâce à un engagement du Premier ministre envers son groupe ? Parce que la discussion budgétaire est complexe et que la couverture médiatique qui en est faite laisse à désirer, la gauche qui trahit peut se prévaloir de résultats qui lui permettent de défendre sa position “réformiste anti-grand soir”. Or, ce n’est que parce qu’elle noie ces résultats sous des termes techniques qu’elle parvient – provisoirement – à tromper son monde. La “suspension” de la réforme des retraites n’est ainsi pas une suspension mais tout au plus un décalage, qui bénéficiera à une toute petite partie de la population (les gens nés en 1969 et… c’est tout) Ça ne change rien au fond du problème et cela vient même donner l’impression d’une concession qui n’en est fondamentalement pas une, ce qui a pour simple conséquence de mettre fin au débat sur le fond de la réforme des retraites.

Cyrielle Chatelain a tenté le même genre d’enfumage technique lorsqu’elle a justifié l’attitude écologiste face au texte en ces termes : « Le groupe écologiste va s’abstenir dans sa grande majorité, car nous avons obtenu une augmentation de l’Ondam ». Sur le papier, c’est vrai : l’objectif national des dépenses de l’Assurance maladie, qui définit le niveau de dépense accepté par le gouvernement, pour les années à venir, de la part des hôpitaux ou de la médecine de ville, sera de 3% en 2026. Mais c’est le cas chaque année : l’Ondam augmente. Ce qui ne veut pas dire qu’il n’y aura pas de coupes budgétaires : au contraire. Car cet objectif de dépense n’est pas conforme aux besoins du système de santé, estimé à 4% par an, en raison du vieillissement de la population et de la hausse des maladies chroniques qui en résulte. Par conséquent, ce qui ressemble à une augmentation de budget est en fait une réduction… Ce tour de passe-passe technique est commenté avec la même naïveté, chaque année, par les médias qui ne font pas le rappel de ce que ça implique. Certains députés, qui accueillent cette augmentation comme une bonne nouvelle, n’ont pas l’air de le comprendre – ou de vouloir le comprendre. Pire : la présidente du groupe écologiste ment éhontément puisque non seulement cette hausse est en réalité une contrainte budgétaire grave, mais en plus elle est plus grave que l’année précédente, où l’Ondam était de 3,6% (c’est-à-dire se rapprochant des besoins). Cette hausse de l’Ondam est une terrible défaite qui aura des conséquences sur la vie des soignants et la survie des patients, mais la complexité des textes budgétaires et l’absence de réel décryptage médiatique de ce qui s’y passe permet à la gauche qui trahit de donner l’impression qu’elle avance.
Pourquoi trahir est si simple
La gauche qui trahit parvient-elle à se regarder dans le miroir ? Je crois hélas que oui. Car elle bénéficie d’un véritable système d’impunité qui encourage et justifie la trahison politique. D’abord grâce à un écosystème médiatique : les médias de droite des milliardaires (BFM TV, CNews, Les Échos, Le Figaro…) saluent évidemment la culture du “réalisme” et du “compromis” de la gauche qui trahit pour une raison évidente : ses trahisons sont un ralliement aux intérêts de la classe bourgeoise. Les médias de centre, qui appartiennent à des riches prétendument centristes ou de gauche comme Le Monde (Xavier Niel, Matthieu Pigasse) ou Libération (Denis Olivennes) aiment cette gauche qui continue à se donner des apparences de gauche mais qui lâche du lest sur ses fondamentaux dès qu’elle peut. On se donne des frissons avec la micro taxe Zucman mais dans le fond on respire quand elle disparaît du débat public. Du côté des médias public en cours de Bollorisation, on salue cette gauche “réaliste”, “pragmatique” car cela permet de mieux pouvoir stigmatiser, par comparaison, cette gauche insoumise qui est dans le “conflit”, qui n’est pas “constructive” car sur le service public on est là pour maintenir le réel tel qu’il est : favorable à la bourgeoisie et aux classes aisées.
Du coté des médias dits indépendants, le système d’impunité n’est pas forcément brisé : sur l’émission Backseat, la présidente du groupe écologiste a pu justifier son abstention sans être contredite alors qu’elle mentait. Ainsi, l’écosystème médiatique va produire deux choses à la fois : quand la gauche trahit, elle va saluer la trahison au nom de justifications techniques et politiques, qui font d’elle la seule raisonnable. Et au moment des élections, l’écosystème médiatique va redorer son blason de gauche, ne serait-ce qu’en la nommant comme telle (alors qu’on peut s’interroger sur le sens qu’il y a, après des décennies de travail actif pour le capital, de nommer le PS “la gauche”) et en gommant tout son passé de compromissions. La virginité de gauche est reconstruite tous les cinq ans par des médias qui vont insister sur la “rupture” qu’ont pu constituer des Benoît Hamon, Olivier Faure et Marine Tondelier, de façon à revivifier un “débat démocratique” qui aurait bien piètre apparence si l’on disait ce qu’il en était vraiment, à savoir que la plupart des acteurs légitimes de la course électorale appartiennent peu ou prou à la même équipe, avec quelques nuances qui n’auront aucun impact sur la vie des gens.

Ce travail de résurrection de la gauche qui trahit, devenue la “gauche en fait à nouveau de gauche”, est aussi faite par ses alliés, à commencer par la France insoumise qui, selon ses stratégies électorales, a besoin ou non d’alliés pour prendre de l’ampleur en termes de nombre d’élus nationaux ou locaux. Par “pragmatisme”, la France insoumise a pu adouber un Olivier Faure ou une Lucie Castets puis les ostraciser – à juste titre. Si j’insiste là-dessus ce n’est pas pour le plaisir d’en remettre une couche sur ce qui s’est révélé être une erreur stratégique gravissime commise par la FI mais pour que l’on comprenne bien comment fonctionne notre classe politique quand il s’agit d’émettre des discours : en fonction des circonstances et des gains.
Car les discours et les actes n’ont pas, dans la vie politique, la consistance qu’ils ont en population générale. Un politique français change beaucoup plus souvent de fond politique, philosophique et moral que n’importe quel individu normalement constitué. Ce qui est souvent décrit comme une idée reçue regrettable qui nourrirait l’abstention – l’idée que les politiques sont indignes de confiance – est en fait une donnée sociologique majeure qu’il faut prendre en compte si l’on ne veut pas constamment être déçu. Cela tient à un phénomène qui s’est terriblement aggravé au cours des dernières décennies : l’autonomisation de la sphère politique vis-à-vis de la vie réelle.
Cette autonomisation se traduit dans un fait simple aux conséquences dévastatrices : pour un homme ou une femme politique, ce qui importe le plus ce n’est pas ce que pense de lui la population générale mais ce que les membres de son clan vont avoir comme estime ou dégoût pour sa personne. La politique française est d’abord un système de cooptation, à droite comme à gauche, où même la défaite électorale n’enterrera pas votre avenir politique. Ce qui compte, c’est votre capacité à exister dans cette sphère autonome, professionnalisée et où vos scores électoraux ont peu d’importance. Ce qui compte, c’est votre capacité à gravir des échelons et vous positionner au bon endroit au bon moment. Ainsi, Marine Tondelier peut avoir perdu toutes les élections auxquelles elle a participé et pourtant faire partie des personnalités politiques de gauche de premier plan. Le PS peut avoir été battéu à plate couture à toutes les élections et rester une force politique puissante sur le plan institutionnel et médiatique. Les élections jouent un rôle presque mineur, il tient à la bourgeoisie médiatique et aux clans politiques en place de décider de la place qu’on lui accorde. Si ce n’était pas le cas, LFI serait depuis longtemps le seul parti de gauche dont on entendrait parler, vu son score à la dernière présidentielle, et Les Républicains, ayant fait 6% aux dernières législatives, serait traité comme un micro-parti.
Comment empêcher la gauche de trahir
L’autonomisation de la vie politique, c’est aussi la transformation des partis de masse en clans. C’est un phénomène propre au XXIe siècle, et particulièrement en France : les partis comptent très peu de monde. Environ 6000 personnes ont participé au vote lancé au sein du parti écologiste pour désigner Marine Tondelier candidate. C’est très peu. A titre de comparaison, le Parti du travail de Belgique compte 20 000 militants pour une population 6 fois inférieure à la nôtre. En France, les effectifs du PS ont fondu : ils ont été divisés par 4 entre 1981 et 2023. Les militants qui ne sont pas intégrés aux instances nationales, c’est-à-dire qui ne sont pas des élus ou des cadres, peinent à se faire entendre. Le plus souvent, ils interpellent leur parti… sur les réseaux sociaux. “Le budget de la sécurité sociale est inacceptable : député.e.s écolos, votez contre !” s’exclament les “jeunes écologistes” sur un post Instagram qui n’aura donc eu aucun effet. La “démocratie interne” dont les partis de gauche qui trahissent se targuent d’être dotés n’a aucun effet sur les lignes qui restent fidèles aux évolutions de leurs leaders, au gré des circonstances et en fonction de leurs intérêts à court terme. Les partis n’ont aucun contrôle sur les groupes parlementaires ou sénatoriaux, dont les membres sont des micro-entrepreneurs qui n’ont littéralement de compte à rendre à personne, ni à leur parti ni évidemment – encore moins – à leurs électeurs : le mandat d’un député est entièrement libre. Il a le droit d’avoir été élu sur le programme de la Nupes ou du NFP et de garantir la survie de Macron.
C’est d’autant plus facile pour lui de le faire sans sourciller que les cadres de ces partis sont profondément désidéologisés : les partis de gauche comme le PCF, les écologistes ou le PS ne sont en réalité par les vecteurs d’une pensée qui devraient infuser dans la société pour promouvoir un certain type de changement. Il s’agit d’entreprises qui tentent de survivre dans un marché concurrentiel et qui pour cela doivent à la fois affirmer la différence de leurs produits vis-à-vis des autres – pour cela elles peuvent en faire des caisses sur des éléments de folklore (logo, vêtements, slogans et tote bag) – tout en s’assurant d’être conformes à l’ordre existant, en respectant ses règles, pour ne pas être exclues des présentoirs voire tenter d’être placé en tête de gondole. Cette souplesse idéologique se retrouve dans les livres que les leaders de la gauche publient continuellement et qui sont généralement des échecs en termes de vente. Dans un article intéressant sur le sujet, le journaliste Mathieu Dejean montre que les livres de Faure, Tondelier ou encore Roussel sont en fait des recueils d’anecdotes destinés à faciliter la reprise journalistique. Un éditeur de ce genre de livres cité par Dejean explique que ces ouvrages ne sont pas des vecteurs de démonstration d’une idée ou d’un projet de société mais “un élément d’une communication globale qui appartient au politique. Ce sont des livres qui s’adressent beaucoup aux autres politiques, aux militants et aux journalistes”, explicite-t-il. La classe politique autonomisée n’a pas besoin de l’assentiment du peuple, même quand elle est de gauche. Elle n’a pas besoin de soutenir et de construire une pensée : elle doit simplement exister. Or, trahir c’est déjà exister. Trahir est même devenu un plan de com’ : Roussel qui tient des propos anti-pauvres, Ruffin qui s’affirme social-démocrate, Faure qui soutient Macron produisent des séquences médiatiques dont ils sont les (anti-)héros. Ce sont des moments gagnants-gagnants : les journalistes sont contents, leurs patrons bourgeois aussi et les politiques existent et survivent.

Est-ce que cela veut dire qu’il suffirait de soutenir et de favoriser des partis très idéologiques, avec des dirigeants cultivés et fins théoriciens, voire un poil sectaire, pour que la trahison n’arrive plus ? On pourrait penser que de Mitterrand à Faure en passant par Hollande, la gauche au pouvoir n’a été menée que par des hommes politiques dont le parcours en disait déjà très long sur leur inconsistance politique. Mais tout le monde s’accorde à dire pourtant qu’un homme comme Mitterrand était un fin théoricien, dont le célèbre ouvrage critique de la Ve République Le Coup d’État permanent traduisait un haut niveau de réflexion… mais sans effet aucun sur son exercice du pouvoir ultérieur puisque François Mitterrand n’a pas démocratisé la politique française, n’a pas décolonisé sa politique extérieure et n’a pas fait reculer l’emprise de la bourgeoisie sur nos vies, bien au contraire. La gauche unie de 1981 avait un programme commun très bien ficelé, et pourtant ça n’a pas empêché une trahison aux conséquences historiques, dont on paye encore le prix, de se produire. Car ce serait idéaliste de penser qu’avoir de bonnes idées suffirait pour être digne de confiance. Même les idées les mieux définies ne font pas le poids face à des intérêts et à des structures qui déterminent largement vos actions. La République bourgeoise produit cet effet : elle transforme les personnes qui l’intègrent, et sans engagement à changer radicalement les règles du jeu, on voit mal comment d’autres dirigeants, aussi estimables et respectables soient-ils et même s’ils jurent de “jeter les clefs de l’Élysée dans la Seine” sitôt élus, se comporteraient de façon fondamentalement différente.
Si nous nous contentons de concevoir la politique comme un commentaire de ce que quelques-uns font ou ne font pas, si notre engagement se limite à faire élire des dirigeants puis espérer qu’ils ne déçoivent pas, nous serons forcément à nouveau trahis. La trahison de la gauche n’est pas un problème moral, qu’on pourrait résoudre en remplaçant des personnalités douteuses par des individus fiables. C’est un problème de classe et de rapport de force. De classe parce que si nous ne sommes représentés que par des individus formés à Science Po Paris, qui vivent dans le confort matériel et dont les origines sociales et les indemnités parlementaires les situent parmi les 5% de Français les plus riches du pays, alors il est fort à parier qu’à la moindre occasion où ils auront à choisir entre fâcher les bourgeois qu’ils fréquentent de fait et rester fidèles aux classes populaires qu’ils ne perçoivent plus que comme des statistiques, ils choisiront les premiers.
Mais c’est aussi un problème de rapport de force dans la mesure où si la pire chose qui puisse leur arriver c’est d’être interpellé vertement par des influenceurs politiques sur Instagram et quelques militants fâchés sur X, la trahison leur semblera bien facile à vivre, voire relativement plaisante. C’est parce que nous avons fait des partis les seuls acteurs politiques de la gauche, en laissant les syndicats se spécialiser et se dépolitiser, en regardant les associations se draper dans une rassurante neutralité, en faisant du mouvement social un moment limité dans le temps et respectueux des règles, que nous sommes perpétuellement trahis. Les seuls moments où les partis de gauche n’ont pas trahi c’est quand ils étaient soumis à un mouvement social fort. Seule la constitution d’une force collective capable de faire trembler n’importe quel politique, du bord d’en face comme du nôtre, nous protégera de la trahison permanente.
Retrouver la confiance dans la politique c’est donc renouer avec notre propre puissance comme peuple. Agir directement le plus souvent possible et exercer une pression sur nos représentants quand nous n’avons pas d’autre chose que de confier notre souveraineté à d’autres. Si nous voulons que la politique cesse d’apparaître aux yeux du plus grand nombre comme un sujet ennuyeux qui ne les concerne pas, il faut commencer nous-mêmes par cesser de la réduire au spectacle d’une course, dont les spectateurs implorants espèrent tous les cinq ans que leur cavalier favori ne leur fasse pas faux-bond.

Nicolas Framont
Rédacteur en chef