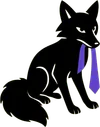Communistes, socialistes, anarchistes… Comment nous définir ?

C’est une question que l’on nous pose régulièrement, que cela soit par mail, sur les réseaux sociaux ou durant nos événements publics. “Êtes-vous anarchistes ?” “Pourquoi n’assumez-vous pas d’être communistes ?”, “Comment doit-on se définir ?”. Dans un premier temps, ce genre de questions déclenche chez nous une certaine réserve : pourquoi devoir forcément se coller une étiquette ? “Anticapitaliste”, entre autres caractéristiques de notre ligne, nous semble déjà suffisamment ambitieux à défendre. De plus, nous ne sommes qu’un média d’opinion qui représente une diversité de positions et de points de vue dans la lutte. Vouloir à tout prix se définir, choisir son camp, ses symboles, son auteur fétiche (et ensuite dire fièrement “je suis marxiste”, “je suis léniniste”, “je suis anarcho-libertaire tendance Makhno”) contribue pas mal à faire des militants de gauche radicale des ovni complets. Or, pour toucher son entourage et rassembler sa classe sociale, il faut rester accessible, accueillant, donc ouvert et non-dogmatique. Pour autant, dans cette même perspective, il est important d’être capable d’affirmer sa position, de laisser entrevoir la société pour laquelle on se bat. Cela ne suffit évidemment pas : à de nombreuses reprises nous avons souligné à quelle point les questions de stratégie (comment établir un rapport de force, comment prendre la main sur le débat public ?) et d’organisation (quel syndicat, quelles organisations pourront permettre de mettre le plus de monde possible en mouvement ?) sont essentielles pour avancer. Mais celle de la perspective défendue l’est également : ce n’est pas qu’un détail sémantique. Alors, comment se nommer ? Et surtout pour défendre quoi ?
“De gauche”, “vraiment de gauche”, “bien de gauche”
Le plus souvent, dans les conversations ordinaires, c’est l’expression “de gauche” qui va être employée, mais sans grand enthousiasme. Généralement, on se sent obligé de préciser “de gauche mais pas PS”, “vraiment de gauche”, “très à gauche”. Il faut dire que cette expression n’a jamais désigné une perspective politique en soi, ni même une stratégie, mais une position politique relative aux tendances existantes : on est de gauche par rapport à la droite. Le clivage droite-gauche a été fondé en France sur une question qui ne fait désormais plus débat : celle de savoir si, en août-septembre 1789, les députés voulaient accorder ou non des pouvoirs au roi. Ceux favorables à la monarchie se sont installés à droite du président et ceux qui défendaient la réduction de ses pouvoirs à gauche. L’ensemble des grandes questions politiques peut être réparti sur une échelle gauche-droite qui varie avec le temps. Par exemple, sur les questions socio-économiques : des années 1930 aux années 1980, toute une partie de la gauche défendait la sortie du capitalisme et sa partie la plus modérée une régulation du système et une économie mixte (qui combine des entreprises nationalisées et le maintien d’un secteur privé classique). Désormais, la gauche dite radicale défend la régulation du système et une économie mixte tandis que la gauche “modérée”, incarnée par le PS et les écologistes, a une fois au pouvoir augmenté l’emprise du capitalisme sur nos vies. Ensuite, on peut être très à gauche sur un sujet et à droite sur un autre : cela heurte nos conceptions de ce terme, un poil sacralisé dans les milieux militants, mais toute une partie de la population est par exemple très redistributive, partisane de la taxation des riches (proposition hélas radicale dans le contexte actuel, alors qu’assez peu dans l’absolu) mais fermée à l’immigration et favorable aux pouvoirs étendus de la police.
“Être de gauche”, c’est donc très relatif, cela manque de précision et surtout c’est largement associé à la sphère de la politique politicienne : car ce clivage droite-gauche existe d’abord dans la sphère politique officielle, celle de l’Assemblée nationale et des partis politiques. Or, nous assistons depuis deux décennies à un mouvement profond de désaffiliation de la population vis-à-vis de la politique institutionnelle. Non seulement de plus en plus de gens s’abstiennent, mais en plus ils s’identifient de moins en moins à l’étiquette de “gauche”.
Ce qui ne veut pas dire qu’ils ont majoritairement viré à droite : quand on demande aux gens ce qu’ils pensent de grands sujets de société (la redistribution des richesses, l’ouverture à l’immigration, l’acceptation de l’homosexualité etc), on constate au contraire qu’on a une population française nettement moins à droite, par exemple, que dans les années 1990. Ce n’est donc pas un manque d’idéaux de gauche, mais un manque d’identification à la gauche. Les explications possibles ne manquent pas : entre-temps, les gouvernements socialistes ou de gauche plurielle ont considérablement affaibli le terme de gauche, puisque des gouvernements “de gauche” ont mené des politiques “de droite”. La gauche apparaît de plus en plus comme une posture réversible et de nombreux dirigeants politiques qui revendiquent cette étiquette – on pense à Marine Tondelier ou Olivier Faure – s’avèrent incapable de formuler la moindre vision d’une société alternative… Car ils n’en ont pas et n’en veulent pas.

La désaffection envers l’identification à gauche n’est en fait pas du tout une mauvaise nouvelle : au contraire. Longtemps le mouvement ouvrier, en France comme ailleurs, a refusé de se positionner sur le clivage droite-gauche. Dans les publications, les discours et les chansons des communistes, révolutionnaires et syndicalistes du milieu du XIXe siècle aux années 1930, en France comme aux États-Unis, il n’était pas question de se dire “de gauche”. Ce n’est qu’avec l’intégration, controversée, du mouvement ouvrier aux institutions politiques républicaines bourgeoises, dans les années 1910-1920, que le mouvement ouvrier commence à exister sur un clivage politique, sans cesser de l’être principalement sur un clivage de classe. Sauf que depuis, le clivage gauche-droite a effacé le clivage de classe, comme il invisibilise et met de côté pendant longtemps d’autres clivages (de genre, de rapport coloniaux, etc.). C’est pourquoi un parti comme la France insoumise s’est distancié, à sa création en 2017, de l’étiquette de gauche : pour affirmer son contenu programmatique et sa stratégie distincte du reste de la gauche institutionnelle, elle s’est sortie du marasme philosophique que représente ce terme avant d’y retourner une fois une certaine hégémonie installée. Hégémonie hélas insuffisante face à la façon dont la bourgeoisie sait toujours mobiliser cette catégorie et y dispose de satellites qui ne cessent de neutraliser, par leurs revirements et leurs renoncements, cette expression.
Se dire de gauche ou de droite n’est pas inutile, loin de là. Au sein d’un débat spécifique, ces expressions disent encore beaucoup. Mais cela ne dit pas grand-chose de ce que l’on défend, et cela ne propose pas de perspective de long terme pour le collectif.
Socialiste
Le terme “socialisme” fait son apparition en Europe dans les années 1820 et devient, en France, très utilisé par le mouvement ouvrier à partir de la révolution de 1830 (qui aboutit à la chute du roi Charles X et l’arrivée sur le trône du dernier roi de France, Louis Philippe). C’est un terme qui désigne des courants de pensée assez différents tout au long du XIXe siècle mais qui ont pour point commun d’être portés par le mouvement ouvrier d’une part et d’impliquer d’autre part une transformation radicale de l’appareil productif par sa socialisation, c’est-à-dire sa mise sous contrôle des travailleuses et travailleurs, au détriment des capitalistes et donc de la bourgeoisie. Ce qui devait conduire en toute logique de la division de la société en classes sociales et, plus largement, à l’établissement d’une société où l’économie est mise au service des gens, collectivisée. Les stratégies pour y parvenir et les débats font rage tout au long du siècle, avec un grand coup porté par Marx et Engels qui tentent de mettre un peu d’ordre dans tout ça et rejettent dans le socialisme ses aspects “utopiques” pour apporter des analyses plus scientifiques du fonctionnement du capitalisme et des façons de le transformer en socialisme. Le terme “socialisme” est employé dans leurs travaux, ainsi que “communisme”, qui émerge quant à lui durant la seconde moitié du XXe siècle.
Sous l’impulsion de Lénine, la définition du socialisme évolue au début du XXe siècle : le socialisme devient un stade qui précède le communisme, un stade où l’État organise la socialisation de l’appareil productif, de façon à effacer les classes sociales pour aller vers le communisme intégral, stade ultime du développement humain.

Parallèlement à ce changement de définition programmatique, un changement s’opère sur le plan stratégique : en France, en 1920, la traduction politique du mouvement ouvrier, la Section française de l’Internationale ouvrière (SFIO, créée en 1905 pour rassembler les divers partis issus du mouvement ouvrier) se déchire entre les partisans d’une grève générale au sortir de la Première Guerre mondiale et ceux qui adoptent une position plus attentiste, plus “réformiste”, c’est-à-dire qui misent sur des changements progressifs de la société via la participation aux institutions plutôt qu’un conflit ouvert avec la classe possédante. À cette divergence stratégique s’ajoute une autre divergence liée à la création de l’Union soviétique et l’adhésion à la Troisième internationale lancée par Lénine. C’est de cette scission entre les deux camps que naît le Parti communiste français, tandis que la SFIO devient progressivement, au cours du XXe siècle, ce que nous connaissons sous le nom de Parti socialiste.

“Socialisme” est un terme initialement intéressant car il permet de déclarer son intention de changer la société via la transformation de l’économie et des rapports de production sans pour autant s’associer à un courant idéologique très identifié, en se laissant des ouvertures. C’est intéressant quand on veut, au XXIe siècle, construire un mouvement social et politique qui prend en compte des questions qui ne se posaient pas en 1920, comme l’écologie par exemple (le courant écosocialiste notamment est venu proposer une perspective nouvelle sur ce sujet-là). Mais le problème, c’est qu’en France, le XXe siècle et le début des années 2000 ont donné au mot “socialisme” une coloration très particulière : celle d’être le qualificatif de ceux qui choisissent systématiquement les options les moins conflictuelles et les plus modérées voire qui renoncent carrément à changer la société et vont dans le sens inverse. Ainsi, de nombreuses figures de la SFIO puis du PS prennent part à des agressions ouvertes contre la classe travailleuse, en toute décomplexion. Le bilan du “socialisme” français c’est les guerres coloniales, la financiarisation de l’économie sous Mitterrand, la fin de l’autonomie de la sécurité sociale sous Rocard et la diminution des droits des travailleurs sous Hollande – on pourrait également citer la défense du colonialisme que ce parti sous ses diverses appellations a globalement menée depuis l’après-guerre. Aussi ce terme nous semble particulièrement compliqué à réactiver, et ce d’autant que le Parti socialiste continue de sévir et d’agir en faveur de la classe capitaliste, même si, aussi étrange que cela puisse paraître, il parvient toujours à berner son monde (et il est grand temps, après un siècle de déceptions et de trahisons, de sortir de notre complaisance).
Communiste
A ce stade de la lecture, la solution semble toute trouvée : au regard de ce qui a été décrit précédemment – le caractère relatif et localisé du terme de “gauche”, l’histoire décevante du “socialisme” – c’est bien le “communisme” notre projeeeet ! Non seulement il implique la fin des classes sociales par la reprise en main collective de l’appareil productif, mais en plus le dépérissement de l’État bourgeois, si l’on en croit Lénine. Et dans son histoire, il a impliqué une certaine radicalité stratégique qui nous emmène enfin à la confrontation avec les possédants. Alors, qu’attendons-nous ? Pourquoi ne pas embrasser “ce gros mot de communisme”, titre d’un livre collectif sur le sujet, publié en 2021 et dirigé par Manuel Cervera-Marzal ? Dans cet ouvrage, Alain Badiou, Bernard Friot, Chantal Mouffe, Irène Pereira, Michel Pinçon, Monique Pinçon-Charlot, Slavoj Zizek ou encore Françoise Vergès, c’est-à-dire pas mal de gens dont nous estimons beaucoup les travaux, répondent à la question suivante : est-il possible et souhaitable de réinvestir le signifiant « communiste » ? Bernard Friot, Alain Badiou, Michel et Monique Pinçon Charlot ainsi que Slavoj Zizek (qui souligne au sujet du terme concurrent, “socialiste” qu’il “signifie simplement : « ne soyons pas trop égoïstes », « prenons un peu soin d’autrui » et d’autres banalités de ce genre.”) défendent l’emploi de ce terme. Tandis que les autres contributeurs de ce petit ouvrage passionnant et nuancé sont plus circonspects ou bien soulignent les insuffisances de la tradition communiste européenne, qui n’a pas su pleinement intégrer la critique de l’impérialisme et du colonialisme, comme l’expose Françoise Vergès, et pas la division genrée de la production où le travail domestique est encore largement dévolu aux femmes, comme le rappelle Irène Pereira.

Car comme “socialisme”, “communisme” a hélas une histoire. Cette histoire est ancienne, antérieure à la Révolution française, avec un “communisme” qui désignait des formes de fraternités populaires qui suscitaient la défiance de la bourgeoisie naissante. Il tombe un poil dans l’oubli avant de revenir avec force sous la plume de Marx et Engels dans leur fameux Manifeste du parti communiste. Au XXe siècle, nous l’avons dit plus haut, se dire communiste impliquait quasi systématiquement une adhésion aux régimes politiques qui s’en revendiquaient. Et c’est évidemment là que le bât blesse. Car si l’expérience “socialiste” est celle des trahisons, des renoncements et de la complaisance avec le capitalisme, contre la classe travailleuse (que cela soit en France, en Allemagne ou au Royaume-Uni), l’expérience “communiste” est elle aussi une expérience qui s’est avérée hostile aux classes sociales qu’elles prétendait défendre, puisque les classes ouvrières d’URSS, de Chine et d’ailleurs ont connu des conditions de travail dégradés, une impossibilité de se syndiquer (hormis des syndicats officiels) et la réduction de leurs droits politiques. On parle souvent de l’absence d’élections libres ou de liberté d’expression, mais les pays communistes étaient aussi répressif au travail, et on le dit moins : aucun de ces pays n’a réellement remis en question l’organisation du travail telle qu’elle était pratiquée sous le capitalisme, avec des systèmes hiérarchiques fort et des exigences de rendements. En URSS la gestion de la main-d’œuvre est autoritaire, avec quasiment aucune autonomie, y compris géographique, donnée aux ouvriers. Ces pays n’ont pas aboli les classes sociales et ont plutôt instauré des classes dirigeantes inamovibles. Seule la Yougoslavie a constitué un contre-modèle intéressant qui est passé par l’obtention d’un pouvoir réel par les travailleuses et les travailleurs. Mais dans les autres pays communistes, la trahison des idéaux initiaux a été grande. Ce qui a marqué les mémoires, c’est bien la violence étatique de ces régimes, dotés de polices politiques et de camp de travail. On peut aussi ajouter la violence impérialiste de pays qui, comme la Russie, ont anéanti les velléités d’autonomie de ses voisins (Géorgie, Ukraine, Hongrie, Tchécoslovaquie, etc.), même lorsqu’elles étaient portées par le mouvement ouvrier.

Dans quelle mesure la violence de ces régimes dits communistes était accidentelle ou bien intrinsèquement liée à l’application de doctrines contenant en elles-mêmes les germes de cette violence ? Ce débat fait rage et s’il est clair que les bourgeoisies du monde entier ont tout fait pour que le communisme soit ad vitam æternam associé à la violence, aux dictatures et au Goulag, une partie des partisans actuels du communisme alimentent un déni qui tend régulièrement à la mauvaise foi. Toute la violence interne à l’URSS ou la Chine serait liée aux pressions capitalistes extérieures. La folie des goulags serait liée à la personnalité perverse de Staline à lui tout seul. Pour sauver le terme “communisme”, il suffirait de dire que ces régimes n’ont rien à voir avec le communisme “originel” et basta, nous voilà tirés d’affaires. Mais si le monde intellectuel français tolère bien la mauvaise foi, surtout quand elle est amenée avec les bonnes tournures, ce n’est pas le cas de la population générale, et en particulier de la classe travailleuse dont les membres sont généralement sceptiques face aux explications alambiquées. Il nous semble que dans la mémoire collective, le communisme est associé à une expérience historique globalement négative. Et le mot est faible : pour toute une partie des Européens, notamment à l’est, le mot communisme est associé à des expériences terrifiantes et effroyables. En France, le mot est aussi lié à des expériences positives : le Front populaire, la sécurité sociale (mise en place par un ministre communiste), la Résistance (largement portée par les communistes)… mais comme le Parti socialiste, le Parti communiste est devenu un supplétif de la république bourgeoise, à laquelle l’actuel secrétaire générale Fabien Roussel ne cesse de donner des gages de respectabilité pour espérer obtenir son quart d’heure de gloire sur BFMTV tous les trois mois. Il est donc possible que le terme de communisme évoque, dans la population française, de la peur ou de l’ennui. Voir les deux. Ce qui fait dire à l’historienne de la révolution française Sophie Wahnich, dans le livre précédent cité : “Quant à l’élan que le mot “communisme” pourrait susciter, le doute est légitime : un mot peut-il produire de l’enthousiasme quand il évoque aussi l’effroi ? L’analyse scientifique des structures matérielles peut-elle engendrer un spiritualisme politique ?”
À l’heure où l’on parle de plus en plus de l’importance du désir et des affects en politique, et que les courants anticapitalistes ne renoncent plus à prendre en compte cet aspect-là des choses, peut-on sérieusement affirmer que le mot communisme peut nous faire vibrer ? Pour qu’il nous fasse vibrer à nouveau, il faudrait pouvoir lui redonner un nouveau lustre, le débarrasser de l’ennui et de la peur qu’il suscite. Et peut-être que nous serions disposés à faire ce travail si ce mot ne nous posait pas un second problème, qui n’est pas mince du tout.
Anarchiste
Ce problème tient à la question de l’autorité et de l’État. Si, comme “socialisme”, “communisme” possédait initialement un sens beaucoup plus extensif, basé sur l’idée de communauté et de fraternité (et que certains intellectuels et militants tentent de ressusciter, depuis les années 2010, en employant le terme “communs”), il a progressivement été théorisé dans un cadre plus restrictif, d’abord par Marx puis ensuite par Lénine. Le premier dirigeant de l’Union soviétique a, avant puis après la révolution russe, théorisé et pratiqué l’usage autoritaire de l’État pour mener à bien la socialisation de la production et la destruction des rapports de classe propres à la société capitaliste. Lénine et ses camarades ont usé et abusé de la police, au détriment de la justice, pour tenter de mettre au pas une classe dominante, mais aussi tous les groupes sociaux, y compris parmi la paysannerie et la classe ouvrière, qui n’étaient pas d’accord avec le processus lancé par les bolchéviks. Ils ont aussi éliminé les courants révolutionnaires et collectivistes concurrents du leur, comme les anarchistes et les socialistes révolutionnaires. Cette idée selon laquelle la fin justifie les moyens – et les moyens sont l’intervention de la force étatique – a teinté les pratiques de l’ensemble des régimes communistes par la suite. Pour “sauver la révolution”, pour “faire gagner le prolétariat”, une force étatique violente et arbitraire serait toujours nécessaire. Et d’une façon générale, pour socialiser la production, l’État central serait le plus à même d’obtenir justice et efficacité.

Cette pratique étatique violente, ce surplomb moral et politique (les masses n’étant pas suffisamment conscientes d’elles-mêmes pour faire les bons choix via des mécanismes de vote ou de délibération, de fait suspendus dans la plupart des régimes communistes) n’est pas simplement déniée par celles et ceux qui, aujourd’hui encore, pensent que le communisme du XXe siècle n’était pas si mal et peut constituer une source d’inspiration pour les luttes du XXIe siècle. Il nous semble qu’elle fait envie à un certain nombre d’entre eux. Et nous ne sommes pas les seuls à le sentir : la gauche anticapitaliste fait parfois peur pour cette raison. Car elle est souvent vue comme le camp de personnes dogmatiques qui pensent avoir raison contre tout le monde, être plus cultivées, plus formées, plus visionnaires et qui sauraient mieux que vous-mêmes ce qui est bon pour vous. Et hélas, la violence militante que nous documentons depuis les débuts de Frustration et qui a toujours suscité en nous défiance et dégoût en est une preuve quotidienne.
Au nom de la cause, l’autorité doit être utilisée et un État fort devrait nous aider à abolir les classes sociales (qu’elles le veuillent ou non). Non seulement cette position ne correspond pas à nos propres convictions, mais en plus elles nous semble totalement à rebours des aspirations populaires du XXIe siècle, dans des sociétés de fait beaucoup plus libertaires que celles du XXe, avec des individus qui veulent vivre libres, faire leurs propres choix et être acceptés comme ils sont. Et ils le sont d’ailleurs beaucoup plus, avec des discussions sur la libre détermination de ses aspirations sociales, de son genre, de son lieu de vie… Le mouvement des Gilets jaunes, moment révolutionnaire récent, était un mouvement anti-étatique et anti-autorité dont l’une des revendication majeure était la démocratie directe. Dans cet esprit-là, que l’on retrouve ailleurs dans le monde, notamment à travers les mouvements sociaux de la jeunesse de l’année passée, l’étatisme autoritaire sous-tendu par le communisme nous semble totalement à côté de la plaque, à la fois daté et déconnecté.
J’irai plus loin : c’est au contraire notre capacité à décrire une société qui combine autonomie individuelle et organisation économique égalitaire qui nous permettra de susciter l’adhésion du plus grand nombre, à commencer par la classe travailleuse. Actuellement, beaucoup de gens craignent que l’égalité tue la liberté, et que la socialisation de l’économie implique la fin des initiatives individuelles. La bourgeoisie alimente évidemment cette idée, trop heureuse de proposer une société “libre” où ne le sont en fait vraiment que ceux qui en ont les moyens. Mais si les systèmes alternatifs proposés ne tiennent pas compte de cette soif de liberté qui marque notre siècle, ils risquent de ne rencontrer aucun écho.
Dans ce cas, ne sommes-nous pas en fait anarchistes ?
Les anarchistes sont des perdants de l’histoire et cela les rend sympathiques. Le terme anarchisme désigne des courants très différents, situés partout dans le monde et aux modes d’actions divers, de la communauté autonome qui vit dans les marges à l’action terroriste de “propagande par le fait” (qui a quand même abouti, au début du XXe siècle, à plusieurs assassinats, notamment celui d’un président américain s’il vous plaît). Au début du XXe siècle en France les anarchistes sont pourchassés par les “lois scélérates”, tandis qu’aux États-Unis ils sont arrêtés et jugés pour trahison durant la Première Guerre mondiale. Durant la révolution espagnole, les anarchistes sont écrasés par les communistes staliniens qui préfèrent voire la République sombrer face au fascisme que de laisser une doctrine concurrente exister. Autant dire que ce courant a connu beaucoup d’obstacles et cela explique que l’on en entende trop peu parler.

D’une façon générale, la tradition anarchiste, qui traverse le syndicalisme américain (via les Industrial Workers of the World) et français (via la CGT de la fin du XIXe et début XXe), passe par deux grands principes qui nous sont effectivement chers : l’action directe, c’est-à-dire l’idée que les opprimés doivent agir par eux-mêmes, sans attendre les consignes venues d’en haut et en se passant le plus possible d’intermédiaires et de représentants. Mais aussi la défiance envers toutes les formes de pouvoir et son corollaire, le respect de l’autonomie individuelle vis-à-vis du groupe. L’idée anarchiste que le pouvoir corrompt implique une façon de vivre et pas simplement une perspective de société future. Hélas, dans le langage courant et sous l’influence d’une guerre idéologique contre l’anarchisme menée aussi bien par la bourgeoisie que par les communistes, ce terme est devenu synonyme de désordre ou d’égoïsme naïf. L’idée que le respect de l’autonomie individuelle produit nécessairement du chaos est profondément enracinée en nous, et en particulier dans notre organisation du travail qui, même dans le monde associatif, comporte des hiérarchies et des règles arbitraires.
Pour autant, pour ma part, je ressens une grande réticence à me dire anarchiste. Je trouve cela présomptueux : si être anarchiste c’est se méfier de tous les pouvoirs, à commencer par celui que l’on exerce sur autrui, comment peut-on décemment se penser digne de cette appellation ? Est-ce que se dire anarchiste, ce n’est pas déjà imposer un argument d’autorité à son interlocuteur, figer dans le marbre une idée qui ne peut pas être une identité car elle est toujours en devenir, elle est un combat permanent contre le petit flic et le petit patron en nous ? Est-ce que finalement, se dire publiquement anarchiste ne serait pas complètement contraire à l’idéal de l’anarchisme ?
A Frustration, nous avons aussi quelques réserves théoriques vis-à-vis de l’anarchisme : il nous semble qu’à l’inverse du communisme qui ne pense pas assez le problème de l’État, la plupart des courants de l’anarchisme se surfocalisent sur l’État, et en oublient bien souvent la sphère de la production capitaliste dans leurs analyses. Et il existe un anarchisme assez réactionnaire, comme celui de Joseph Proudhon, notoirement antisémite, individualiste et misogyne, ce qui explique sa récupération par l’extrême droite. Quel est l’idéal d’organisation sociale alternative sous-tendu par le terme “anarchiste” ? Je ne pense pas qu’il apparaisse clairement ou qu’il soit suffisamment connu, ce qui explique la très grande diversité des gens qui s’en réclament.
Collectiviste
À ce stade de notre réflexion, il est possible de faire un petit bilan de nos difficultés à trouver un terme qui nous définisse, et surtout qui produise trois choses à la fois :
1 – Une vibration émotionnelle positive chez nos interlocuteurs, en particulier celles et ceux de la classe travailleuse, et pas simplement les milieux militants (qui en font souvent aussi partie par ailleurs) ou les personnes diplômées qui ont un rapport enchanté à l’Histoire.
2- Une vision de ce à quoi la société pour laquelle nous nous battons pourrait ressembler.
3- Et si possible, une idée de la façon dont on compte s’y prendre pour y parvenir : les termes “communistes” et “socialistes” ont permis par exemple, durant la première moitié du XXe siècle, de distinguer les partisans d’un conflit ouvert avec la bourgeoisie et ceux qui souhaitaient obtenir des changements progressifs, dans le cadre des institutions.
Trouver un ou plusieurs mots qui portent tout cela et permettent ainsi de créer une identité collective et une envie d’agir ensemble n’est pas une mince affaire. Et cette mince affaire a souvent été laissée de côté à mesure que le milieu militant et intellectuel de gauche radicale s’est autonomisé vis-à-vis du reste de la population (c’est-à-dire qu’il vit dans son propre univers, avec ses propres règles, son entre-soi et ses validations internes). Ce qui est le plus souvent recherché à travers l’emploi de ces mots, ce n’est pas une pertinence politique ou une capacité à faire vibrer les individus, mais plutôt la démonstration de ses connaissances historiques, voire son respect de la tradition. Au PCF ou à l’Humanité, on est communiste de père en fille, de mère en fils, et on veut honorer ses anciens en ne lâchant pas le « C word« . Ailleurs, c’est un pareil : on rejoint les trotskistes et on tient à honorer le père fondateur de son courant de pensée. On est cadre insoumis et après avoir encensé Chantal Mouffe et le “populisme de gauche”, on se range derrière le terme de “gauche” depuis 2022…
Pour éviter ce fétichisme des mots, des traditions, des auteurs, pour éviter que pour qu’un mot fasse vibrer il faille avoir un bac+12 en historiographie militante, j’en suis venu à la conclusion qu’il était nécessaire que les mots que nous employons désignent le plus directement possible nos intentions, nos rêves et nos stratégies, pour qu’il y ait le moins de filtres et d’erreurs d’interprétations possibles entre ceux-ci et les mots que nous employons. Je crois que lorsque l’on doit clarifier excessivement nos mots (“de gauche mais pas PS”, “communiste mais pas nostalgique de l’URSS qui en fait n’était pas communiste”, “anarchiste mais pas au sens de chaos ou d’individualisme” etc.) on perd du temps et de la crédibilité. De plus, nous sommes dans les années 1920 de notre siècle. Certes, le XXe nous a marqué et on ne peut pas entièrement balayer son histoire, le capitalisme reste structuré selon les mêmes grands mécanismes mais des choses ont changé : la structure de classe n’est pas exactement la même, le colonialisme a pris de nouvelles formes, les luttes féministes et LGBT ont reconfiguré nos pratiques et notre langage… Bref, il n’est pas absurde de chercher des mots mieux adaptés à notre époque et moins recouverts d’une mémoire pas toujours réjouissante.

Lors de son discours d’investiture, le nouveau maire de New York, Zohran Mamdani, a appelé à remplacer “la froideur d’un rude individualisme” par “la chaleur du collectivisme”. Ce passage de son discours a fait couler beaucoup d’encre outre-atlantique, car il est sans ambiguïté : il ne s’agit pas d’un terme politicien creux comme le “vivre ensemble”. Il a des implications programmatiques fortes : le terme collectivisme, en français comme en anglais, implique la reprise en main de l’économie par le collectif, via l’État ou l’autogestion des travailleurs. En cela, il est l’antithèse du capitalisme, terme qui désigne la division entre le capital et le travail et implique un fonctionnement de l’économie entièrement tourné vers l’augmentation de la prospérité des capitalistes, via la recherche de profit. Le collectivisme est l’inverse de cette logique, et se dire collectiviste implique de vouloir sortir l’économie de l’emprise du capital. Nos confrères de Jacobin, magazine états-unien proche des démocrates socialistes dont fait partie Mamdani, ne nient pas que, comme les termes précédemment cités, “collectivisme” a une histoire compliquée, et contradictoire, du XIXe siècle où le mouvement ouvrier libertaire l’associait à la mise en commun des moyens de production, dans un cadre autogestionnaire, au XXe siècle où il a été associé à la politique de contrôle étatique de l’économie en URSS. Mais ce que pense Ben Burgis, qui signe l’article de Jacobin consacré au discours de Mamdani, c’est qu’“en vérité, la plupart des Américains ne sont pas historiens du XIXe siècle, ni des experts de la politique étatique sous Staline (…). Pour eux, “collectivisme” signifie “poursuivre une politique économique de gauche” (comme la détention collective des ressources et des efforts collectifs pour satisfaire les besoins des gens)”. Est-ce le cas en France ? Le terme français “collectivisme” connaît une dynamique moins forte que sa version anglaise (si l’on en croit les analyses lexicologiques de Google), mais est-il moins chargé d’histoire traumatique et d’un sens strict et dogmatique que “communisme” et “socialisme” ? Au sein de l’équipe de Frustration, les avis divergent. Ce que j’apprécie dans ce terme c’est qu’il ne prétend pas contenir en lui-même tout une vision politique : il concerne précisément la question de ce que l’on fait de l’économie, sans préciser de façon ultra détaillée comment on compte s’y prendre. C’est intéressant, parce que le terme collectivisme permet donc de produire des alliances entre des gens partisans de la socialisation autogestionnaire de l’économie comme nous (qui pensons que la fin du capitalisme peut se produire rapidement en confiant progressivement mais fermement le capital des entreprises à leurs salariés, et sans qu’ils puissent générer de profit individuel) et ceux qui pensent que l’État a encore un rôle indispensable voire central à jouer.

Le terme “collectif” connaît quant à lui une certaine dynamique dans le monde militant, en particulier dans les milieux écologistes. Il correspond à un type d’engagement répandu au XXIe siècle, plus distant des organisations, plus éphémères aussi, davantage centré sur des causes précises que des grands principes. Pour cela, le terme “collectivisme” pourrait faire écho à des aspirations à agir ensemble, dans le respect des individus, et à mettre l’économie au service des besoins humains et dans le respect de notre écosystème, ce qui est, toutes les enquêtes d’opinion le montrent, une revendication largement partagée par la population française, bien au-delà de celles et ceux qui s’identifient à la gauche. Il pourrait aussi prendre en compte les critiques formulées par Irène Pereira au sujet du communisme en intégrant totalement l’idée qu’une économie mise au service des humains et sans exploitation des travailleuses et travailleurs doit intégrer la fin de l’exploitation des femmes au sein de l’économie reproductive, c’est-à-dire le travail domestique qui permet à la société de fonctionner, mais dont pas grand monde ne parle. Je pense que cette question a été décrite de façon limpide par la chercheuse et militante féministe Aurore Koechlin dans une conférence sur le travail à Orléans, que vous pouvez visionner ici. Une société réellement collectiviste bannirait aussi l’exploitation coloniale du Nord vers le Sud, et combattrait donc les accords commerciaux inégaux et la division du travail mondiale qui confie le sale boulot (industriel, polluant, fatiguant) à certains en fonction de données racistes et coloniales.
Révolutionnaire
Le terme “collectivisme” ne résout pas tout, loin de là. Très centré sur l’économie et l’allocation des ressources, il n’aborde pas la question stratégique, qui est pourtant un point essentiel du débat. Doit-on obtenir des changements à l’intérieur des institutions existantes, largement conçues par et pour la classe dominante, ou tenter de les obtenir en s’y confrontant, par l’établissement d’un rapport de force conflictuel et externe aux cadres ordinaires du débat politique ? Et ce rapport de force peut-il s’obtenir par des moyens exclusivement légaux (la grève, la manifestation) ou doit-il comporter des excursions vers des pratiques illicites (sabotage, émeutes, violences envers les personnes, etc.) ? Ces questions divisent mais elles sont essentielles.
C’est ici que le terme “révolutionnaire” intervient : il permet de désigner des personnes ou des courants qui ne croient pas à la possibilité du changement par les recours institutionnels existants (essentiellement les élections, mais aussi le “dialogue social” en entreprise etc.) et envisagent des solutions plus conflictuelles. Ce qu’ils espèrent et ce pourquoi ils se battent, c’est une révolution. Une révolution c’est le renversement d’un régime et sa substitution par autre chose. Un processus révolutionnaire implique deux choses à la fois : la lutte contre le pouvoir en place et la création de pouvoirs parallèles susceptibles de le remplacer une fois la lutte réussie. Et des pouvoirs qui ne sont pas la simple reproduction des institutions en place mais qui proposent évidemment l’expression directe de la population et non le remplacement d’une “mauvaise” classe dirigeante par une “bonne”.
Le terme “révolutionnaire” a toutefois les défauts du terme “anarchiste”. Il contient une certaine prétention à être “plus radical que moi tu meurs” et son usage intempestif dans les productions de gauche radicale peut parfois faire sourire. D’aucun souligne que les révolutions font peur, que le terme peut sembler répulsif pour cette raison. Est-ce que ce sont des défauts dépassables ? Je le pense. Mais c’est un terme qui nécessite des précautions d’usage (ne pas l’utiliser gratuitement, ne pas trop en faire, préciser ce que l’on entend par là, etc.). Et un certain sérieux : si l’on se dit révolutionnaire, alors il va falloir sérieusement réfléchir à comment on compte s’y prendre pour mener une révolution.
Les mots ne font pas tout
Ce tour d’horizon sémantique me semblait important à mener car il n’a pas beaucoup de place dans le monde militant tel qu’il existe actuellement. Ce sont d’ailleurs souvent les mouvements sociaux qui produisent de grands progrès dans la conceptualisation que nous faisons de nos idéaux et de nos méthodes pour les concrétiser, tandis que le fonctionnement ordinaire du champ politique, intellectuel et culturel pratique la conservation des traditions, des histoires et des positions sociales permises par ces mots, souvent pour préserver leurs intérêts. Sans le mot “socialiste” ou “gauche”, les cadres du PS seraient depuis longtemps associés à ce qu’ils sont vraiment : des partisans du capitalisme, un peu plus modérés dans l’obsession d’augmentation des profits que leurs collègues macronistes, c’est tout. Actuellement, les mots nous trompent parfois plus qu’ils nous éclairent. Sur les réseaux sociaux, de nombreux féministes et militants LGBT soulèvent le fait que pour beaucoup d’hommes, se dire de gauche produit un “totem d’immunité” qui leur permet de couvrir leur sexisme, leur homophobie et leurs comportements dominants. Les étiquettes sont alors des affichages qui ne traduisent en rien des pratiques réelles, voire qui absout des pratiques contraires aux valeurs affichées : violences sexistes et sexuelles, management toxique ou encore mépris social et racisme.
Je suis de plus en plus convaincu que la démonstration d’idéaux implique de dire et de montrer, et donc d’incarner. Les étiquettes ne suffisent pas. Pour autant, elles ne sont pas inutiles, du moment qu’elles ne sont pas utilisées comme des dogmes et des façades.
Dans cette logique, je crois pouvoir dire en conclusion ce que je suis, à ce jour : je pense que l’économie ne doit plus être séparée de la majeure partie de l’humanité en étant la possession d’une minorité bourgeoise qui ne nous perçoit que comme sources potentielles de profit. Je crois que cette minorité capitaliste parasite nos vies, et qu’il faut lui reprendre l’allocation, l’exploitation et la répartition des biens et des services. Pour cela, je crois que la remise de l’outil de travail dans les mains de celles et ceux qui le font tourner est la solution la plus juste et efficace possible, notamment si l’on veut avoir des chances de stopper le changement climatique et y survivre. Mais je ne suis pas fermé à l’idée qu’une structure étatique, radicalement démocratisée (sans ministre, sans haut fonctionnaire, sans démocratie dite “représentative” mais avec une démocratie directe) fixe les règles selon lesquelles la production doit fonctionner pour répondre à nos besoins, dans les limites climatiques et le respect de l’écosystème dans lequel nous vivons. Par conséquent, je suis certainement collectiviste.
Par ailleurs, je pense que les institutions actuelles sont conçues pour que nous ne puissions jamais poursuivre un tel but. Soumise à la classe bourgeoise, elles ne nous offrent que des recours limités qui ne nous donnent aucunement la main sur le fonctionnement de notre pays et du monde. Tout ce que nous pouvons espérer, c’est que les “bonnes personnes” parviennent au pouvoir et aient la force de volonté de résister à toutes les contraintes que les institutions vont leur opposer pour qu’elles ne mènent pas leur programme à bien. Ça s’est produit à chaque fois que la gauche, même radicale, est parvenue au pouvoir ces dernières décennies, que cela soit en Grèce, au Chili, dans une moindre mesure en France, et je crois que c’est lié à l’absence de volonté claire de cette gauche de mettre à bas ces institutions avant qu’elles ne la transforment elle. Par conséquent, et puisque je trouve ce pari hasardeux (mais parfois je tente le coup en allant voter, et je le ferai sans doute à nouveau), je suis plutôt révolutionnaire : je crois que des grands mouvements sociaux capables d’instaurer un rapport de force par la grève, le sabotage et l’émeute sont plus susceptibles de changer profondément la société que des victoires électorales. Pour autant, je suis conscient qu’il n’existe pas, à ce jour, d’organisation révolutionnaire de masse en position d’encourager ce mouvement-là, et j’aspire à contribuer à sa construction. Ce qui fait de moi un révolutionnaire en devenir, un wannabe révolutionnaire collectiviste qui doute.
À travers ma façon d’écrire, de parler, de me comporter avec mes collègues, mes proches, le reste de la société et les animaux, je tente d’incarner ce collectivisme dans ma vie. Forcément, il est certain que je n’y arrive pas complètement, et c’est pourquoi je prends ces étiquettes avec des pincettes.
Et vous, comment pensez-vous qu’il faille se définir ?

Nicolas Framont
Rédacteur en chef