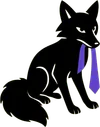Venezuela : l’attaque de Trump peut-elle amener la démocratie ?

Photo de Andrés Silva sur Unsplash
« Un mal pour un bien. » C’est l’argument martelé par des atlantistes chevronnés mais aussi des personnes qui suivent d’un peu plus loin l’affaire et sont touchés par les images de foules d’exilés vénézuéliens joyeux diffusés sur nos chaînes depuis samedi. Cet argument vient justifier une intervention militaire au Venezuela, le bombardement de Caracas et l’enlèvement du président Nicolás Maduro par l’armée américaine. Au nom de quoi ? D’un prétendu pas vers la démocratie et la fin de l’autoritarisme. Alors même que Trump n’a jamais mentionné cet objectif “démocratique”, c’est celui-ci qu’a mis en avant Macron en soutenant à 100% l’intervention américaine. Alors, qu’en est-il vraiment et que nous dit l’Histoire ? Une intervention étrangère peut-elle amener la démocratie ? Si l’on regarde honnêtement en arrière, on constate que ce type de violence arbitraire et illégitime constitue une blessure profonde et traumatique pour un peuple : elle radicalise les doctrines politiques et prépare le terrain à des régimes futurs plus violents et plus liberticides encore.
Double standard et précédents historiques
Le 2 janvier, le président des États-Unis, Donald Trump, a décidé de bombarder le Venezuela et de kidnapper son président, Nicolas Maduro. L’objectif affiché de Trump est la lutte contre le narcotrafic mais aussi le pillage des ressources pétrolières du Venezuela. En Europe et en France, les dirigeants refusent de « pleurer Maduro » au nom de la démocratie et de la lutte contre l’autoritarisme. C’est tout l’inverse d’une démocratisation à laquelle nous assistons.
La souveraineté n’est pas une récompense morale. Elle n’est pas accordée aux États jugés vertueux et retirée aux autres. Relativiser le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes au nom de l’autoritarisme, c’est ouvrir la porte à une hiérarchie coloniale des nations dont nous avons l’habitude : l’indécente défense constante d’Israël par les Occidentaux durant le génocide à Gaza (mais aussi depuis la création de cet État) est justifiée au nom de « la démocratie » malgré les multiples rapports d’ONG qui documentent un régime d’apartheid et des violences coloniales quotidiennes.
En Irak, l’invasion de 2003 a été justifiée par la lutte contre une dictature et la promesse d’une démocratisation rapide. L’historien Charles Tripp montre au contraire que la destruction de l’État irakien a provoqué l’effondrement des institutions, une radicalisation de plusieurs courants religieux et une violence durable, sans produire de régime démocratique stable. « Les élections irakiennes de l’après-guerre (…) étaient largement déconnectées des luttes de vie et de mort qui structuraient une politique beaucoup plus locale, violente et communautaire. »
En Libye, l’intervention de l’Otan en 2011, menée au nom de la protection des civils, a débouché sur l’effondrement total de l’État. Dans un rapport de l’Institut allemand pour les affaires internationales et de sécurité, le politiste Wolfram Lacher montre que l’absence d’un pouvoir central après la chute du régime de Kadhafi a permis à de nombreuses milices armées de s’imposer comme acteurs politiques et économiques, se partageant le contrôle territorial et des ressources, et alimentant ainsi une guerre civile prolongée et une instabilité durable.
Dans l’ensemble des exemples que l’on peut mobiliser, l’ingérence impériale ne produit jamais la démocratie, elle produit du chaos politique et une dépendance (provoquée) aux puissances étrangères.
Les « foules en liesse après la chute du tyran » : un classique de la propagande occidentale
Oui mais que faire des gens heureux de la chute de Maduro ? Les Vénézuéliens ne sont-il pas soulagés du départ de leur dirigeant ? “Et la parole des premiers concernés, alors ?” D’abord, les images que l’on nous montre mettent en scène des Vénézuéliens heureux à l’étranger tandis que d’autres, au Venezuela même, que l’on montre moins car l’accès aux réseaux sociaux et aux médias internationaux y est moins facile, manifestent contre l’intervention américaine. “Les Vénézuéliens” c’est comme “les Français” : ce n’est pas un groupe unifié, mais un ensemble traversé de différences de classes mais aussi des différences ethniques fortes, dans le cas du Venezuela. Aussi, tous n’ont pas les mêmes intérêts ni la même sympathie envers un régime initialement issu du mandat d’Hugo Chavez, dirigeant socialiste naturellement détesté par la bourgeoisie vénézuélienne. Ensuite, les images de foules en liesse sont un classique de la couverture médiatique des interventions occidentales dans les pays du Sud. On nous montrait une foule joyeuse après la chute de Saddam Hussein en Irak (“La présence de troupes américaines dans ce quartier de Bagdad ainsi que dans le secteur est de la capitale a donné lieu à des scènes de joie de la population, selon la télévision britannique, nous informait RFI), après celle de Mouammar Kadhafi en Libye (“Scènes de liesse en Libye”, titrait BFM TV en 2011) mais aussi en Afghanistan (“Depuis combien de temps Kaboul ne s’est-il pas senti aussi léger?” écrivait le journal suisse Le Temps en 2002). On connaît bien la suite.
L’Amérique latine, une histoire longue de souverainetés piétinées
Le Venezuela ne peut être compris en dehors de l’histoire latino-américaine. Une histoire marquée par des décennies d’interventions américaines, souvent justifiées par la lutte contre l’autoritarisme et/ou le communisme.
Au Chili, en 1973, les États-Unis soutiennent activement le renversement du président Salvador Allende, pourtant élu démocratiquement. Les archives déclassifiées, documentés par l’analyste du National Security Archive (Une ONG qui analyse et publie des documents déclassifiés de la CIA) Peter Kornbluh, montrent l’implication directe de l’administration Nixon dans le coup d’État qui ouvre la voie à la dictature de Pinochet. Au Guatemala, en 1954, la CIA orchestre le renversement du président Jacobo Árbenz après une réforme agraire perçue comme hostile aux intérêts américains. Cette intervention plonge le pays dans plusieurs décennies de guerre civile et de violence politique. Dans ces cas, l’ingérence n’a jamais renforcé les libertés politiques. Elle a systématiquement détruit les dynamiques politiques locales et installé des régimes violents ou profondément instables.
Le Venezuela s’inscrit dans cette continuité historique, où les USA considèrent l’Amérique latine comme un territoire qui ne peut s’affranchir de la domination étasunienne : c’est un parallèle que l’on peut faire avec la relation que la France entretient avec l’Afrique ou la Russie avec l’Europe de l’Est.
L’ingérence étrangère alimente et radicalisme l’autoritarisme local
L’un des angles morts du discours occidental est l’effet politique de l’ingérence elle-même. Les sciences sociales montrent que les pressions extérieures, les sanctions et les menaces militaires tendent à renforcer les régimes autoritaires, pas à les affaiblir. Concernant le Venezuela, plusieurs études ont analysé l’impact des sanctions économiques américaines. Un rapport du Center for Economic and Policy Research conclut que ces sanctions ont contribué à une dégradation massive des conditions de vie, frappant d’abord les classes populaires, sans avoir d’impact sur le régime en place. La politiste Julia Buxton souligne dans un article pour Le Monde diplomatique, que, malgré le soutien international, les pressions extérieures, notamment les sanctions, n’ont pas réussi à provoquer un changement de régime et ont au contraire été intégrées par le pouvoir comme justification des mesures répressives : « La perception selon laquelle la réélection du président Nicolás Maduro manquait de légitimité a conduit à des tentatives d’intervention internationale. Mais, malgré le soutien étranger, l’opposition demeure profondément divisée et le changement de régime rapide espéré ne s’est pas matérialisé. »
La « guerre contre le terrorisme » menée par les États-Unis et leurs alliés a fourni un cadre idéologique central à des interventions partout dans la région. En Irak, l’invasion de 2003 est justifiée par la lutte contre le terrorisme islamiste et la démocratisation du Moyen-Orient. Les recherches du sociologue irakien Faleh A. Jabar montrent que la destruction de l’État irakien et la marginalisation politique des sunnites ont directement contribué à l’émergence de groupes jihadistes, jusqu’à l’État islamique. « L’État islamique est à la fois un mouvement et une idéologie, et il reflète un courant social depuis longtemps présent au sein des univers arabe et islamique… Mais sa récente et fracassante montée en puissance est indéniablement liée à la crise de l’État irakien et à son impuissance, si ce n’est son opposition, face à deux revendications fondamentales : l’ouverture démocratique et l’intégration de la pluralité. »
C’est aussi le propos d’Alexander B. Downes dans son livre “Catastrophic Success: Why Foreign-Imposed Regime Change Goes Wrong” (Succès catastrophiques. Pourquoi les changements de régime imposés par l’étranger tournent mal). Analysant plus d’une centaine de changement de dirigeants obtenus par une force étrangère depuis deux siècles, Downes met en lumière les effets néfastes, à moyen et long terme, de ces changements obtenus par la force, notamment la survenue de guerres civiles sanglantes.
L’ingérence étrangère nourrit les idéologies radicales qu’elle prétend dénoncer. Elle transforme des régimes autoritaires en régimes assiégés, ce qui leur donne un second souffle. Les idéologies islamistes radicales ont profité de l’oppression des régimes sous perfusions occidentales (l’Égypte de Moubarak, la Tunisie de Ben Ali) pour s’ériger en martyrs et renforcer leur influence sur les couches populaires. C’est ainsi qu’au lendemain du printemps arabe et de la chute de ces autocrates, des partis islamistes sont arrivés au pouvoir dans plusieurs pays arabes.
Qu’on le veuille ou non, un peuple se libère toujours seul
Aucune recherche sérieuse, aucun exemple historique, ne montre que la démocratie puisse être imposée par la force militaire. Le peuple vénézuélien n’a pas besoin d’un sauveur américain. Il a besoin de conditions matérielles dignes, de la fin des sanctions qui frappent prioritairement les plus pauvres, et d’un espace politique permettant aux conflits sociaux et politiques de s’exprimer sans être écrasés entre un pouvoir autoritaire et une puissance impériale.
En réalité, aucune révolution ne peut exister sans une émanation populaire nationale. Cela n’exclut pas que l’ingérence étrangère puisse faire basculer un régime, mais c’est artificiel et ça ne tient pas. Pour que cela puisse perdurer, une réalité contestataire massive doit exister et se structurer, afin d’être capable de prendre le relai. Le printemps arabe n’aurait pas pu exister sans des mobilisations concrètes. Pour l’instant, l’opposition vénézuélienne à Maduro est prise au piège car ils se retrouvent, malgré eux, associés à l’invasion américaine, ce qui serait une mort politique garantie. Les bombes qui ont plu sur Caracas auront un impact politique bien plus long : celui d’une génération entière qui risque d’oublier les atrocités de l’autoritarisme car les Américains auront fait bien pire. À cela s’ajoute l’instabilité politique qui va régner et qui ne pourra créer les conditions d’un mouvement social et populaire de démocratisation des institutions du Venezuela. En réalité, l’intervention américaine a annihilé les chances de voir la démocratie triompher et rapproche le Venezuela du modèle fétiche de la diplomatie américaine : à savoir, un dictateur violent mais aligné sur les intérêts étasuniens, à l’image du tyran d’extrême droite, Nayib Bukiele, au Salvador.
« Refuser de pleurer » Maduro et s’arrêter uniquement sur la forme de l’intervention américaine et sur le non-respect du droit international, ce n’est pas une position équilibrée. C’est une manière commode de fermer les yeux sur l’impérialisme, tant que ses victimes ne correspondent pas à nos standards démocratiques occidentaux. Cette invasion va bien plus loin qu’une question de droit ou de démocratie, c’est une attaque coloniale qui va faire naître un régime arbitraire, soumis aux États-Unis mais avec un branding « démocratique » dans les médias mainstream.
Le combat pour la démocratie commence par un principe simple : aucun peuple n’a besoin d’être bombardé pour être libre car les peuples se libèrent eux-mêmes. À l’image de ce que l’on a vécu récemment avec les mouvements de la Gen Z qui ont mobilisé les peuples du Népal au Maroc contre la corruption et l’autoritarisme, ou encore les révolutions du printemps arabe qui ont inspiré un dégagisme puissant partout dans la région. C’est ce genre de mouvements contestataires qui partent du bas qui peuvent influencer les acteurs de la rupture partout dans le monde, et garantir une démocratisation des régimes autoritaires. Pas les bombes américaines.

Amine Snoussi