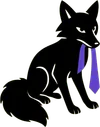Photo de Savannah B. sur Unsplash
Longtemps cantonné aux domaines militaire et psychiatrique, le psychotraumatisme est désormais une notion davantage mise en avant. Documentaires, films, séries, bandes dessinées, … les œuvres qui traitent de ce thème ne manquent pas. Ainsi, la série Des vivants (France TV, 2025) aborde la reconstruction et la mémoire traumatique de survivants des attentats du Bataclan en 2015. Le roman La vraie vie d’Adeline Dieudonné (Ed. de l’iconoclaste, 2018) explore quant à lui les réactions de protagonistes exposés à des événements traumatiques et à un environnement familial toxique. Si les traumatismes des vétérans de guerre sont une thématique abondamment illustrée – le film Da 5 Bloods de Spike Lee (2020) – le grand public a, sous l’impulsion de mouvements comme #MeToo, pris conscience que le psychotraumatisme dépassait largement le seul cadre des conflits armés. La libération de la parole autour des violences sexuelles, intrafamiliales ou institutionnelles a révélé l’ampleur des blessures psychiques et le manque de dispositifs d’accompagnement des victimes. Dans les sociétés capitalistes, caractérisées par de profondes violences systémiques, les situations traumatiques se multiplient et deviennent toujours plus visibles. Ces violences ne se limitent pas aux catastrophes spectaculaires, mais s’inscrivent également dans des formes diffuses et quotidiennes de domination : précarisation du travail, insécurité économique, discriminations systémiques, violences de genre et racistes, exposition permanente à la compétition, à la performance et à l’échec individualisé. Ce constat révèle une tension centrale d’un système économique qui produit structurellement du traumatisme tout en individualisant ses conséquences, en les traitant comme des défaillances personnelles plutôt que comme des effets collectifs et sociaux. Quand les conditions mêmes de notre sécurité psychique sont menacées, la visibilité croissante des traumatismes révèle les logiques sociales qui les produisent. Le trauma n’est alors plus seulement un problème individuel. Il devient un fait politique.
Qu’est-ce qu’un traumatisme ?
Dans sa dernière édition, le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM-5, éd. française Masson, 2015) définit le traumatisme psychique comme une exposition à la mort, à une menace de mort, à des blessures graves ou à des violences sexuelles. Cette exposition peut prendre plusieurs formes : vivre directement l’événement traumatique, en être témoin ou apprendre qu’il est arrivé à un proche.
Lorsqu’il s’agit d’une expérience isolée (ex : accident de la route), on parle de trauma simple. Quand nous sommes confrontés de façon répétée et intense à des événements traumatisants (ex : agressions sexuelles, inceste, violences conjugales), on parle de trauma complexe.
Le syndrome de stress post-traumatique (SSPT / en anglais PTSD) peut survenir après un traumatisme simple ou complexe. Le PTSD regroupe l’ensemble des symptômes durables qui peuvent se manifester de plusieurs façons : cauchemars, reviviscence, pensées envahissantes, amnésie partielle, variations de l’humeur, hypervigilance, sursaut exagéré, irritabilité, etc.
Il existe également des formes de PTSD avec des symptômes dissociatifs. C’est une réaction de survie : le cerveau va court-circuiter sa fonction “raisonnement” afin de préserver le corps des hormones de stress et éviter la mort. Souvent abstraite, cette notion de dissociation traumatique peut être illustrée ainsi :
Scénario A : Je conduis de nuit sur de petites routes de campagne. Soudain, une silhouette en mouvement surgit dans la lumière des phares, sur la bas-côté. Mes mains se crispent sur le volant, mon rythme cardiaque s’emballe. Merde, qu’est-ce que c’est ? Dans mon cerveau, l’amygdale libère des hormones de stress comme l’adrénaline et le cortisol. Or, lorsque ces hormones atteignent un certain seuil, la survie de l’organisme est en jeu : on peut littéralement mourir de stress. Heureusement, une autre partie de mon cerveau entre en jeu : le cortex préfrontal. Responsable des fonctions cognitives supérieures — raisonnement, organisation, prise de décision —, il analyse la situation pour lui donner du sens. Une pensée émerge : pas de panique… c’est sans doute un sanglier. Cette rationalisation apaise l’amygdale. Sous l’effet de cette régulation cognitive, la production d’hormones de stress ralentit, mon corps commence à se détendre. Peu à peu, mon calme revient et je peux poursuivre ma route plus sereinement.
Scénario B (Cette description peut heurter la sensibilité) : J’ai 9 ans, je joue seule dans le salon chez mon père. Celui-ci, après une grosse dispute au téléphone avec ma belle-mère, surgit dans la pièce et s’en prend violemment à moi. Mon pouls s’accélère, j’ai peur. Mon amygdale libère une quantité importante d’hormones de stress. Cette fois, mon cortex ne parvient pas à apporter du sens à une situation incompréhensible. Pour se protéger et ne pas laisser les taux d’hormones de stress monter en flèche (danger vital), mon cerveau va alors “disjoncter”, c’est-à-dire désactiver brutalement son système d’alarme. Il n’y a alors plus de douleur, plus de stress, plus de perception consciente de la menace. J’entre dans un état de dissociation qui me déconnecte de l’événement. Je deviens spectatrice de ce qui m’arrive, sans réaction émotionnelle ou corporelle. Avec le temps, cette coupure entre les émotions, les sensations et les souvenirs peut empêcher l’intégration de l’événement dans le vécu de la personne : le souvenir traumatique reste figé, comme s’il n’était pas “digéré” psychiquement. Ainsi, la dissociation peut se réactiver dans certaines situations. Un son, une odeur, un lieu ou une émotion similaire peuvent déclencher une reviviscence de l’expérience traumatique. Pour se protéger d’un flot d’émotions insupportables, le cerveau déclenche à nouveau la dissociation. La personne se sent alors détachée de son corps et de ses émotions. Parfois, la dissociation devient un mode de fonctionnement installé. Elle peut durer des mois, des années, voire une vie entière, sous des formes variées : sensation d’être spectateur·rice de sa vie, trous de mémoire fréquents, perte des repères temporels ou encore variations des états émotionnels.
Ces scénarios A et B offrent une vision très simplifiée du fonctionnement du cerveau. Ces deux illustrations restent donc approximatives. Néanmoins, elles permettent d’appréhender les effets physiologiques des traumatismes, comme une première porte d’entrée pour explorer la question de ce que les traumatismes font à nos corps.
Il est difficile de parler de nos traumatismes. La parole ne parvient pas à restituer pleinement la densité de la souffrance. Un traumatisme est fait de ressentis et de perceptions corporelles, des sensations qui peuvent venir se réactiver parfois dans des moments de vie très anodins. Je monte précipitamment les marches d’un escalier, cette action a pour effet d’accélérer les battements de mon cœur. La perception de ces battements rapides dans ma poitrine me connecte à d’autres moments durant lesquels mon pouls s’est ainsi accéléré. Me voilà replongé dans mon expérience traumatique. Le fait de repenser régulièrement à un événement qui nous a touchés ou blessés revient, sur le plan émotionnel, à le revivre à chaque fois.
La reconnaissance du traumatisme, de la guerre aux luttes féministes
Durant la Première Guerre mondiale, les médecins militaires observent d’étranges comportements chez les soldats rentrés du front : tremblements, cécité, paralysie, mutisme, attaque de panique, etc. Ces signes étaient souvent mal compris et mal nommés : on parlait alors de “shell shock” (choc des obus). Des dizaines de milliers de soldats en ont été affectés mais beaucoup ont été stigmatisés. Bien que la majorité des cas étaient liés à l’horreur des tranchées, les dirigeants militaires considéraient souvent ces signes comme des manifestations de faiblesse morale chez les soldats. Dans l’entre-deux-guerre, l’approche psychanalytique commence à théoriser les manifestations anxieuses post-traumatiques. La Seconde Guerre mondiale voit alors se développer de nouvelles approches thérapeutiques : “Proximity treatment”. Les soldats souffrant sont traités dans des hôpitaux proches des lignes de front, afin d’être réintégrés le plus rapidement possible dans leur unité… souvent en moins de 72 heures. En résumé, une tape sur l’épaule puis retour au chaos.
Des années plus tard, la guerre du Vietnam (1955–1975) a profondément marqué les soldats américains. Après les atrocités vues et commises, les militaires rentraient souvent isolés, sans soutien psychologique ni social. Les témoignages massifs des vétérans ont forcé la psychiatrie américaine à étudier ces cas.
Mais la première reconnaissance officielle du diagnostic de PTSD, en 1980, doit également beaucoup aux mouvements féministes des années 1970. Des psychiatres, psychologues et militantes féministes (comme Judith Herman, Lisa Hirschman ou Leonore Terr) dénoncent le silence entourant le viol, l’inceste, et les violences conjugales. Elles démontrent que les femmes victimes présentent des symptômes similaires à ceux des soldats traumatisés : peur, dissociation, troubles du sommeil, culpabilité, évitement et repli sur soi.
Les mouvements féministes ont ainsi mené un travail de visibilisation sociale de violences qui étaient, jusque là, minimisées voire ignorées par la psychiatrie car considérées comme des “événements privés”. Beaucoup de psychiatres et psychanalystes envisageaient alors les récits d’inceste ou de viol dans la petite enfance comme imaginaires et fantasmés, plutôt que comme des faits réels. Cette approche a eu des effets dramatiques : méfiance systématique envers les témoignages de victimes et pathologisation individualisante des femmes plutôt qu’une reconnaissance de la violence effective. Des pratiques encore largement répandues, alors que les dimensions traumatiques systémiques sont désormais mieux connues.
Je travaille comme infirmier dans un service de pédopsychiatrie à l’hôpital public. Mon équipe soignante accueille quotidiennement en soins des adolescent·e·s. Les dégâts causés par les traumatismes multiples – inceste, agressions sexuelles, maltraitances psychologiques – sont souvent au premier plan. En près de dix ans de pratique, j’ai pu constater de manière assez claire les impacts dramatiques que ces actes de violence peuvent avoir sur la vie des personnes.
L’inceste démontre le caractère social et politique du trauma
Entre 2021 et 2023, la Ciivise (Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants) recueille de nombreux témoignages de victimes. Le rapport final de la commission est remis au gouvernement français en 2023. Le travail de cette commission va révéler l’ampleur des violences sexuelles intrafamiliales. 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles chaque année, 5,4 millions de femmes et d’hommes adultes en ont été victimes dans leur enfance. L’inceste, les agressions sexuelles, les viols se passent, dans la grande majorité des cas, au sein même de la cellule familiale et sont commis par les pères, les beaux-pères, les grands-pères, les frères, plus marginalement par les mères. On recense presque 10 % de la population française qui dit avoir subi un inceste, et un tiers de la population française qui dit connaître quelqu’un qui a subi un inceste. C’est à peu près 6 millions de personnes et à peu près 3 enfants par classe. Le rapport final présentait, dans ses conclusions, 82 recommandations de politiques publiques visant à lutter contre ces violences systémiques, incluant notamment une refonte en profondeur des institutions telles que la justice et la protection de l’enfance. Une critique sans doute trop incisive de l’ordre institutionnel en place, peu appréciée par le gouvernement. Lequel choisira d’écarter les membres initiaux de la Ciivise – comme le juge des enfants Édouard Durand – au profit d’un effectif plus consensuel. Jusqu’ici, le rapport n’a produit que des effets d’annonce symboliques, sans aucune portée politique réelle — une manière d’enterrer le problème sous le vernis brillant de la communication politique.
Pourquoi les professionnels ne croient pas les victimes
Lorsqu’une patiente révèle à son thérapeute, dans l’espace de soin, qu’elle subit des violences ou des agressions, il arrive encore que le professionnel, pour des raisons diverses, choisisse de ne pas transmettre ces informations aux instances médico-sociales ou judiciaires. L’idée que “ce qui est dit dans l’espace thérapeutique reste dans l’espace thérapeutique” est encore profondément ancrée. Bien qu’elle soit justifiée à bien des égards, cette conception doit néanmoins être interrogée. Jusqu’où cette opacité peut-elle être maintenue lorsque la personne en soin est exposée à des violences, des agressions, de l’inceste ou de la maltraitance ? La sacralisation du secret thérapeutique est une notion complexe et requiert une réflexion poussée. Faute de celle-ci, l’espace de soin risque paradoxalement de contribuer au maintien du silence. Pour une personne qui trouve enfin le courage de révéler ce qu’elle vit, le fait que le thérapeute n’agisse pas ou ne transmette rien peut être vécu comme une nouvelle forme d’abandon : “Je parle pour la première fois, je romps le silence, et celui à qui je m’adresse demeure silencieux. Il confirme ainsi l’idée que mes paroles n’ont pas de valeur et que mes souffrances doivent rester tues.”
Ce silence s’explique par un faisceau de résistances. Dans certains milieux soignants, la parole des victimes est encore suspectée de relever du fantasme, en particulier celle des enfants, réputés manipulés dans les conflits parentaux. Le mythe du syndrome d’aliénation parentale — théorie bidon et imprégnée de biais patriarcaux — a longtemps servi à invalider des accusations pourtant fondées. À cela s’ajoutent le découragement face à une justice qui condamne moins de 7 % des violences sexuelles sur mineurs, et la crainte de sanctions disciplinaires. Même rares, les poursuites contre des médecins lanceurs d’alerte suffisent à installer un climat de dissuasion.
Du trauma à la puissance d’agir
Dans la définition officielle du DSM-5, seuls certains types d’événements – violents, soudains, menaçant la vie ou l’intégrité physique – sont considérés comme susceptibles de provoquer un symptôme de stress post-traumatique. Cela implique que le diagnostic clinique repose sur une typologie d’événements reconnus à priori comme “traumatiques”. Cette classification inclut un certain nombre de faits dont le caractère traumatique ne fait aucun doute : attentats, guerres, viols, accidents spectaculaires… Nul ne peut nier l’impact profondément dévastateur de ces expériences sur la vie des personnes. Mais cette définition officielle présente un angle mort : elle exclut de nombreux vécus susceptibles de produire des effets psychotraumatiques profonds.
Dans le langage de tous les jours, dans nos échanges avec nos proches et ami.e.s, on emploie fréquemment le terme de traumatisme. “Les cours d’E.P.S ont été pour moi un traumatisme scolaire”, “Ma relation avec mon ex m’a traumatisé”, … Cet usage courant n’est pas forcément abusif. Il est plus englobant et parfois plus fidèle à l’expérience vécue. Certaines de nos expériences négatives ne menacent pas toujours directement notre vie mais elles attaquent notre sécurité psychique, notre dignité, le sentiment d’existence et peuvent produire les mêmes désorganisations internes qu’un traumatisme “classique”.
Certains comportements traumatisants ne sont jamais considérés comme tels. Ainsi, dans le monde du travail, les employeurs-managers neutralisent la violence de leurs décisions par des phrases martelées comme des évidences : “Ça n’a jamais tué personne” (traduction : heures sup’ interminables non payées et pression sociale à rester tard). “Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts” (traduction : humiliation d’une stagiaire en réunion, requalifiée en geste pédagogique). Un harcèlement professionnel, des humiliations publiques répétées viennent désorganiser le rapport à soi, aux autres et au monde. La reconnaissance du traumatisme dépend de normes sociales, de cadres juridiques et de rapports de pouvoir. Certains événements sont validés socialement, d’autres sont niés ou banalisés, car ils ne rentrent pas dans les cadres de la souffrance légitime. Il est donc nécessaire d’élargir la compréhension de ce qui peut blesser durablement une personne.
Le parcours migratoire traumatiques d’un réfugié, les maltraitances d’un ouvrier surexploité, d’une population colonisée ou d’une femme victime de sexisme systémique ne sont pas reconnus par les instances médicales ou juridiques, pourtant ils s’expriment dans les corps et la psyché. Le DSM réduit le traumatisme à des catégories individuelles et ignore certains aspects pourtant fréquents comme le traumatisme relationnel. Issu des rapports de domination, il se manifeste dans de nombreuses interactions sociales. Or ses effets sur le psychisme sont profonds. Lorsqu’une personne se perçoit comme nulle ou incompétente, elle s’isole, convaincue d’être responsable de ce qu’elle subit. Cette intériorisation empêche toute projection vers des relations de coopération et renforce au contraire les logiques de domination. Tant que le traumatisme relationnel n’est ni reconnu ni défini — y compris juridiquement — ses effets sont individualisés et banalisés. La méfiance envers la relation devient alors une conséquence psychique durable : ne plus aller vers l’autre pour se protéger.
Pourquoi le DSM est-il si restrictif ? Parce qu’il est construit sur l’idée que le problème est localisé à l’intérieur de l’individu. Le diagnostic et le traitement médical sont donc attribués à un individu. Les structures de société qui génèrent les traumatismes ne sont ainsi jamais questionnées. Il existe pourtant des formes de sociétés pathologiques, des structures de domination chronique, des organisations du travail pathogène, des dispositifs institutionnels à forte toxicité sociale. Ces catégories collectives sont ignorées du DSM. Comme le souligne le psychiatre Mathieu Bellahsen dans son livre La Santé mentale. Vers un bonheur sous contrôle (La Fabrique éditions, 2014), le DSM ne reconnaît ni les « troubles de l’organisation du travail » ni ceux liés aux « politiques de management », alors que ces facteurs sont souvent au cœur de la souffrance psychique.
Une victime doit pouvoir reprendre sa place comme sujet actif. Les traumas détruisent le pouvoir d’agir et la confiance en soi. La reconnaissance sociale et la restitution du pouvoir décisionnaire est une première étape nécessaire d’une guérison qui n’est plus seulement individuelle. C’est la possibilité pour la victime de dire ce qu’elle a vécu, dans un espace sûr, et d’être reconnue dans sa parole. Reconnaître le traumatisme, c’est arrêter de rendre les victimes coupables. Reconnaître l’impact des violences structurelles (précarité, racisme, patriarcat, domination coloniale, etc. ) nous amène à questionner la manière dont les institutions génèrent elles-mêmes des traumatismes. Il se produit un déplacement de la responsabilité de l’individu vers les institutions, du soin vers la transformation sociale. La guérison contribue à construire des formes de résistance et à penser les soins politiquement. Politique désignant ici, non pas la politique politicienne, mais les façons dont une société s’organise collectivement pour structurer la vie de la cité, protéger et encourager la capacité des individus à se sentir reconnus, capables de penser et d’agir. Là où la clinique individuelle vise l’adaptation d’un individu à l’ordre établi, la politisation de la souffrance reconfigure les rapports sociaux pathogènes qui rendent les sujets malades. Le geste politique est un geste thérapeutique.
Maxime Devars
Contributeur extérieur