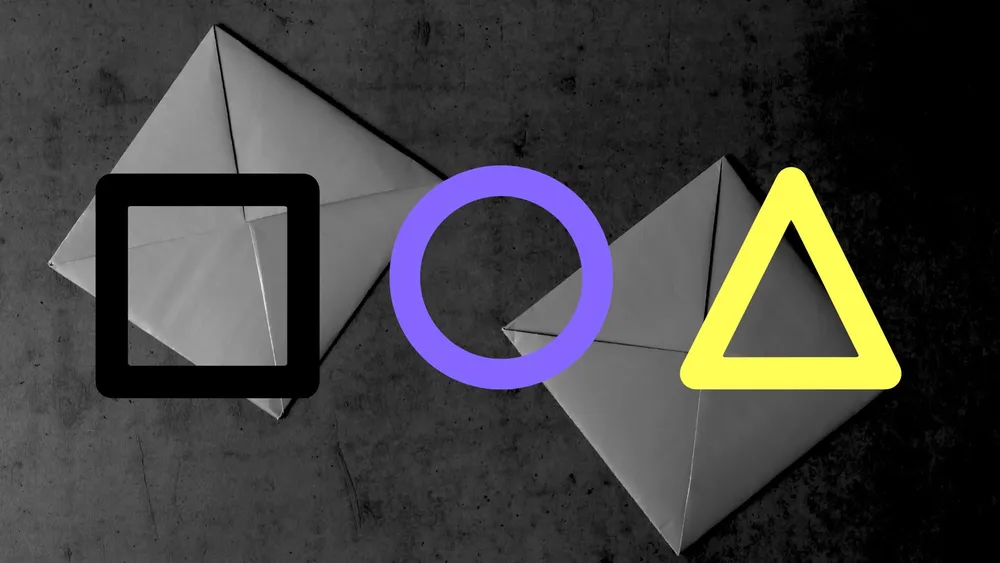
Lors de sa sortie, Squid Game, venue de Corée du Sud et distribuée mondialement par Netflix, a bénéficié d’un très fort engouement critique, y compris à gauche. Beaucoup y ont vu une dénonciation radicale du capitalisme : L’Anticapitaliste, journal du NPA, y lisait “une allégorie sociale” “profondément subversive”, tandis que Contretemps, revue de critique communiste, parlait d’une “allégorie de l’enfer capitaliste”. Mais la saison 3, véritable glissement dans le vide narratif, confirme un soupçon que certains formulaient dès le début : Squid Game n’était pas une critique du capitalisme, mais une intégration inoffensive de la critique par le spectacle capitaliste. Elle incarne ce que Guy Debord appelait déjà dans les années 1960 “la société du spectacle”, où la critique elle-même devient une marchandise et est ainsi neutralisée.
Dès la première saison, le décor est planté : des pauvres criblés de dettes s’affrontent dans des jeux mortels, observés par une élite masquée (les “VIP”). Mais cette “élite” n’incarne pas un système, elle incarne un fantasme : celui de quelques riches sadiques, gloutons, étrangers, décadents et déviants. Bref, une figure du “grand méchant complot mondial” version Netflix. Cette lecture conspirative du pouvoir, où le capitalisme devient un club de parieurs pervers, occulte la réalité : ce système ne repose pas sur la cruauté volontaire de quelques uns, mais sur des rapports sociaux objectifs. Squid Game ne parle ni du travail, ni de l’exploitation, ni de la propriété. Contrairement au film Parasite de Bong Joon-ho, qui montrait finement les logiques d’infériorisation spatiale, psychologique et matérielle entre classes, Squid Game ne s’intéresse (rapidement) qu’aux effets de la pauvreté, pas à ses causes structurelles.
Une révolution promise : l’espoir trahi de la saison 2
Et pourtant, un espoir avait surgi lors de la saison 2. Après avoir survécu à l’enfer, le protagoniste refusait de reprendre une vie “normale” et de profiter de sa fortune. Il faisait demi-tour pour faire tomber le système. Ce twist final avait ouvert une brèche : Squid Game semblait prêt à casser ses propres codes, à mettre en scène une contre-attaque, une révolution. La série promettait autre chose que la survie individuelle : une lutte collective et une prise de conscience politique. On s’attendait alors à une rupture esthétique et narrative : moins de jeux, plus de sabotage ; moins de suspense, plus de stratégie ; moins de morale, plus de politique. Cette attente n’était pas naïve : c’est le propre de toute œuvre de fiction de créer les conditions d’un basculement, d’une transformation. Et la série semblait avoir tout mis en place pour ça.

Mais la saison 3 renonce à cette promesse. Plutôt que d’explorer la possibilité d’une révolution, elle remet de nouveau en scène l’arène. Avec ses personnages, ses jeux, ses règles, mais sans nouveau sens. La révolte est trahie et par là aussi la critique anesthésiée.
Au-delà de la trahison politique de la promesse révolutionnaire, c’est aussi sur le plan narratif que Squid Game s’effondre. La saison 3 ressemble à un long tunnel sans rythme, et sans direction, avec une répétition des enjeux de la saison 1. Là où cette première saison exploitait habilement l’idée de “jeu à élimination” pour structurer le suspense, et où la saison 2 laissait entrevoir un renversement possible, cette dernière saison tourne en rond. Pas de montée en tension. Pas d’arc narratif fort. Juste une série d’épisodes qui semblent écrits pour tuer le temps et accessoirement capitaliser sur le succès des deux précédentes saisons.

Ce qui avait été esquissé dans la saison 2, une trame de soulèvement, une infiltration du système, une déconstruction du dispositif, s’est éparpillé dans toutes les directions, jusqu’à devenir une bouillie sans cohérence. L’ambition révolutionnaire a laissé place à une accumulation de scènes vides et de dialogues creux. Un des meilleurs exemples de ce naufrage est le retour du personnage du policier Hwang Jun-ho, censé être l’un des rares à pouvoir faire éclater la vérité de l’extérieur. Sa quête est censée tisser une intrigue parallèle, pleine de tension. Mais cette ligne narrative s’épuise rapidement, tourne à vide, et se termine dans une impasse grotesque. On dirait un copier-coller de la saison 1, en moins bien. Son enquête ne mène nulle part, ses actions n’ont aucune conséquence, et son sort final est traité avec une désinvolture qui frôle l’absurde. Sur internet, les internautes ne s’y sont pas trompés : le personnage est devenu un meme de l’inutilité, du flic qui “débarque toujours trop tard”, ou qui “note des trucs dans son calepin pour rien”.
Ce vide scénaristique, loin d’être un détail, est révélateur. Il reflète une logique industrielle : succès faisant, il fallait produire une suite, non pas pour dire quelque chose, mais pour continuer à vendre. Les enjeux n’évoluent plus, les règles du jeu ne sont même plus claires. C’est Squid Game, vidé de sa substance, tournant à vide comme une franchise épuisée à peine trois saisons après son lancement. Et ce vide n’est pas qu’un raté artistique : il est politique. Car en refusant de prendre au sérieux son propre récit, la série délégitime le désir de changement qu’elle avait pourtant mis en scène. Elle rend toute tentative révolutionnaire inutile, ou au mieux naïve. Elle dit, en creux : même ça, on ne sait pas l’écrire.
Moralisme contre anticapitalisme : la nature humaine, vraiment ?
Plutôt que d’interroger les conditions matérielles de la misère, Squid Game psychologise le capitalisme. L’avidité, la trahison, la survie deviennent des traits universels de la “nature humaine”. C’est une vision idéologique et idéelle du monde : faire croire que le capitalisme découle de la psychologie humaine, c’est le naturaliser.

Là où Les Sopranos proposait une réflexion subtile sur la manière dont les valeurs capitalistes (compétition, domination, cynisme) s’incarnent dans les sphères intimes (famille, amitié, sexualité), Squid Game ne produit qu’une morale simpliste : si le jeu est affaire de rapports de domination et d’inégalités (les organisateurs, les soldats, les VIP vs les joueurs), il ne fait qu’exprimer de manière violente une nature humaine avare, égoïste où, sauf rares exceptions (Gi-Hun et ses quelques alliés), “l’homme est un loup pour l’homme”. Cette vision empêche de penser les contradictions internes, les alliances possibles, les conditions réelles d’un soulèvement. Et cette morale aboutit à une impasse politique : l’idée que seuls quelques individus moralement supérieurs peuvent résister. On est dans une forme de vertu aristocratique, où la critique sociale est remplacée par un héroïsme individuel. La seule perspective offerte face à la révolution avortée est donc très classique : faire preuve d’une attitude éthique au sein d’un système vicié et immuable.
On aurait pu imaginer une autre direction, comme l’a fait Succession, peut-être à son corps défendant, série HBO inscrite dans un milieu ultra bourgeois. Évitant le narratif complotiste, Succession montrait des effets de structure sur les individus d’une classe : une violence sociale inscrite dans les liens familiaux, les logiques d’héritage et de propriété capitalistes, de pouvoir, de domination symbolique. Les personnages y sont attachants à leur façon, mais enfermés dans leur rôle, incapables de s’en extraire.
Questionner la place du spectateur ?
Squid Game prétend interroger la position du spectateur : nous serions comme les “VIP”, voyeurs complices, à l’aise dans notre canapé. Mais ce miroir est un leurre : il ne suffit pas de montrer ou dénoncer un mécanisme pour le dépasser. Ce que la série met en scène (la marchandisation de la souffrance) elle le reproduit aussitôt, et à l’échelle industrielle.

Comment croire à la sincérité du propos quand la série a généré jeux mobiles, télé-réalité (Squid Game: The Challenge), spin-offs, version américaine, produits dérivés… ? C’est la logique décrite par Mark Fisher dans Capitalist Realism : le capitalisme peut tout absorber, même ce qui le critique. Il ne craint pas les “messages”, il les recycle. Il les rend consommables.
Et si, au lieu d’ajouter des jeux, Squid Game avait cassé ses propres règles ? On aurait pu imaginer le prolongement du soulèvement des joueurs dans la saison 3 : une révolution en bonne et due forme. Cette sortie du cadre aurait été courageuse car elle aurait pris les attentes du spectateurs à revers (pas de nouveaux jeux), saboté le jeu au sein de la série mais aussi au delà : pas d’autres saisons, moins d’exploitation commerciale future. La série n’en aurait été pas moins divertissante, elle aurait à contrario été moins répétitive. Cette direction, c’est celle qu’a par exemple pris Matrix 4 où les sœurs Wachowski dénonçaient, au sein même du film, la franchisation par les studios d’une série de films révolutionnaires et tentaient par là même d’y mettre un terme.
Une critique de la démocratie intéressante, mais inaboutie
L’un des moments où la série effleure quelque chose de plus intéressant, c’est lorsqu’elle évoque l’illusion démocratique (la démocratie limitée au vote majoritaire), qui est peut-être davantage le sujet réel de la série plutôt que le capitalisme. Le vote, dans le jeu, est un simulacre : il donne une forme démocratique dans un cadre entièrement contraint, totalitaire, ultra-violent et aliénant. C’est une allégorie simple, mais efficace. C’est ce que les situationnistes appelaient la démocratie spectaculaire : un régime politique où l’apparence de liberté masque la réalité du contrôle. Dans son ouvrage Un complot permanent contre le monde entier, le philosophe Anselm Jappe la décrivait ainsi : “la démocratie spectaculaire est pleinement réalisée quand les intellectuels de gauche sont libres de discuter de Marx dans leurs journaux ou à la télévision et que les citoyens ont le droit de voter pour un président de gauche – qui, s’il était élu, serait obligé d’assumer la redoutable tâche d’adapter le pays au marché mondial en chute libre- pendant que d’autres citoyens, moins chanceux parce qu’ils ont pour domicile les rues ou les forêts où doit s’exercer le libre marché, sont traités avec des méthodes qui pourraient faire regretter les temps moins « démocratiques ». Aujourd’hui la liberté politique peut fort bien se combiner avec la répression sociale la plus féroce.”

En Corée du Sud, cette question est particulièrement aiguë : le pays incarne le modèle de la démocratie libérale face à la Corée du Nord totalitaire. Pourtant le pays n’échappe ni à la censure, ni à la répression des syndicats (d’ailleurs évoquée dans la série), ni à la précarité de masse. La grave crise politique déclenchée en décembre 2024 par la tentative par le président Yoon Suk Yeol d’imposer la loi martiale, a rappelé de manière brutale que des dispositifs purement formels ne sont pas la garantie d’une démocratie réelle. Mais cette désacralisation de la démocratie, qui peut se rendre coupable de bien des horreurs, ne se limite pas à la Corée du Sud : les exactions des Etats-Unis ou d’Israël en sont d’autres exemples.
Malheureusement cette critique reste secondaire et survolée dans Squid Game.
Capitalisme Netflix : récupération, cynisme, et le cas Severance
Squid Game est aussi un produit Netflix, c’est-à-dire une production calibrée pour l’exportation mondiale. Son casting international, son message universaliste (“la misère touche tout le monde, les riches sont tous les mêmes”), sa stylisation extrême sont des choix politiques. Ils participent de ce qu’on pourrait appeler un universalisme cynique : une forme de fausse neutralité globale qui gomme les conflits réels.

Squid Game n’est pas un cas isolé. Severance (Apple TV+) semble suivre la même direction. La saison 1 délivrait une véritable critique du travail aliéné. La série imagine une entreprise où les employés sont scindés en deux : leur “moi de bureau” ne connaît rien de leur vie personnelle, et inversement. À partir de ce postulat, elle exposait frontalement l’aliénation et le sentiment d’absurdité du travail salarié de bureau. Le spectateur pouvait relier cette fiction à ses propres conditions de travail. Alors que la fin de saison 1 promettait, elle aussi, une révolte, la saison 2 s’est évertuée à répéter les enjeux de la première saison. Elle s’est refermée sur son propre univers et a dilué sa critique sociale au profit d’un univers de science-fiction de plus en plus ésotérique, où la question du capital devient l’objet d’une intrigue sectaire et mythologique. En insistant sur les secrets de Lumon Industries (l’entreprise fictive de la série), la série a en grande partie cessé de parler du travail tel qu’on le vit souvent aujourd’hui et la métaphore a perdu de sa force.
De la même façon Squid Game avait semblé nous promettre une critique du monde capitaliste, de son idéologie de compétition et d’avarice, elle semblait aussi vouloir interroger notre position de spectateur et de passivité, notre “servitude volontaire”. Elle se sera, au final, contentée de livrer un décor. Elle avait promis une révolution, elle a offert une suite. Elle avait promis de dénoncer l’inhumanité du système, elle a fini par en faire un pur produit bientôt répliqué à l’infini. Or Catharsis n’est pas critique : si des métaphores peuvent aider à appréhender le capitalisme, encore faut-il qu’elles intègrent l’idée que celui-ci peut être combattu réellement et avec des rapports de force.
Par Rob Grams et Farton Bink
Photo de couverture : Farton Bink
Rédaction

