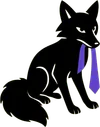« Petite p*** » : Puisque Saez est vieux et condescendant

Écouter “P’tite Pute” de Damien Saez, c’est encaisser en pleine gueule le pire de la critique sociale paresseuse, le genre de laïus qu’un vieux mec te mansplain à 3h du mat’ dans une cuisine trop petite, et que tu rejoues ensuite sous la douche en l’insultant, lui, son père et toute sa lignée jusqu’à la septième génération. Sortie en 2018, la chanson se veut une diatribe contre la société du spectacle, l’aliénation des réseaux sociaux, l’exposition des corps et des vies comme marchandises. Mais la cible choisie trahit tout : au lieu d’attaquer les vrais responsables de la marchandisation du monde : plateformes, logiques de profit, capitalisme, Saez s’en prend à des femmes, et plus précisément aux influenceuses. Le tout résumé dans deux mots aussi nazes que l’artiste : « p’tite pute ». Une insulte vieille comme le patriarcat, qui dans sa grande bouche condense misogynie, putophobie et mépris de classe. Derrière le masque du poète rebelle se cache en réalité un vieux réflexe : taper sur les individus et plus particulièrement sur les victimes quand on prétend critiquer un système.
Qui est Damien Saez ? Et c’est quoi cette chanson ?
Damien Saez, c’est l’éternel « poète maudit » de la chanson française, qui rôde dans le coin depuis les années 2000, et traîne une réputation de marginal inspiré, héritier autoproclamé de Rimbaud et Ferré. Sa posture, c’est celle du rockeur dépressif qui crache sur la “s o c i é t é”, sur « les moutons », sur « l’idiocratie ». Mais derrière cette image, il y a un fond creux, une posture adolescente qui confond cynisme et profondeur. Dans “P’tite Pute”, il fait mine de dénoncer l’exposition narcissique des réseaux sociaux, mais choisit de cibler une figure bien précise : les influenceuses, l’incarnation bien commode d’un monde superficiel.
Constatons ensemble la taille de l’énorme cerveau de Damien Saez : « Mes vacances sur des yachts, j’prends mon cul en photo / Pour faire bander la terre, pour des millions d’prolos ». Voilà donc l‘immense charge poétique de notre bonhomme : traiter une femme de pute parce qu’elle poste des photos d’elle en vacances. Mais ce qui saute aux yeux ici, c’est l’instrumentalisation crasse de la figure du « prolo ». Dans son discours, « les prolos » apparaissent comme les pauvres idiots manipulés, qui bandent sur Instagram et se font plumer par les influenceuses. C’est une rhétorique classique de la gauche moralisatrice qui adore parler « au nom du peuple » tout en le décrivant comme un troupeau de cons. Et c’est encore plus comique venant de Saez, puisque cette posture de « poète des prolos trahis » est précisément son fond de commerce depuis vingt ans. Il vend ses albums, ses concerts et sa posture en se drapant dans la défense des opprimés, alors même qu’il les réduit ici à des masses abruties qui se font “avoir” par les femmes. Autrement dit : Saez tokenise « le prolo » puis reproche à des femmes d’utiliser leurs corps pour conquérir ce même prolo.
La pochette de l’album “Humanité” enfonce encore le clou : une jeune femme, au visage presque juvénile, trop juvénile même, au point de donner l’impression qu’elle pourrait être mineure, grimée avec tous les clichés de « la putain » : rouge à lèvres agressif, décolleté appuyé, croix autour du cou comme provocation facile. On la voit arme à la main, la mise en scène jouant sur le mélange de suggestion sexuelle, de violence et de mort. Bref, un fantasme misogyne d’ado attardé : le corps féminin réduit à une icône de décadence, une « mauvaise fille » offerte au regard, sexualisée et criminalisée tout à la fois. Ce choix visuel n’est pas neutre : il matérialise le même procédé que dans les paroles, où Saez prétend dénoncer « la société » mais finit par incarner le mal dans la figure d’une femme. Pire encore, en choisissant un modèle qui semble à peine sorti de l’adolescence, il renforce l’imaginaire pédocriminel qui fétichise les jeunes filles sexualisées, une esthétique lourde de sens, qui en dit plus sur les obsessions masculines que sur la critique sociale.
Bref, un cliché qui fait r é f l é c h i r.

Individualiser un problème systémique pour meurtrir les femmes une à une
Le fond du problème, c’est que Saez prend un phénomène systémique, la marchandisation de soi à l’ère du capitalisme numérique, et l’incarne dans des figures individuelles, toujours féminines. Les influenceuses deviennent la cause, alors qu’elles ne sont que le symptôme. C’est exactement ce que dénonce Silvia Federici quand elle rappelle que le capitalisme se nourrit de la mise au travail des corps, et que ce n’est pas les individus qu’il faut viser, mais les structures. Or ici, Saez fait l’inverse : il transforme en cible des femmes précaires, souvent jeunes, souvent issues de classes populaires ou racisées, qui trouvent dans l’influence une manière de survivre et d’exister socialement.
Il ne dit rien du système qui rend cette exposition rentable. Rien sur les agences d’influence qui exploitent les jeunes femmes. Rien sur les algorithmes de Meta ou de TikTok qui organisent la visibilité des corps comme marchandise. Non : à la place, il écrit « J’ai rien fait dans la vie qu’vendre mon cul sur la toile / Ouais mais les populaires me prennent pour une étoile ». Voilà l’ennemi désigné : une femme qui ose tirer profit de son image. C’est une inversion totale : la victime devient coupable, la proie devient prédatrice.
Ce choix n’est pas un accident : il relève d’une tradition misogyne et putophobe vieille comme le monde. Depuis toujours, quand on veut dénoncer une société décadente, on pointe du doigt « les femmes », accusées d’être vaniteuses, superficielles, corrompues par le luxe ou les apparences. Saez rejoue exactement cette partition : « Gueule photoshopée, mettons qu’ça fait rêver / Le peuple aime bien liker quand y s’fait enculer ». Ce n’est pas une critique des structures, c’est une haine ciblée des corps féminins, mis en scène comme la racine du mal.
Cette mécanique est vieille comme le patriarcat : opposer les « femmes respectables » aux « putes », diviser pour mieux régner. Saez perpétue ce schéma avec la légèreté d’une enclume jetée dans une piscine pour enfants. Et ce n’est pas anodin. Dans un contexte où les travailleuses et travailleurs du sexe subissent précarité, stigmatisation sociale, violences (quand ce ne sont pas carrément des meurtres), utiliser leur condition comme insulte est une agression supplémentaire. Ce n’est pas de la poésie, ce n’est pas de la critique sociale : c’est de la complicité avec le système qui les opprime. Derrière ses airs de rebelle, Saez crache en chœur avec les flics, les juges et les moralisateurs sur les tombes de nombreuses travailleuses du sexe.
Chier sur les influenceuses : un sport de vieux mecs blancs
Ce que fait Saez, Beigbeder le fait aussi. En 2020, le chroniqueur mondain publiait dans Le Figaro un article imbuvable sur le livre de Léna Mahfouf (Toujours plus), où il se donnait le plaisir de mépriser une jeune femme racisée, autodidacte, issue des classes populaires, qui avait réussi à fédérer une communauté. Sa critique ne s’attaquait pas au capitalisme éditorial, ni aux maisons qui transforment les youtubeuses en produits : elle se concentrait sur Léna elle-même, comme si elle incarnait à elle seule la médiocrité contemporaine. Même mépris de classe, même misogynie masquée en critique culturelle, même plaisir de rabaisser une femme visible.
Plus loin, elle se vante même : « J’trinque au Dom-Pé’ qu’j’me suis fait sur ta gueule / Quand j’t’ai fait raquer, oui ton propre cercueil ». On voit bien la mécanique : Saez ne rit pas du capitalisme mondain, ni des milliardaires réels qui se gavent dans les yachts et les jets privés, mais de cette femme fantasmée qui, dans sa fiction de mec chelou, se réjouirait de plumer « les prolos ». Autrement dit, il lui colle sur le dos la responsabilité des inégalités sociales. Et c’est précisément là que le tour de passe-passe idéologique est violent : transformer une victime en coupable, une figure dominée en incarnation du Mal contemporain. Saez dépeint les influenceuses comme des vampires qui se nourrissent de la misère populaire. C’est du même tonneau que Beigbeder quand il écrivait sur Léna Mahfouf dans Le Figaro : derrière le masque de la critique culturelle, c’est toujours la même obsession de trouver une femme jeune, visible, populaire à crucifier, plutôt que d’attaquer le système qui les instrumentalise.

Et ce mépris n’est pas seulement genré, il est aussi racialisé. Quand Beigbeder s’attaque à Léna Mahfouf, il ne peut ignorer que son succès bouscule les circuits de la culture bourgeoise. Quand Saez crache sur « les petites putes d’Instagram », il ne vise pas les mannequins blanches en contrat avec LVMH, il vise celles qui sortent du lot sans passer par la case « légitimité culturelle ». Toujours la même logique : les dominants se croient subversifs quand ils tapent sur les dominées.
Le héros edgy d’une idiocratie fantasmée
Dans son délire prophétique, Saez se présente comme un pourfendeur de l’idiocratie, comme le dernier poète lucide dans un monde d’abrutis. Ce rôle, il le cultive depuis longtemps, un exemple parfait et crasseux du boomer hydrocéphale. P’tite Pute, ce n’est pas un pamphlet, c’est une insulte recyclée. Saez s’imagine viser le système, mais ses balles finissent toujours dans le dos des femmes. C’est ça, son grand geste de rebelle : rejouer les insultes du patriarcat, traiter de « pute » et de « michto » comme n’importe quel boomer à 3 grammes. Le capitalisme n’a rien à craindre de Saez : tant qu’il y aura des vieux poètes maudits pour détourner la colère contre les victimes, il pourra continuer à prospérer tranquille. Voilà la vérité de ce morceau : un pamphlet raté, une haine recyclée, un rebelle de pacotille.
Farton Bink
Vidéaste et autrice