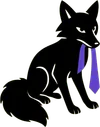Contre le capitalisme funéraire, sortir la mort du marché. Entretien avec le Collectif pour une Sécurité Sociale de la mort

Le Collectif pour une Sécurité Sociale de la mort se bat pour l’extension de la sécurité sociale à un sujet qui concerne tout le monde un jour ou l’autre, à savoir la mort, en particulier sur tout ce qui concerne les obsèques mais pas seulement. Dans un livre passionnant intitulé Le Coût de la Mort (éditions du Détour, 2025), les deux cofondateurs du collectif, Alban Beaudouin et Jean-Loup de Saint-Phalle, reviennent sur la manière dont, dans le capitalisme, la mort a été incroyablement marchandisée, donnent accès à des témoignages précieux et proposent des alternatives très concrètes. On en discute avec eux.
“La mort est un lieu de lutte de classes”
Au début du livre, vous écrivez que « la mort est un lieu de la lutte des classes ». Qu’est-ce que cela signifie concrètement aujourd’hui en France, et comment les inégalités sociales se prolongent-elles jusque dans la manière de mourir et d’être enterré ?
Jean-Loup de Saint-Phalle : La mort est véritablement un objet intersectionnel, au sens où plusieurs phénomènes structurels s’y croisent et s’y cumulent. Très concrètement, la mort n’est pas la même pour tout le monde. D’abord, les plus pauvres meurent plus tôt. Les travailleurs et travailleuses des métiers les plus pénibles ou les plus dangereux ont une espérance de vie plus faible ; ce sont aussi des familles qui sont confrontées plus tôt à la mort d’un proche. On pense souvent l’espérance de vie de manière individuelle, sans toujours avoir en tête à quel point ce facteur social est massif et concret.
On dit souvent que la mort est « la grande égalisatrice », que nous serions tous égaux face à elle. Mais dans les faits, il existe une forte pression sociale à se conformer à des standards bourgeois en matière d’obsèques — au sens historique du terme. Dès le XIXᵉ siècle, se met en place une logique d’ostentation funéraire : monument, capiton, cercueil de qualité, emplacement visible au cimetière, souvent près de l’église, pour signifier la dévotion à la famille, à la lignée. Et cette norme s’impose à tout le monde.
À l’inverse, des obsèques très sobres — comme celles qui existent dans de nombreux pays musulmans, par exemple — ont fini par être perçues en France comme un signe de pauvreté ou de pingrerie. Résultat : même des familles modestes sont incitées à investir beaucoup d’argent dans les funérailles. Il existe bien des obsèques dites « low cost », parfois revendiquées comme telles, mais en réalité elles ne sont pas si peu chères si on les compare aux coûts moyens. Une fois payées les fournitures obligatoires — inhumation ou crémation, cercueil, démarches administratives —, la plupart des familles ajoutent malgré tout un capiton, des fleurs, un minimum de marbrerie. Il y a une incitation générale à consommer, au moment du décès, pour montrer aux autres — et à soi-même — qu’on tenait à la personne.
Ce qui pose problème, c’est que contrairement à la naissance, ce moment n’est absolument pas pris en charge par la collectivité. Ce rituel, qui consiste à consommer pour prouver l’amour porté au défunt, devrait être financé par la cotisation et non pas par le porte-monnaie. De facto, cela pénalise les plus pauvres.
Un autre élément très important concerne les contrats de prévoyance obsèques. En France, ce sont majoritairement les ménages modestes qui y ont recours. La sociologue Pascale Trompette l’a bien montré : dans près de 80 % des cas, ces contrats ne servent pas à préciser des prestations particulières — le type de cercueil, les détails de la cérémonie — mais simplement à prendre en charge le coût de sa propre mort pour ne pas peser sur ses proches. Il y a cette phrase, à la fois banale et extrêmement violente, qui revient souvent : « Je ne veux pas être une charge pour mes proches. » Et elle est particulièrement présente dans les classes populaires.
Ce rapport à la mort est très culturel. Il n’existe pas de la même manière en Afrique du Nord ou en Afrique de l’Ouest, où les systèmes de tontines — des caisses collectives — permettent de financer les obsèques de chacun. J’en parlais avec le journaliste Théophile Kouamouo, qui expliquait que, dans son pays d’origine, être une « charge » au moment de sa mort est presque une fierté : les funérailles doivent être coûteuses, festives, quel que soit le statut social du défunt. La mort y revêt un caractère sacré qui dépasse la seule question religieuse.
En France et en Europe, cette logique est relativement récente. Elle s’est imposée au fil des dernières décennies, sous l’effet de la marchandisation de la mort. Et paradoxalement, ce sont les plus pauvres qui s’endettent le plus : auprès des assurances, des banques, des pompes funèbres, à travers ces contrats de prévoyance. Plus on est précaire, plus on est incité à payer à l’avance — souvent plus cher que le coût réel des obsèques — pour ne pas être un poids pour les siens. Les riches peuvent dépenser davantage pour des matériaux rares ou des monuments prestigieux, mais les pauvres, eux, paient plus cher pour ne pas déranger. C’est en ce sens que la mort est bien un lieu de la lutte des classes.
Le marché funéraire : une marchandisation de la détresse
Justement sur cette marchandisation : vous montrez que l’ouverture à la concurrence du secteur funéraire a été justifiée au nom de la liberté du consommateur. Or vous montrez aussi que l’endeuillé n’est pas un consommateur comme les autres. En quoi cette idée de choix est-elle fondamentalement trompeuse, voire violente ?
Alban Beaudoin : Ce dont on parle assez peu, en réalité, c’est que le « client funéraire » n’en est pas un. C’est presque une évidence, mais elle est rarement formulée ainsi. On a pourtant fait comme si l’endeuillé était un consommateur ordinaire, capable de comparer, de choisir, de décider rationnellement. Or rien ne va dans ce sens.
On aurait pu faire un tout autre choix : considérer la personne endeuillée comme un patient, ou en tout cas comme quelqu’un devant être accompagné, à l’image de ce qui se passe dans le secteur médical ou autour de la naissance. On aurait pu rapprocher le funéraire du soin, faire en sorte que les agents funéraires aient une posture d’accompagnement, voire de « soignant ». Mais on a fait exactement l’inverse : on a tout fait pour distinguer le secteur funéraire du secteur médical, afin de justifier sa lucrativité.
Le fait que l’endeuillé ne soit pas un consommateur éclairé est pourtant une évidence pour les agents funéraires eux-mêmes. Ils savent très bien qu’ils ont en face d’eux des personnes en état de choc, qui ne sont pas aptes à prendre des décisions rapides et rationnelles. Le problème, c’est que prendre réellement en compte cette situation demande du temps. Or le temps n’est pas la qualité principale exigée dans un travail funéraire organisé selon des impératifs de rentabilité.
Dans certaines structures, notamment les coopératives funéraires, qui tentent de transformer en profondeur le fonctionnement du secteur, cette question est centrale. Là, l’accompagnement est pensé comme une priorité. Mais dans des entreprises où ce n’est pas le cœur du projet — même si, individuellement, les agents sont souvent conscients de ce qu’ils font vivre aux familles — ils sont pris dans une logique économique qui les contraint. Ils deviennent, malgré eux, les agents d’un système qui empêche le choix éclairé.
C’est pour cela qu’à la fin du livre nous défendons l’idée d’un véritable droit des morts et des endeuillés, en partant d’un constat simple : la condition d’une personne endeuillée est comparable à celle d’un malade, de quelqu’un qui vient de se casser une jambe, ou de quelqu’un qui traverse un accouchement. À partir du moment où l’on admet cela, on pose un jalon essentiel : peut-on réellement confier au marché la prise en charge de situations où, par définition, les « consommateurs » ne sont pas en capacité de choisir librement et rationnellement ?
Pourquoi une sécurité sociale de la mort ?
Sur ce sujet, pourquoi la prise en charge collective des obsèques vous paraît-elle aussi légitime que celle de la naissance, de la maladie ou de la retraite ?
Jean-Loup de Saint-Phalle : Cela dépend d’abord du point de vue que l’on adopte, du référentiel que l’on choisit. Si l’on se place du point de vue du mort, la mort est le risque le plus évident, le plus certain qui puisse nous arriver. À ce titre, il est parfaitement logique qu’elle soit couverte collectivement, au même titre que la naissance. C’est presque une évidence philosophique : on ne choisit ni de naître ni de mourir, il est donc cohérent que l’entrée et la sortie de la vie soient prises en charge par la société.
D’ailleurs, cette idée n’a rien d’utopique. Historiquement, le financement du décès a déjà été pensé comme une responsabilité collective. Dès le Premier Empire, puis dans les ordonnances de l’après-guerre, la question des obsèques est prise en compte. On peut aussi citer les tontines, ou encore l’exemple de la ville de Genève, qui prend en charge les obsèques de l’ensemble de ses habitants depuis les années 1970. Il existe donc à la fois des précédents historiques et une justification philosophique solide.

On peut aussi se placer du point de vue des endeuillés, qui est tout aussi essentiel. Aujourd’hui, la prise en charge du deuil est très largement individualisée. Certes, on observe un développement de réflexions personnelles ou écologiques autour de la mort, mais concrètement, le soutien reste peu collectif. Les accompagnements psychologiques doivent être payés de sa poche, les arrêts de travail sont à négocier au cas par cas avec un médecin généraliste : tout cela relève d’un impensé social.
Pourtant, il y a une forme d’évidence. Je peux très bien vivre toute ma vie sans me casser la jambe, et je contribue malgré tout à la solidarité nationale pour celles et ceux à qui cela arrive — et c’est parfaitement normal. En revanche, j’ai perdu des proches, j’en perdrai encore, et je mourrai moi-même. C’est le cas de absolument tout le monde. De ce point de vue, la mort est même plus universelle que la maladie : elle est liée à notre condition humaine elle-même. C’est précisément pour cela que sa prise en charge collective devrait aller de soi.
Un enjeu démocratique : alternatives et résistances
Vous avez parlé des coopératives funéraires, des régies municipales, des tontines : on voit que des alternatives existent mais en France elles restent marginales. Est-ce avant tout un problème d’échelle, ou le résultat d’un cadre qui protège les rentes du capitalisme funéraire ?
Alban Beaudoin : Il y a deux choses. D’abord, même si nous avons la tête dans le guidon depuis plusieurs années sur ces questions, on a quand même le sentiment — et nous ne sommes pas les seuls à le dire — que quelque chose est en train de bouger. Cela ne date pas d’hier, mais c’est devenu plus visible récemment, avec des signes qui sont révélateurs.

Un exemple très parlant, c’est la parution, à la Toussaint dernière, de l’enquête Les Charognards, consacrée au business des pompes funèbres et centrée sur les deux géants du secteur, PFG et Funecap. Ce livre joue un peu le rôle qu’ont pu jouer Les Fossoyeurs de Victor Castanet ou Les Ogres dans d’autres domaines. Or, jusqu’à présent, ce type de travail n’existait tout simplement pas sur le funéraire. Les ouvrages de référence étaient essentiellement universitaires — je pense notamment au livre de la sociologue Pascale Trompette, que Jean-Loup a déjà citée —, des travaux très solides mais largement méconnus du grand public, alors même qu’ils décrivent précisément le fonctionnement du marché funéraire. Le fait que ces questions commencent à émerger dans l’espace médiatique est en soi nouveau.
Sur le terrain, on observe aussi une multiplication des initiatives. De nombreuses coopératives funéraires se sont créées récemment, et encore plus de projets sont en cours. La plupart n’aboutiront sans doute pas à la création d’entreprises, mais cela n’empêche pas l’émergence d’associations de préfiguration qui font déjà beaucoup de choses : organisation de cafés mortels, d’événements, de discussions autour de la mort, bien avant même de devenir des coopératives. Cela permet de remettre la mort dans l’espace public, en insistant notamment sur la question de l’égalité funéraire — ce qui était très peu le cas auparavant.
Le collectif dans lequel nous intervenons avec la conférence gesticulée est d’ailleurs sollicité par des publics très variés : des associations, des acteurs locaux, des structures qui travaillent sur le lien social ou la revitalisation des territoires. Juste avant notre échange, nous avons par exemple reçu un message d’une femme qui travaille dans une association dans l’Indre et qui souhaite consacrer la thématique annuelle de son projet… à la mort. Elle nous a contactés pour organiser une conférence. Ce sont des signaux faibles, mais ils vont tous dans le même sens.
En revanche, au niveau macroéconomique et politique, les choses sont beaucoup plus verrouillées. Pendant près de trente ans, il y a eu une figure centrale sur les questions funéraires au Parlement : le sénateur Jean-Pierre Sueur. Il a été l’artisan de la loi qui porte son nom et, plus largement, le principal relais politique de toutes les évolutions législatives sur le funéraire. C’est notamment lui qui a initié, en 2008, la mise en place d’un devis-type obligatoire pour toutes les entreprises funéraires — une mesure qui n’a réellement produit ses effets que quinze ans plus tard. Or Jean-Pierre Sueur n’est plus sénateur depuis peu. Il n’y a aujourd’hui plus de figure pivot clairement identifiée sur ces questions au niveau parlementaire. Lui représentait surtout, disons-le, les intérêts des indépendants et des grands indépendants du secteur, qui lui sont largement redevables. On peut espérer que la prochaine figure centrale adoptera une perspective différente : non plus l’accompagnement du marché funéraire tel qu’il existe, mais peut-être sa limitation, voire une remise en question plus profonde de son fonctionnement.
À l’échelle nationale, en tout cas, les obstacles restent très importants. Les dynamiques existent, mais elles se heurtent encore à de lourdes barrières structurelles.
Vous avez mentionné PFG et Funecap. Dans le livre vous décrivez un secteur ultra-concentré, dominé par quelques grands groupes qui contrôlent à la fois les crématoriums, les cercueils et même les logiciels de gestion. Pourquoi est-ce un enjeu démocratique ?
Jean-Loup de Saint-Phalle : Alban et moi, et plus largement notre collectif, partageons des valeurs démocratiques — et notre travail vise à rester inclusif et accessible à des personnes qui ne se revendiquent d’aucune étiquette politique particulière. Mais nous pensons que la société française actuelle n’est pas pleinement démocratique, et que la question de la mort permet de le démontrer très concrètement.

Prenons l’exemple des grands groupes funéraires, comme PFG ou Funecap. Les agences locales de ces grands groupes sont rarement dirigées par des professionnels du funéraire. Par exemple, dans l’Yonne, le directeur d’une agence PFG est un ancien bijoutier, recruté pour ses compétences commerciales, pas pour son expérience dans le secteur.
Dans ce secteur, ce ne sont pas les besoins des populations qui déterminent l’implantation des activités, mais la rentabilité. Cela se voit très clairement dans la localisation des crématoriums : certains départements en sont totalement dépourvus. On voit bien les enjeux lorsqu’on prend l’exemple de la Guyane : il n’y a pas de crématorium, et pour être crématisé, il faut prendre l’avion. Là encore, ce n’est pas la volonté des habitants qui détermine l’aménagement funéraire, mais les choix privés des grands groupes. Autre exemple concret : autour de Sens, un crématorium va être implanté. Beaucoup d’habitants du secteur sont musulmans et rejettent la crémation pour des raisons religieuses ; d’autres s’inquiètent des nuisances liées à la fumée. Personnellement, je n’y vois pas de problème majeur, mais ce qui m’a choqué c’est l’absence totale de débat démocratique. Le maire a simplement lancé un appel d’offres, PFG a répondu, et la décision a été prise sans aucune consultation des habitants. Résultat : des populations contraintes d’accepter une évolution qui ne correspond pas à leurs choix. À notre avis, chaque territoire devrait pouvoir décider de ses modalités funéraires, sans que ce soit dicté par des calculs économiques.
C’est pourquoi parler de démocratie dans le funéraire est essentiel. On pourrait imaginer des « collèges funéraires » tirés au sort, composés de citoyens, pour arbitrer les décisions sur la mort dans chaque territoire. La condition de mortalité étant universelle, chacun serait légitime à participer. Ces assemblées pourraient inclure des croque-morts, mais aussi des représentants des endeuillés, afin que les décisions reflètent réellement les souhaits des populations.
Mettre la mort « hors du commerce »
On voit bien ce qu’on a perdu collectivement en marchandant les obsèques. Pour montrer que l’on pourrait les replacer hors du marché vous convoquez la notion romaine de “res extra commercium”, pouvez-nous expliquer ce dont il s’agit et la manière dont vous la mobilisez ?
Alban Beaudoin : L’intérêt de convoquer la Rome antique, c’est aussi un petit déplacement stratégique. L’Antiquité romaine est souvent mobilisée par des discours conservateurs, parfois par des adversaires politiques. Il est donc assez ironique — et fécond — de constater que les Romains ont élaboré un système intéressant du point de vue de la marchandisation. Ils distinguaient très clairement les biens qui pouvaient faire l’objet de commerce — l’huile d’olive, les esclaves, les terres — et ceux qui en étaient exclus. Pour des raisons à la fois religieuses, culturelles et symboliques, certaines choses relevaient du sacré, de l’inconnu, du divin, et ne pouvaient donc pas être marchandisées : le ciel, la mer, certaines forêts… et la mort. Ces choses étaient placées hors du marché, ce que le droit romain appelait des res extra commercium. La mort pose toutefois un problème particulier : contrairement à une forêt ou à la mer, on ne peut pas ne rien faire. Dans la religion romaine, un mort mal pris en charge pouvait devenir un esprit malveillant. Il fallait donc s’en occuper — mais sans en tirer profit. Les Romains ont résolu cette contradiction de manière assez remarquable en mettant en place une forme de sécurité sociale primitive : les citoyens cotisaient pour financer les obsèques de tous et rémunérer ceux qui accomplissaient le travail funéraire, sans que personne ne s’enrichisse. Les obsèques étaient les mêmes pour les riches et pour les pauvres, et il n’existait pas de grands patrons du funéraire. Ce système excluait les femmes et les esclaves, mais le principe fondamental restait celui d’une prise en charge collective et égalitaire.
Ce qui nous intéresse, c’est que cette notion de res extra commercium existe toujours dans le droit français. Elle est encore mobilisée par la jurisprudence, notamment à propos du corps humain. L’un de ses corollaires est le principe d’indisponibilité du corps humain : on ne peut pas vendre ses organes, ni tirer profit du corps d’une personne vivante. Nous posons donc une question simple : pourquoi ne pas étendre ce principe au corps mort ? On nous répond souvent que ce n’est pas le corps qui est vendu, mais le rituel autour. Mais cet argument ne tient pas entièrement. Il existe bien des pratiques marchandes directement liées au corps : la thanatopraxie, avec l’injection de formol ; la récupération, après crémation, de prothèses ou de métaux, qui sont ensuite brûlées. En France, cette activité est d’ailleurs assurée par une entreprise néerlandaise, Orthometals, et les bénéfices sont censés être reversés aux communes. On voit bien que le corps mort n’est pas totalement sorti de la logique de profit.
Nous avons discuté de cette idée avec le député Clouet, qui a déposé une proposition de loi examinée en commission à la Toussaint. Lui comme son assistant parlementaire y voyaient un argument susceptible de convaincre sur tous les bancs : l’idée qu’on ne peut pas tirer profit d’un corps mort peut faire consensus.
Dans le livre, nous cherchons précisément ce type de leviers. Nous sommes conscients que les arguments en faveur de la Sécurité sociale sont politiquement moins audibles aujourd’hui. En revanche, la mort est un terrain particulier. Elle peut mettre d’accord des positions très différentes : sur le fait qu’on ne fait pas de profit sur un corps, qu’il faut s’en occuper dignement, que cela coûte cher, et que, comme pour la naissance, on peut légitimement considérer que cela ne doit pas être payé individuellement. Nous mobilisons donc cette charge symbolique et sacrée de la mort pour tenter de ramener, par d’autres chemins, l’idée de protection collective et de sécurité pour toutes et tous.
On vient de parler de la Rome Antique. Tout au long de l’ouvrage, vous convoquez des figures mythologiques et des exemples antiques. Que permettent-ils de penser sur notre rapport contemporain à la mort, sans idéaliser le passé ou proposer un simple retour en arrière ?
Jean-Loup de Saint-Phalle : La mort est quelque chose qui nous concerne tous, mais toujours à distance : c’est ce qui nous permet, tant qu’on est vivant, de mener une existence relativement insouciante au quotidien. Du coup, on pourrait se dire que le système funéraire tel qu’on le connaît aujourd’hui est “normal”, qu’il a plus ou moins toujours existé. Or ce n’est pas du tout le cas.
Le secteur funéraire est devenu un marché assez récemment, notamment du fait d’un manque de vigilance collective. Sans même remonter très loin : il y a encore trente ans, dans beaucoup de villages français, on se débrouillait autrement. Des gens du coin acceptaient de porter le cercueil, la camionnette du menuisier servait à transporter le corps — c’est d’ailleurs un témoignage qu’on cite dans le livre. On bricolait, et ce bricolage avait au moins quelque chose de démocratique.
Si nous convoquons la mythologie, d’autres cultures et d’autres époques, ce n’est donc pas pour idéaliser le passé. Les périodes que nous évoquons ne sont pas forcément des mondes dans lesquels il ferait bon vivre — je ne fantasme ni l’Égypte antique ni la vie chez les Inuits, ne serait-ce que pour des raisons climatiques. Mais ce détour montre une chose essentielle : le marché n’a rien d’évident. Ce que nous tenons aujourd’hui pour acquis est en réalité l’exception. Il suffit de regarder ailleurs, ou avant, pour s’en rendre compte.

Prenez l’Ankou, en Bretagne : ce personnage (un fantôme), choisi parmi les morts de l’année écoulée, est chargé d’aller chercher les défunts suivants et de les transporter dans sa charrette. C’est une figure traditionnelle, ancienne. Dans l’esprit de Bernard Friot, on pourrait dire qu’il y a là du “déjà-là” : notre civilisation, comme beaucoup d’autres, regorge d’exemples montrant qu’on peut organiser des choses pour le bien commun sans passer par un système lucratif. Ça a déjà existé.
Et puis il y avait aussi l’envie de s’amuser un peu, de rendre ce sujet — trop souvent morne et triste — un peu plus vivant. C’est un enjeu presque secondaire, plus esthétique, mais réel. Aujourd’hui, les grandes entreprises de pompes funèbres lucratives proposent souvent quelque chose de très terne, très standardisé. Or la personnalisation est précisément l’argument qu’on oppose à l’idée d’une “sécurité sociale de la mort” : on nous dit que si les tarifs sont conventionnés, tout le monde fera la même chose. Nous n’y croyons pas du tout. Quand on regarde tous les systèmes funéraires qui ont existé en dehors du marché, on découvre au contraire une diversité absolument immense : le corps mangé par les vautours chez les Perses, le corps jeté à la mer, la crémation, l’inhumation, avec des rituels innombrables — pleureuses, poésie, cérémonies très élaborées… Cela fait des millénaires que l’humanité invente des formes funéraires non marchandes, extrêmement variées. Il suffit de regarder un peu sur le côté : on n’a absolument pas besoin du marché pour personnaliser nos obsèques. On saura très bien se débrouiller.
En parlant de regarder sur le côté, vous avez évoqué le modèle genevois. Est-ce un modèle qui marche bien ? Qu’est-ce qui empêche aujourd’hui la France d’aller dans cette direction ?
Alban Beaudoin : À l’origine, le modèle genevois a été mis en place par la municipalité pour prendre en charge les obsèques des plus pauvres. En France, quelque chose d’assez proche existe déjà : ce qu’on appelle le terrain commun. Lorsqu’une personne sans ressources décède et qu’aucun proche n’est identifié ou joignable, la mairie a l’obligation de prendre en charge ses obsèques. Cela fonctionne de manière inégale. Certaines municipalités prennent cette mission très au sérieux : elles aménagent le terrain commun de façon digne, parfois même qualitative. Il y a par exemple des communes qui récupèrent des pierres tombales arrivées à échéance pour les réinstaller sur le terrain commun. Et puis, à l’inverse, il y a des mairies qui font n’importe quoi, qui s’en occupent très mal. Bref, il y a un peu de tout.
En Suisse, et plus précisément à Genève, la réflexion est allée plus loin. À un moment, la question a été posée aux habitants : puisque ça fonctionne pour les plus pauvres, pourquoi ne pas étendre ce système à tout le monde ? La réponse a été très largement positive. Ce n’a pas été une mesure révolutionnaire — ni lorsqu’elle a été mise en place par un maire radical à l’époque, ni lorsqu’elle a été étendue à l’ensemble de la population. Aujourd’hui, les obsèques sont prises en charge via l’impôt des Genevois, et le système fonctionne très bien. Mieux encore : il va largement au-delà du strict minimum. On ne se contente pas de prestations basiques ; sont aussi prises en charge des prestations de qualité, comme l’habillage du défunt ou la toilette mortuaire. On est donc bien au-dessus d’un simple socle minimal.
Pour nous, l’exemple genevois est sans doute l’un des plus convaincants pour montrer qu’un tel système pourrait fonctionner en France, aujourd’hui, en 2026. Cela supposerait évidemment une volonté politique. Mais ce n’est pas une mesure d’extrême gauche. En faisant une copie assez fidèle du modèle suisse, on pourrait très bien imaginer que cela soit mis en place par un gouvernement qui n’est pas radicalement à gauche.
Les travailleurs de la mort : invisibilisés et abîmés
Les agents funéraires ont historiquement occupé une place centrale et respectée. Comment expliquer leur déclassement social et symbolique, et en quoi la marchandisation de la mort produit-elle aussi une souffrance spécifique chez ceux qui la prennent en charge ?
Jean-Loup de Saint-Phalle : Une fois la mort survenue, l’idée dominante, c’est : le plus vite on s’en débarrasse, le mieux c’est. On paie la facture, on râle parce qu’elle est très élevée, et ensuite on oublie les agents funéraires — et on est bien contents de les oublier.
Le problème est là. C’est un peu comme quand on râle contre la SNCF parce que le train est en retard : on constate que ça ne marche pas, mais on ne prend pas le temps de se demander pourquoi. Dans le funéraire, c’est pareil : c’est trop cher, point. On ne va pas jusqu’à séparer le bon grain de l’ivraie, à se demander quelle part de la facture rémunère réellement l’agent qui s’est occupé de notre famille, et quelle part part chez un actionnaire canadien, par exemple. Et c’est là que le bât blesse.

Il faut aussi rappeler que les agents funéraires, au sens professionnel du terme, n’ont pas toujours existé. Historiquement, on trouvait des congrégations — à Béthune, par exemple, il y en avait une très ancienne — composées de bourgeois au sens d’habitants du bourg, qui s’organisaient pour prendre en charge les obsèques. Dans les villages, les paysans étaient agriculteurs, éleveurs, artisans… et, le temps d’une journée, ils devenaient aussi agents funéraires lorsqu’une personne mourait. La séparation stricte, professionnelle, des agents funéraires dans la société est en réalité quelque chose d’assez récent.
Si l’on compare avec l’Antiquité, par exemple chez les Romains, il existait effectivement un corps spécifique attaché aux questions funéraires. Mais ce n’est pas notre tradition. Chez nous, ce qui est nouveau, c’est surtout l’irruption du marché dans cet espace. Et ce caractère marchand, on voit bien qu’il est dépassable — notamment avec les coopératives funéraires. Les retours des personnes qui y ont eu recours sont souvent dithyrambiques. Elles racontent des agents qui ont enfin le temps de s’occuper des morts, qui peuvent renouer avec la dimension sociale, voire sacrée, de leur métier. À l’inverse, quand un agent n’a que vingt minutes à consacrer à une famille parce que le crématorium appartient à une entreprise et qu’il faut respecter des cadences, il est presque inévitable qu’il soit perçu comme un escroc. Non pas parce qu’il l’est, mais parce qu’il est structurellement pressurisé par son environnement de travail.
Dans ces conditions, il est logique que les endeuillés s’en prennent aux agents funéraires : ce sont eux qu’ils voient, et ce sont eux qui incarnent ce qui ne va pas. Pourtant, ce n’est pas un métier que l’on fait par appât du gain. Ce n’est pas très bien payé. Beaucoup y arrivent par défaut, via l’intérim, faute d’autres options. D’autres le choisissent au contraire par véritable intérêt pour un métier du soin, de l’accompagnement, pour les questions funéraires. Mais ce n’est certainement pas un métier qu’on fait pour devenir riche. Ce serait assez facile à comprendre, à condition de s’y intéresser un minimum — mais rien n’est fait pour cela. Quand on entre dans une agence de pompes funèbres d’un grand groupe, on n’est même pas sûr de revoir le maître de cérémonie du jour des obsèques, ni de croiser à nouveau les porteurs. Tout est déshumanisé, alors même qu’il s’agit d’un métier profondément humain. C’est un paradoxe, et il alimente cette mauvaise réputation profondément injuste des agents funéraires.
Mais c’est une situation qui peut être dépassée. On l’a dit pour les coopératives, mais cela vaut aussi pour certaines régies municipales. Quand elles ne tombent pas trop dans le piège de la marchandisation — ce qui dépend beaucoup de la manière dont elles sont dirigées — des liens plus sains peuvent se créer entre les agents et les familles. Et là, on retrouve quelque chose de plus juste, de plus humain, pour tout le monde.
La Sécurité Sociale de la mort, concrètement
Votre proposition c’est donc la sécurité sociale de la mort. Dans les grandes lignes, en quoi ça consisterait ? Et qu’est-ce que cela transformerait le plus profondément selon vous ?
Alban Beaudoin : La première étape — et sans doute la plus immédiatement atteignable — serait de régler la question économique pour les endeuillés. Concrètement, il s’agirait de faire en sorte que les obsèques soient intégralement prises en charge par la sécurité sociale.
On nous oppose souvent l’idée que cela impliquerait les mêmes prestations pour tout le monde. En réalité, ce n’est pas du tout ce que nous proposons. Il s’agirait d’établir une liste de prestations remboursées, à l’intérieur de laquelle existerait une très grande variété. Par exemple, rembourser une cérémonie ne veut évidemment pas dire imposer une cérémonie identique à tous, mais permettre aux endeuillés d’organiser celle qu’ils souhaitent. De la même manière, le remboursement de la toilette mortuaire peut aller d’un soin simple effectué par un agent jusqu’à, si la société en décide démocratiquement, une thanatopraxie — un soin très chimique, mais parfois nécessaire dans des situations de corps très endommagés. L’idée est donc de rembourser les prestations que l’on juge utiles — celles qui sont aujourd’hui obligatoires si la loi ne change pas, comme le cercueil ou les démarches administratives, mais aussi d’autres que l’on pourrait considérer comme essentielles. Et cette liste n’a évidemment pas vocation à être figée : elle devrait être décidée démocratiquement. Il est important de préciser que nous ne proposons pas un forfait fixe — du type « 4 000 euros pour tout le monde ». On rembourse des prestations, quel qu’en soit le coût. Si cela coûte 2 000 euros, très bien ; si cela coûte 10 000 euros, très bien aussi. Un exemple : il n’existe pas de crématorium en Guyane. Si l’on donnait simplement une somme forfaitaire à une personne guyanaise souhaitant être crématisée, ce serait totalement insuffisant et absurde. Ce que l’on rembourse, ce sont les actes, pas une enveloppe arbitraire.
La deuxième étape, qui est pour nous absolument essentielle et indissociable de la première, concerne le conventionnement des entreprises funéraires. Autrement dit, seules les entreprises ayant passé une convention avec la sécurité sociale permettraient de bénéficier de ce remboursement — exactement comme aujourd’hui pour les médecins conventionnés. Ces entreprises devraient répondre à certains critères. Les deux que nous posons sont les suivants : une gestion coopérative, associant les salariés, et l’absence de but lucratif. C’est dans ces entreprises conventionnées que l’on pourrait utiliser ce que nous appelons, par analogie, une « carte mortelle », l’équivalent de la carte Vitale. Cela poserait un choix très simple — et en réalité très puissant : avec cette carte, on pourrait aller soit dans une coopérative conventionnée, soit dans une entreprise lucrative de type PFG. Mais chez PFG, la carte ne fonctionnerait pas. L’objectif est clair : créer un pôle suffisamment fort pour assécher progressivement le marché funéraire lucratif. Évidemment, aujourd’hui, il n’existe pas assez de coopératives : peut-être une vingtaine d’entreprises en France répondraient immédiatement à ces critères. C’est pourquoi nous proposons un temps de transition. Par exemple, une agence familiale en Indre-et-Loire pourrait disposer de cinq ans pour se conformer aux critères et devenir conventionnée.
La troisième étape concerne les agents funéraires eux-mêmes. Dans les entreprises conventionnées, ils seraient rémunérés par la sécurité sociale, sous la forme d’un salaire à la qualification — ou salaire à vie. Leur rémunération ne dépendrait plus ni de leur entreprise, ni de l’État, ni du nombre de prestations vendues. Elle dépendrait uniquement de ce qu’ils sont : des agents funéraires. Leur salaire serait totalement décorrélé de la logique commerciale.
Voilà les trois grands axes de notre proposition :
1. le remboursement intégral des obsèques,
2. le conventionnement des entreprises,
3. le salaire à vie pour les agents funéraires.
Il existe enfin un quatrième axe, que l’on peut qualifier d’axe d’extension : élargir cette sécurité sociale funéraire à des domaines connexes. Par exemple, prendre en charge le deuil lui-même, en remboursant des séances chez le psychologue ; ou intégrer des métiers proches du funéraire — fleuristes, marbriers, graveurs — afin de mettre l’ensemble de la production funéraire en sécurité.
D’un point de vue stratégique, on pourrait avancer par étapes. C’est d’ailleurs le travail que nous avions engagé avec le député Clouet : commencer par le remboursement des frais d’obsèques, puis étendre progressivement au conventionnement, puis au salaire à vie. La sécurité sociale, en 1946, s’est elle-même construite de manière progressive : ses trois « jambes » n’ont pas été mises en place immédiatement.
Mais sur le fond, ces dimensions sont indissociables. Si la prise en charge des obsèques soulagerait immédiatement et massivement les endeuillés — ce qui serait déjà une immense réduction de la violence sociale —, la sécurité sociale n’a de sens que si elle protège à la fois les personnes concernées et celles qui produisent le service. C’est tout l’enjeu : s’occuper simultanément des endeuillés et des agents funéraires.
Le Collectif pour une Sécurité Sociale de la Mort : perspectives, difficultés et relais
Jean-Loup de Saint-Phalle : On est contents d’être un collectif mixte, avec à la fois des gens du métier et des gens qui n’y sont pas. Ce qui est intéressant, c’est qu’il y a des allers-retours permanents. Des personnes qui n’étaient pas dans le funéraire s’y mettent : on a par exemple un nouveau venu, Adrien, qui nous a rejoints récemment et qui est en train de devenir agent funéraire. Et à l’inverse, on a Gaëlle, présente depuis le début du collectif, qui est agente funéraire et qui, elle, envisage peut-être d’en sortir. Finalement, peu importe. Ce qui nous importe, c’est d’avoir réussi à dépasser — en tout cas, je parle en mon nom — cette question de la légitimité, qui peut parfois être un piège. Cette idée selon laquelle il ne faudrait jamais rien faire ni rien dire tant qu’on n’est pas « légitime ». Évidemment, il y a plein de situations où il vaut mieux se taire. Mais sur ce sujet-là, justement, il ne fallait pas se taire. Au contraire, je pense que c’est une bonne chose que tout le monde, dans le collectif, ose prendre la parole et participer. D’abord parce que la mort est un sujet universel. Ensuite parce que si personne ne s’en empare, le marché, lui, s’en empare — et avec beaucoup moins de scrupules que nous. Donc parfois, ça vaut le coup d’oser prendre position sur des sujets sur lesquels on n’a pas de compétences professionnelles directes, à condition de travailler avec des professionnels, de former un ensemble cohérent. Et de ce point de vue-là, le collectif va plutôt bien aujourd’hui, parce qu’on a vraiment ces deux profils. D’ailleurs, Alban et moi, on commence à être un peu dépassés — au bon sens du terme. On voit émerger énormément d’initiatives en dehors des conférences gesticulées ou du livre qu’on a écrit. Et ça, c’est très bien. Il y a un vrai roulement, des moments où nous pouvons nous mettre en retrait, où on n’a plus besoin de nous. Et c’est tant mieux.
Alban Beaudoin : Plus largement, il y a dans notre collectif une réflexion permanente sur la démocratie — et sur le fait que notre société ne l’est pas tant que ça. L’expérience de la sécurité sociale de la mort est, pour moi, une démonstration assez frappante de ce déficit démocratique. On a une idée qui, objectivement, est très consensuelle, quels que soient les bords politiques. On en a encore fait l’expérience récemment : pendant les vacances, on en a parlé avec des amis qui ne sont pas du tout d’extrême gauche, voire même d’extrême droite. Sur Bardella, sur Macron, le débat peut être infini. Mais sur la mort, il y a un accord très large pour dire qu’il y a un problème, et que le gérer de manière collective et démocratique pourrait être une bonne solution. On a fait quarante-cinq conférences gesticulées, on a rencontré des publics extrêmement variés, et la question qui revient tout le temps, c’est : « Pourquoi ça n’existe pas déjà ? » On a écrit un livre. On a abouti à une proposition de loi, aujourd’hui déposée en commission des affaires sociales. En réalité, on a un peu atteint le plafond de ce qu’on peut faire. Et ça veut dire quoi ? Que s’il ne se crée pas un mouvement d’opinion massif, ou s’il n’y a pas un scandale énorme dans le monde funéraire sur lequel on pourrait s’appuyer, on a fait à peu près le maximum. La proposition de loi est aujourd’hui portée par La France insoumise. Elle attend que les questions budgétaires soient réglées, et surtout que d’autres groupes politiques la soutiennent pour qu’elle puisse arriver en hémicycle. Là-dessus, on n’a plus aucune prise. À part la révolution, on n’a pas vraiment d’autre débouché. Et c’est ça qui rend le bilan assez noir. On a organisé des événements, investi énormément d’énergie, des gens ont donné de l’argent, cotisé, soutenu le projet. Et pourtant, nos moyens d’expression démocratique restent spectaculairement limités. Une proposition de loi peut très bien finir balayée par trois cents députés sur cinq cent soixante-dix-sept, puis rangée dans un tiroir. La liberté d’expression existe, bien sûr. Mais sans réel pouvoir citoyen, on est à des années-lumière de la démocratie. En faire l’expérience concrètement, c’est assez troublant.
On est relayés par des médias, mais on peut littéralement les compter sur les doigts de nos quatre mains. Frustration, c’est la deuxième fois. L’Humanité est revenue vers nous. Le Média, on y est allés deux fois. Pendant la Toussaint, on a eu une visibilité un peu plus large : Radio Classique, France Bleu, et des médias qui ne sont pas forcément de notre camp politique. C’est aussi lié au contexte, au bruit autour du livre Les Charognards. Mais même en mobilisant toute notre énergie collective, voilà ce que l’on peut faire en France en 2026.
Vous avez dit que la France Insoumise a repris certains aspects de votre proposition. Est-ce que c’est le cas d’autres formations politiques ?
Jean-Loup de Saint-Phalle : La France insoumise a effectivement repris un certain nombre d’éléments de notre proposition, et on en est plutôt contents. Elle n’a pas repris le tirage au sort des endeuillés : elle lui préfère un système proche des élections professionnelles pour désigner les personnes qui siègeraient dans la future sécurité sociale. Elle a aussi évacué tout un vocabulaire plus poétique mais franchement, ça nous importe peu. Tant mieux, même : plus une idée circule sous des formes variées, plus elle a de chances d’exister. Sur le fond, en revanche, il y a peu de divergences. Ce que nous proposions en fin d’ouvrage n’entrait de toute façon pas dans une seule loi. Il a été question, par exemple, de porter séparément des mesures comme le congé de deuil renforcé ou la création de lieux dédiés à la mort et au deuil. Ces aspects-là ont été repris par un autre député insoumis, Christophe Bex.
Du côté des autres forces politiques, on est globalement sur le périmètre de ce qui a constitué le Nouveau Front populaire. Il y a parfois eu des convergences possibles, mais aussi beaucoup de silences. En 2022, on avait des liens avec Jérôme Guedj, au PS. Aujourd’hui, plus rien : plus de réponses. Le Parti communiste, en revanche, nous a pas mal soutenus, notamment en nous donnant de la visibilité à la Fête de l’Humanité. On a aussi eu des échanges avec Danielle Simonnet, de l’Après — techniquement rattachée au groupe écologiste. On a rencontré beaucoup d’autres parlementaires mais sans réel prolongement politique. On a tenté François Ruffin et Fakir sans trop de succès. Globalement, j’ai fait le tour : communistes, écologistes, socialistes, et surtout les Insoumis, qui sont aujourd’hui les seuls à porter une proposition de loi concrète.
À la gauche radicale, nos propositions ont été relayées par l’UJC, par le NPA — notre trésorière, Gaëlle, y milite d’ailleurs. À Lutte ouvrière, on nous a expliqué que ce n’était pas révolutionnaire, donc que ça ne les intéressait pas.
À droite, on a laissé la porte ouverte. Elle est restée ouverte, mais personne n’est entré. On a tenté des contacts avec des parlementaires de droite, sans réponse significative. Sur la droite et au centre, notre positionnement a été, disons, un peu taquin — voire “hypocrite”. On savait très bien qu’ils ne s’empareraient pas du sujet. Mais on a fait en sorte qu’ils puissent le faire, précisément pour montrer qu’ils ne le feraient pas. Pour rappeler, au fond, qu’il n’existe pas de sujets réellement apolitiques.
Quant au Rassemblement national, on s’est explicitement interdit tout lien avec eux. On a rédigé un texte fondateur du collectif — la Déclaration des droits des morts et des endeuillés — dont l’article premier affirme que les morts sont égaux en droits. Cela implique, par exemple, qu’un mort en Méditerranée est un mort dont on doit aussi s’occuper. Ce texte, écrit collectivement, sert aussi de ligne de démarcation claire pour éviter toute récupération d’extrême droite. Nous ne voulons pas travailler avec eux. La sécurité sociale « à la française » est historiquement une synthèse : gestion des travailleurs inspirée du modèle allemand, et universalisme proche du modèle britannique. Appliquer ces deux principes à la mort implique, pour nous, d’écarter clairement les idées d’extrême droite, dont on est convaincus qu’elles trouveraient toujours un moyen de produire de la xénophobie, même dans un tel cadre.
Mais il faut être clair : ce n’est pas tant que nous réclamerions d’être entendus, nous, en tant que collectif. Le problème, c’est que la question elle-même n’est quasiment jamais posée. Si on avait découvert en travaillant sur ce sujet qu’il existait déjà des centaines d’associations puissantes, des propositions politiques multiples, des livres innombrables sur la condition des agents funéraires, on n’aurait sans doute pas fait ça. Mais ce qui frappe, c’est à quel point le sujet est relégué. Il est même plus secondaire que celui de la fin de vie ou du droit à mourir dans la dignité, alors même qu’il concerne, par définition, absolument tout le monde. Tout le monde ne recourt pas au droit à mourir dans la dignité. En revanche, tout le monde meurt.

Rob Grams
Rédacteur en chef adjoint