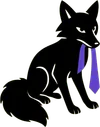Vos Frustrations est une rubrique permettant aux lectrices et lecteurs de partager leurs « frustrations », colères, témoignages ou analyses. Dans cet article, Pitucho montre comment les espaces collectifs, même militants, reproduisent des rapports de domination qui invisibilisent les plus discrets et les plus dominés socialement. À partir de son malaise dans les interactions de groupe, il analyse la parole comme un lieu de performance, d’exclusion et de violence symbolique, étroitement lié aux classes sociales, au racisme intériorisé et aux hiérarchies héritées. Refusant les injonctions individualisantes à “prendre sur soi”, il appelle à transformer les cadres collectifs eux-mêmes afin que le partage, l’écoute et le silence cessent d’être des privilèges réservés aux dominants.
Trop souvent, les organisations collectives qui se revendiquent de l’émancipation, de l’écoute et du partage reproduisent les mécanismes de domination. Il n’est pas rare que des personnes monopolisent la parole, s’accaparent les tâches, cherchent à imposer leur écriture et leur idées, prennent la direction et l’initiative unilatéralement. Les personnes invisibilisées ont l’habitude de la subordination et de devoir s’effacer au profit des autres. Or c’est précisément à cause de ça qu’elles cherchent un espace où elles peuvent s’affirmer comme des êtres égaux et se sentir acceptées telles qu’elles sont et sans avoir à s’excuser d’être différentes. Faute de perspectives d’accomplissement à la fois personnel et collectif, elles n’osent pas forcément braver les devants, ou s’y sont épuisés, et peuvent abandonner le collectif. C’est peu dire à quel point on retrouve ces problèmes dans tous les contextes, y compris dans sa vie privée.
Pour ma part, je ne me sens pas vraiment à l’aise dans un groupe. Être en compagnie de plusieurs personnes ne rompt pas avec mon sentiment de solitude. Je viens avec l’idée de m’ouvrir aux autres. Je m’efforce de sourire pour paraître sympathique. Je soigne mon image et adopte une attitude avenante afin de me prémunir de potentielles reproches. Je tente de participer tant bien que mal aux conversations dans lesquelles il est souvent difficile de briser la complicité des principaux concernés. Les plus bavards s’enferment dans une discussion dont seuls eux sont à même de saisir le sens de leur échange, et se complaisent à des références qui témoignent d’une intimité exclusive par l’art des private jokes entre gens cool et selects. Au fil des discussions, je finis par me distraire et je me perds un moment dans mes pensées avant de me raccrocher à quelques bribes. Souvent, on ne me regarde pas, comme si j’étais invisible ou absent, les têtes se tournent surtout vers les plus extravertis et avec qui la réplique est la plus récurrente. Je peine à trouver un point sur lequel je pourrai éventuellement intervenir pour m’exprimer un peu et sortir de mon rôle de spectateur. Quand je me lance, je ne brille pas, je titube avec mes mots, je phrase sans trop savoir quoi dire et je finis platement sans susciter un grand intérêt. Je gagne alors le sentiment de ne pas devoir être là, ne parvenant pas à m’enthousiasmer et à placer des mots au milieu d’un échange vif et trop réactif pour moi.
Les discussions banales cachent des confrontations sociales
De la réactivité. C’est l’injonction à laquelle j’ai l’impression de devoir répondre au milieu d’échanges multilatéraux. Se presser d’intervenir dès que tout le monde se tait un court instant. Être obligé de couper la parole pour en placer une. Profiter d’un sujet soudain où je me sens plus en confiance pour parler. Se frustrer de ne pas avoir réussi à développer mon idée parce que ma parole a été coupée. Ce moment où je me rends compte que je peux arrêter de parler parce que d’autres voix concurrencent la mienne et qu’on ne m’écoute pas. Se sentir opprimé par ses propres pairs qui ne se rendent pas compte de l’effet que leur comportement produit. Ne pas réussir à suivre la conversation à cause de l’empilement de mots sachants, d’anglicismes, de sigles, d’abréviations et de termes techniques comme si je tentais de saisir les paroles d’une chanson en langue étrangère émise depuis un vieux poste radio sur une mauvaise fréquence.
Socialiser avec autrui n’est pas toujours une chose facile. Même nos discussions les plus banales peuvent cacher des confrontations sociales. Le plus souvent, en parler est difficile, au risque de recevoir des accusations moralisatrices en retour. Mes interlocuteurs peuvent trouver ce sujet absurde, rétorquer qu’il faut “grandir” et “prendre sur soi” ou se contenter de répondre par une injonction incantatoire selon laquelle “il faut s’ouvrir aux autres”. Ils peuvent pointer chez moi une forme d’immaturité, d’égocentrisme, en indiquant que je ne suis pas le centre du monde et qu’il est normal que je doive “faire des efforts” pour m’insérer. Ils peuvent aussi prendre au sérieux ce sujet tout en écartant ma situation d’un geste expéditif de la main au motif que je suis bien mieux loti que d’autres. Donc je n’en parle pas.
L’immaturité est d’ailleurs un reproche infantilisant et récurrent venant de ceux qui ne veulent pas reconnaître leurs torts. Qualifier quelqu’un d’immature est la conclusion d’un processus de manipulation destiné à réfuter toute remise en question. D’abord, le manipulateur déplace l’origine du conflit du fonds vers la forme. Il insiste sur la manière par laquelle son adversaire s’est manifesté, en lui indiquant qu’il n’a pas dit les choses avec tact, que le moment et le lieu étaient inappropriés, que ses termes étaient exagérés ou que son ton était agressif. Quand bien même il y aurait une part de vérité, là n’est pas le sujet car l’objectif recherché de la démonstration est de focaliser sur le verbe et de renverser la charge de la faute. Ensuite, une fois que son adversaire a fini par ne plus parler du fond, à force de ne se défendre que sur la forme, le terrain est alors bien prêt pour le disqualifier, le rabaisser, le diminuer en basant l’argumentaire uniquement sur le comportement plutôt que sur les raisons qui ont poussé le manipulé à agir ainsi. En définitive, la personne qualifiée d’immature s’est faite volée sa légitimité et a été décrédibilisée dans son acte de révolte. Faîtes le parallèle avec les accusations d’hystérie ou les diffamations non dissimulées sur les plateaux télés et vous aurez compris la violence de ce reproche.
Ce que prouve ce procédé, c’est qu’interagir avec les autres peut être le terrain d’un jeu de faux-semblants et d’insincérité où nous sommes enjoints à la bienséance et au respect des codes. Tout écart d’un individu sera alors perçu comme une déviance et sera réprimé par les éléments dominants du collectif, même quand il se prétend inclusif et soucieux des minorités. N’importe qui dans un cercle militant, au travail ou lors d’une soirée peut en faire les frais. Interagir, ce n’est pas inné, ça s’apprend et c’est aussi un cadre d’exercice du pouvoir auquel nous ne sommes pas tous formés pareil. Cet apprentissage n’est donc pas exempté de violences et reflète la structuration des classes sociales. Je n’ai aucun doute que mon malaise dans les relations de groupe trouve en effet son origine dans l’environnement qui m’a façonné comme il façonne si bien toutes les personnes qui exercent leurs dominations ou subissent des discriminations.
Des discriminations intériorisées
Me concernant, je suis fils d’ouvriers immigrés portugais, communauté dont les membres sont parfois surnommés les “rebeus de l’Europe”. J’ai grandi au contact de personnes valorisées pour leur réputation de “bosseurs” et que la médiacratie qualifie de “bons immigrés” bien insérés. Bénéficiant de ce que Ugo Palheta, entre autres chercheurs, nomme le “paratonnerre maghrébin”, je suis bien moins exposé aux manifestations les plus crues et directes du racisme et aux accusations d’assistanat. Du moins, c’est ce que je crois n’ayant pas à subir le même degré ni la même fréquence de discriminations. Or ces discriminations, je les ai quand même et surtout subi au travers de leur intériorisation. Elle a pour effet de régir et de déformer les comportements des dominés pour éliminer chez eux tout ce qui ne plaît pas aux dominants. Ce faisant, elle conforte le système de domination qui ne se remet jamais en question.
Pour l’illustrer, nous sommes instruits dès l’enfance par nos parents à côtoyer plutôt des “Français” que de traîner avec la “racaille” pour se démarquer, se cultiver et donner l’image de personnes bien intégrées, validant inconsciemment au passage l’idée que les immigrés seraient forcément sales, vulgaires et ignorants. Il faut rester poli en toute situation pour ne pas assimiler sa communauté à des personnes par nature agressives et fermées d’esprit. Il est proscrit de dire d’où l’on vient ou de se présenter comme titulaire d’une autre nationalité, injonction nous étant faite de dire que nous sommes “français” pour évincer le plus possible les traitements différenciés. Nous avons le devoir de bien travailler à l’école pour “devenir quelqu’un”, comme si nous n’étions personne, angoisse obsessionnelle que les parents peuvent infliger à leurs enfants afin qu’ils ne triment pas à leur tour en occupant les postes d’invisibles de la société. Nous passons notre vie à entendre ces faux éloges sur les Portugais les qualifiant de “bosseurs” et de “discrets” pour masquer la réalité qu’ils ont été uniquement appréciés pour avoir été exploités et dociles, avoir fermé leur gueule et avoir fait le sale boulot pour le plus grand bonheur des patrons qui sont eux-mêmes parfois des immigrés.
De même, et pour parler plus largement de tout ce que me rapportent des personnes d’autres origines, il faut supporter les blagues bon enfant sur des clichés, accepter les questions sur notre faciès et notre accent, être pris en pitié par des gens qui disent à notre place ce que nous subissons, être renvoyé aux métiers manuels et non pas sans moqueries déguisées en taquineries, devoir épeler nos noms et corriger trop souvent les fautes. In fine, un immigré est comme un apatride : toujours vu comme un étranger où qu’il aille, soit comme quelqu’un venant d’ailleurs dans son pays d’accueil, soit comme quelqu’un qui ne peut comprendre la vie de ses semblables dans son pays d’origine parce qu’il n’y vit pas. Je n’ai aucun doute que toute personne issue de l’immigration se reconnaîtra dans ces lignes : là est la condition d’existence de ceux que les fachos aiment appeler “Français de papier” quand nous leur opposons notre pièce d’identité.
Généralement, les micro-exclusions dont je fais l’objet se basent surtout sur mon comportement apparent et l’image que je renvoie en fonction des éléments de vie que les gens connaissent de moi. En faisant un tour de la situation de ma personne, je me décrirai comme un individu au comportement passif. Que cela soit en famille, avec les amis ou en dehors de la sphère affective comme au travail, je suis généralement une personne silencieuse et à l’écoute des autres, qui acquiesce à peu près à tout et qui ne prend pas d’initiative. La plupart du temps, ça ne me vient pas à l’esprit de spontanément proposer des choses ou prendre le leadership. On pourrait dire que je suis du genre à me laisser vivre, le type de personne qui n’a pas vraiment d’envies ni d’ambitions et qui ne se donne jamais en spectacle devant les autres. Cette attitude est mal perçue en société prétendument méritocratique où chacun est valorisé pour sa performance. Un bourgeois à qui j’ai eu affaire au travail avait à ce sujet écrit sur son profil LinkedIn “I don’t have dreams, I hunt goals” soit en français “Je n’ai pas de rêves, je chasse des objectifs”. En tant qu’homme, cela est d’autant plus mal perçu, car un homme accompli dans une société patriarcale est un meneur qui n’est “quelqu’un” que quand il s’affirme face et par-dessus les autres et performe sa productivité.
Être obligé de renoncer à sa singularité pour être respecté
Cette personnalité passive qui est la mienne n’est certainement pas un cas isolé. Bien que sa cause soit multifactorielle, elle fait sens quand on la place comme la conséquence d’une subordination de soi sur tous les plans de son existence : à ses parents au cours de l’enfance, à ses professeurs à l’école puis à sa hiérarchie une fois adulte dans le monde du travail. Elle l’est d’autant plus forte quand on grandit avec l’idée que l’on doit faire bonne figure et complaire pour être accepté. Partout et tout au long de notre vie, un rapport hiérarchique condescendant s’institue et façonne notre capacité à nous entretenir avec autrui. Chaque jour, je me retrouve face à un individu plus élevé que moi dans la hiérarchie sociale qui me dit quoi faire, comment le faire et quoi penser et qui va soigneusement m’empêcher de faire corps et œuvre commune avec mes semblables. Je suis renvoyé le plus possible à une position d’exécutant, je ne suis pas incité à réfléchir et je suis infantilisé dans mes tâches en recevant les récompenses et les punitions des dirigeants. Il en va de même du civisme où je suis un électeur, citoyen passif, qui élit des représentants pour tout décider à ma place et me dire ce qui est bon pour moi.
Pour toutes ces raisons, je saisis mieux la raison pour laquelle les gens qui tirent un meilleur parti de la société partent du principe que je n’ai pas besoin d’être consulté quand une décision collective doit être prise. J’affiche une certaine esthétique qui ne dégage pas une aura familière à la leur car je ne l’ai pas et je ne prétends pas la gagner. À partir de ce constat, ils tirent la conclusion que je suis propice à accepter plus facilement que les personnes qui affichent une posture plus charismatique : celles qui leur apparaissent plus cultivées et intelligentes, qui parlent beaucoup et qui font davantage les beaux. Ainsi, lors d’expériences collectives de travail au cours de mes études, je me souviens plusieurs fois ne pas être sollicité par mes collègues, comme si mon opinion était moins importante. Au travail, je remarque que des avis, des aides ou des services d’ordre intellectuel sont demandés plus à d’autres qu’à moi vers qui on se tournera plutôt pour des petites tâches techniques et rébarbatives. Dans le milieu syndical ou associatif, je ne compte plus le nombre de fois où je me présentais à des réunions et découvrais que des personnes avaient déjà tout préparé ensemble de leurs côtés et croyaient me faire plaisir en indiquant qu’elles avaient pensé à moi en incluant telle ou telle référence à tel endroit.
J’ai appris avec le temps que les personnes qui m’écartent ne sont pas inaccessibles pour autant et ces dernières deviennent volontiers plus avenantes si je leur montre des qualités qu’elles apprécient. Une complicité peut naître et je serai alors plus facilement inclus. Il suffit juste de sortir des échanges multilatéraux qui nous étiolent. En les prenant à part, en face à face, elles réalisent que nous avons souvent beaucoup en commun. Malheureusement, on dirait que le respect et l’admiration ne sont parfois reçus que si je renonce un peu à ce qui fait ma singularité ou que je deviens complaisant ou docile et que j’accepte de jouer le jeu. Le respect s’achète et il est d’autant plus cher à payer quand cette transaction doit se faire dans le cadre d’un groupe où chacun est conduit à transformer son comportement pour répondre aux codes sociaux et comportementaux des dominants.
J’ai appris que tout ce qui nous définit est le produit d’une construction sociale qui ne doit en aucun cas être éludée au profit de théories fallacieuses de développement personnel dont la finalité serait l’accomplissement de soi en transigeant de la condition de dominé à celle de dominant. Le défi que nous rencontrons toutes et tous dans nos différents milieux n’est donc pas de nous changer en faisant des efforts pour s’ouvrir aux autres, mais de changer le cadre dans lequel nous évoluons. Un cadre où l’échange et le partage ne consistent plus à dominer les autres pour exister et où le silence a cessé d’être un cri adressé à des sourds qui nous privent de parole.
Photo de couverture : Photo de Kristina Flour sur Unsplash
Pitucho