Francky Vincent le restaurant : c’était un rêve néolibéral à réaliser
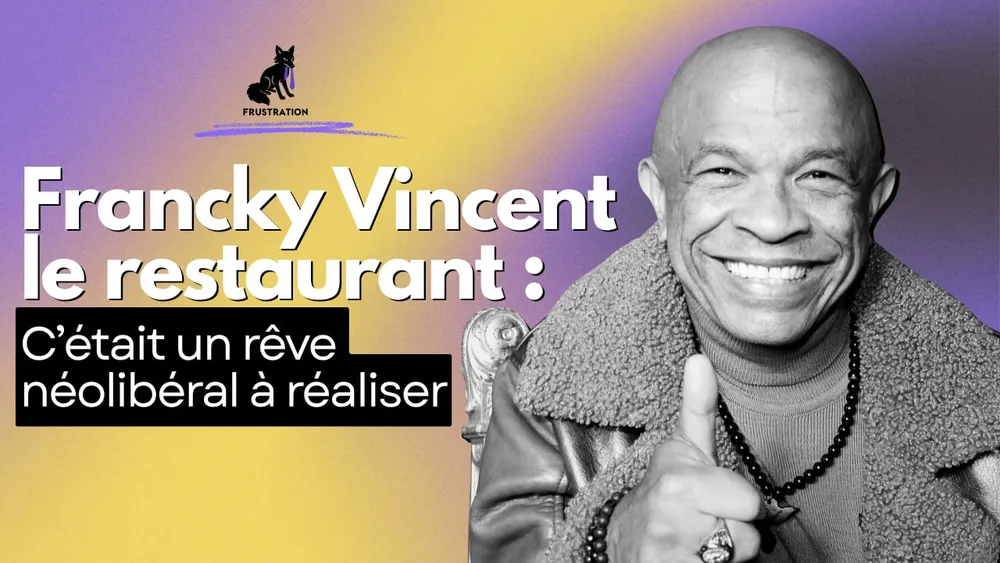
Il y a des chansons d’amour, des chansons de rupture, et puis il y a Droit de réponse, où un chanteur règle ses comptes avec… son personnel. En 2004, Francky Vincent ouvre un restaurant à Thiais en région parisienne. Six mois plus tard, il ferme boutique. Les anciens employés témoignent dans la presse, évoquant conditions de travail infernales et salaires non versés. Francky, piqué au vif, leur répond avec ce qui restera l’un des plus grands manifestes patronaux de la chanson française : « Bande d’enfoirés, si vous trouvez du boulot, n’écrivez pas dans votre CV de merde que vous avez travaillé chez Francky, bande de malpropres. » Le ton est donné : vexé, triomphal, et persuadé d’être du bon côté de l’histoire. Une chanson qui, sans le vouloir, met en musique tout ce que le libéralisme fait de plus grotesque quand il se raconte à la première personne.
“C’était un rêve à réaliser” : le cauchemar salarial du rêve entrepreneurial
« C’était un rêve à réaliser », répète-t-il en boucle. Et c’est là tout le problème : dans le capitalisme, les rêves des uns deviennent les cauchemars des autres. Ce que Francky appelle son “rêve”, c’est un restaurant, un lieu où, concrètement, d’autres vont trimer douze heures par jour pour qu’il vive ce rêve-là. Quand il chante « Avec un personnel de merde qui l’a foutu dans la merde », il ne fait que reformuler une phrase que des millions de salariés entendent dans les couloirs des boîtes, des bars et des hôtels : “le problème, c’est le personnel.” C’est la ligne de défense préférée du petit patron et en particulier du restaurateur : s’il échoue, c’est à cause des autres. Mais quand on travaille dans la restauration, on le sait : ce n’est pas “le personnel” le problème, c’est les horaires coupés, les salaires dérisoires et en retard, les journées de 14h finies à 2h du matin, les pauses inexistantes, et la hiérarchie aussi nerveuse qu’un client devant un ticket de caisse mal compté.
“Les serveurs baisaient dans la chambre froide” : la panique du petit chef
Vient ensuite la litanie des plaintes. « Les ouvriers faisaient venir des prostituées », « le barman roulait des pelles à une serveuse dans la cuisine », « j’ouvre la chambre froide, devinez ce que je vois : un serveur, une serveuse en train de baiser ! »
On pourrait croire à une farce, mais l’entreprise n’est plus ici seulement un lieu de travail, mais un tribunal moral où le patron juge les salariés. Dans le monde de Francky, les salariés ne sont pas des travailleurs, mais des fautifs. Ils “salissent” (“bande de malpropres” “des cochons”), ils “s’en foutent”, ils “n’ont aucun respect”. Ce qu’il décrit comme de la “paresse” ou de la “saleté”, c’est tout simplement la fatigue, le ras-le-bol, le refus de s’investir corps et âme dans un boulot payé au lance-pierre. « Quand j’étais absent, c’était encore pire », dit-il. Évidemment : quand le contrôle se relâche, le travail redevient humain. Les moments de relâchement, d’humour, de solidarité entre serveurs sont perçus comme des trahisons. L’entreprise est, pour le patron Francky, un monde où le moindre espace de respiration devient une faute professionnelle. La restauration est pleine de ces petites tragédies patronales : les employés tiennent le lieu à bout de bras, mais celui qui se croit exploité, c’est toujours le patron.
Et Droit de réponse est sa bande-son.
Il est frappant de se demander en écoutant la chanson : à quoi sert vraiment ce patron ? On comprend qu’il n’a ni fait les travaux, ni le service, ni même le menu. “La bouffe était dégueu, le service était à chier. Le chef cuisinier aussi était à chier. Les accras et le colombo étaient à jeter” nous dit-il. Francky Vincent est l’exemple, assez courant, d’un patron n’ayant aucune espèce de compétence dans le domaine dans lequel il prétend s’investir.
“N’oubliez jamais que je suis le patron” : la chanson des affects patronaux
Le morceau culmine sur un cri : « N’oubliez jamais que je suis le patron ! » Pas “le responsable”, pas “le chef”, non, le patron, au sens métaphysique. Celui qui “donne du travail”, celui à qui on doit tout, celui dont l’autorité devient vertu morale. C’est exactement ce qui rend cette chanson si passionnante : c’est la parole brute et émotive du patronat comme exploiteur, et sa tendance à se positionner au contraire comme victime. « Ils m’ont attaqué dans la presse, les médias. Droit de réponse, je réponds à ma façon. » Il a perdu de l’argent, du prestige, il a souffert, donc il a raison. Ce discours, on le retrouve partout aujourd’hui : dans les vidéos d’entrepreneurs qui pleurent sur LinkedIn, dans les restaurateurs qui “n’en peuvent plus des charges”, dans les patrons de PME qui se sentent “trahis” par leurs salariés qui partent. C’est la même rengaine : la souffrance patronale comme vérité du monde. Mais le marxisme, lui, a un autre mot pour ça : la contradiction. C’est le cœur du système capitaliste, où deux forces opposées, le capital et le travail, dépendent l’une de l’autre tout en s’affrontant sans cesse. Autrement dit, le patron et le salarié ne se détestent pas par accident : ils incarnent un rapport de production qui les met structurellement en conflit. Le petit patron incarne la tension entre capital et travail. Il veut être libre, mais sa liberté repose sur le travail des autres. Et quand ces autres refusent de s’épuiser pour lui, il crie à la trahison. Francky Vincent, sans le savoir, a mis cette contradiction en musique. C’est la complainte du capitalisme de proximité : touchante, ridicule, humaine.
La lutte des classes en tabliers
Droit de réponse n’est pas juste une chanson ratée : c’est un document sociologique, un autoportrait du capitalisme français, où l’exploitation est revendiquée et la hiérarchie hurlée. Francky Vincent n’a pas inventé la complainte des petits patrons de la restauration mais il l’a chanté très fort.
Farton Bink
Vidéaste et autrice

