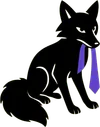Plongée dans l’extrême droite radicale. Entretien avec Sébastien Bourdon

Pour combattre efficacement son ennemi, ou a minima s’en protéger, le préalable est de le connaître. Or sur le sujet de l’extrême droite, notre appréhension du phénomène est encore parfois sommaire : on la voit comme un camp unifié (“les fachos”), sans tensions ni contradictions. C’est donc tout l’intérêt d’une enquête comme celle qu’à menée Sébastien Bourdon, journaliste indépendant, anciennement au Monde, et spécialiste de l’extrême droite dans son ouvrage Drapeau noir, jeunesses blanches. Enquête sur le renouveau de l’extrême droite radicale (Seuil, 2025) : situer les différentes idéologies, les réseaux, les structures, les méthodes d’actions, les grandes figures. Il a accepté de répondre à nos questions.
Définition, courants et liens avec le RN
Vous utilisez le terme « extrême droite radicale » plutôt que celui, plus habituel, d’ « ultra-droite ». En quoi permet-il de mieux comprendre sur les réalités idéologiques et organisationnelles de ce milieu aujourd’hui ?
J’ai voulu faire simple, en m’appuyant sur les définitions et la terminologie utilisées par les universitaires, et notamment par Nicolas Lebourg, qui est l’un des historiens les plus reconnus sur ces questions. Je me suis contenté de reprendre et de citer ses définitions.
L’intérêt de parler d’« extrême droite radicale » plutôt que d’« ultra-droite », c’est d’abord que le terme d’ultra-droite est un terme policier, issu des services de renseignement. Il ne veut pas dire grand-chose en tant que tel. Historiquement, dans les années 1990, une réforme des services de renseignement leur interdit de surveiller les partis politiques. Or, comme il existe des partis politiques d’extrême droite, cela pose un problème terminologique. La solution trouvée a été de créer la catégorie d’« ultra-droite », définie comme l’extrême droite qui n’est pas organisée en parti politique — et que l’on peut donc légalement surveiller. Cette catégorie peut avoir un intérêt du point de vue des services de renseignement, mais elle dit peu de choses sur les réalités idéologiques ou organisationnelles des groupes concernés. En tant que journaliste, je n’ai d’ailleurs jamais été très à l’aise avec ce terme, que je n’ai utilisé que lorsqu’il m’était imposé dans certains médias.
Se pose ensuite une question qui fait débat : pourquoi ne pas utiliser simplement « extrême droite » pour parler de l’ensemble de ces acteurs ? Certains considèrent que créer une catégorie spécifique introduit une distance artificielle entre les partis d’extrême droite, comme le RN, et ces groupuscules, laissant penser qu’il s’agirait de phénomènes radicalement différents. C’est là que je me réfère de nouveau au travail de Nicolas Lebourg, qui a théorisé la notion d’extrême droite radicale. L’idée est la suivante : l’extrême droite, si l’on résume, a pour projet une reprise en main autoritaire de la nation — c’est à peu près ce que tout le monde identifie. Ce qui distingue l’extrême droite radicale, et que je trouve particulièrement pertinent pour les groupes sur lesquels je travaille, c’est qu’il ne s’agit pas seulement d’un projet autoritaire. On y trouve aussi la volonté d’une véritable révolution anthropologique, de la création d’un « homme nouveau », une dimension que l’on retrouve historiquement dans les fascismes, notamment le fascisme et le nazisme. De ce point de vue, ces groupes sont plus radicaux que des partis comme le RN. Cela ne signifie pas qu’ils n’appartiennent pas à un même ensemble, ni qu’il n’existe pas de passerelles ou de liens. Mais, qu’on le veuille ou non, si l’on se place au niveau des programmes et des idées affichées, ce que défendent le RN ou Reconquête n’est pas exactement la même chose que ce que portent des groupuscules néofascistes, néonazis ou identitaires — avec, au sein même de ces groupes, des degrés de radicalité variables.
Justement puisqu’on parle des liens entre extrême droite radicale, RN et Reconquête : quelle est aujourd’hui la relation entre l’extrême droite radicale et l’extrême droite institutionnelle ? La dédiabolisation a-t-elle réellement coupé les ponts ou existe-t-il toujours une forte porosité ?
Il existe toujours une porosité, très clairement, mais elle a beaucoup évolué. Dans l’imaginaire grand public — et dans la dénonciation historique des liens entre le RN, et auparavant le FN, et l’extrême droite radicale — on a souvent en tête le schéma des années 1980-1990 : celui des skinheads néonazis violents, présentés comme les « gros bras » du parti, chargés du service d’ordre, du collage d’affiches, etc. Cela s’est incarné notamment pendant un temps avec le DPS, le service d’ordre du FN, notoirement composé, pour partie, de militants néonazis violents.
Ce que l’on constate sur la dernière décennie, avec la stratégie de dédiabolisation du RN, c’est que ces liens-là ont eu tendance à s’amoindrir. Cela ne veut pas dire qu’il n’arrive plus jamais que des militants néonazis collent des affiches ou assurent la sécurité lors d’événements, mais le RN cherche désormais clairement à les mettre à distance, voire à s’en débarrasser, car en termes d’image ce n’est plus tenable. De ce point de vue, la porosité visible, militante, s’est largement réduite.
En revanche, là où il existe une porosité qui perdure — et qui s’est même en partie renouvelée — c’est à un tout autre niveau, et politiquement beaucoup plus problématique : celui des attachés parlementaires. Depuis les élections législatives et européennes de 2022 et 2024, le RN a obtenu un nombre très important de députés et de députés européens — 122 à l’Assemblée nationale. Or, qui dit députés dit deux, trois ou quatre collaborateurs par élu. Cela représente, en très peu de temps, 300 à 400 jeunes recrues à embaucher. La question devient alors : où le RN va-t-il chercher ces profils ? En partie du côté de groupuscules plus ou moins radicaux. Cela peut être Génération identitaire pour les profils considérés comme les « moins radicaux », ou, pour d’autres, des personnes ayant un passé violent. Le RN recrute là parce que ces jeunes militants partagent un socle idéologique commun avec l’extrême droite institutionnelle : c’est précisément là que se situent les convergences idéologiques. Mais aussi parce qu’ils disposent déjà d’une expérience militante. Être passé par Génération identitaire, le Bastion social ou d’autres structures similaires, c’est avoir appris le b.a.-ba : écrire et distribuer des tracts, coller des affiches, rédiger des contenus, prendre des photos, gérer une page Facebook, etc. Pour le RN, c’est donc très attractif : ces profils sont globalement acquis à la cause, déjà formés, jeunes, et acceptent des postes d’attachés parlementaires peu rémunérés — des emplois que l’on occupe rarement pour l’argent, mais « pour la cause ».
Si je résume, les porosités et les passerelles existent toujours, mais elles se sont transformées. Aujourd’hui, elles s’incarnent beaucoup moins dans les services d’ordre ou le militantisme de rue que dans le recrutement des attachés parlementaires.
Votre enquête montre que ce n’est pas un camp unifié ou monolithique : nationalistes-révolutionnaires, monarchistes, identitaires… Comment cohabitent ces courants ? Qu’est-ce que ce syncrétisme que, comme vous nous l’apprenez, ces militants qualifient de “polyfaferie” ou de tendance “panfaf” ?
Ils sont assez créatifs sur le vocabulaire (rires), donc c’est pratique. Mais, en réalité, la question de la coexistence entre différentes tendances — des « chapelles » — est déjà en partie dépassée au moment où je publie mon livre, et elle l’est de plus en plus avec le temps. C’est d’ailleurs l’un des points que j’essaie de démontrer. De ce point de vue-là, il y a clairement un avant et un après, et ce qui fait bascule, c’est la séquence des dissolutions de groupes, essentiellement entre 2019 et 2021, même s’il y en a eu d’autres par la suite. Pour les organisations les plus importantes, c’est vraiment là que tout change.
La première dissolution majeure, c’est celle du Bastion social en 2019. Avant cette période, on pouvait identifier trois grands courants au sein de l’extrême droite radicale : les nationalistes-révolutionnaires, les identitaires et les royalistes. Chacun était plus ou moins incarné par une organisation active à l’échelle nationale. Ces groupes cohabitaient — ou plutôt coexistaient — mais entretenaient en réalité assez peu de liens entre eux. Il y avait une forme de concurrence politique, puisque ces organisations se disputaient un même terreau militant, notamment en termes de recrutement. Elles avaient donc tout intérêt à se distinguer les unes des autres, en se présentant comme plus ou moins radicales, ou en mettant en avant certaines thématiques spécifiques. Avant les dissolutions, on avait donc trois courants, trois organisations nationales, avec peu de coopération. Bien sûr, des individus pouvaient passer d’une structure à une autre, mais, en tant qu’organisations, elles ne travaillaient pas ensemble — et pouvaient même entrer en conflit, se disputer, voire s’affronter physiquement. À partir des dissolutions successives — celle du Bastion social en 2019, puis de Génération identitaire en 2021, et d’autres ensuite — deux de ces trois organisations centrales disparaissent. La seule qui subsiste parmi les structures initiales, c’est l’Action française pour le courant royaliste, qui était déjà relativement marginale et qui est aujourd’hui la moins « attractive ». Les deux autres, en revanche, ont disparu.
La conséquence est importante : à partir du moment où disparaît l’enjeu de la concurrence à l’échelle nationale, on assiste à une reconfiguration du paysage, avec la multiplication de petites structures à l’échelle locale. On passe d’organisations nationales à une constellation de groupes locaux. Or, à cette échelle, les effectifs sont très réduits. Dans une ville comme Paris, ces groupes réunissent souvent 10, 15 ou 20 personnes. S’il existe deux structures de cette taille dans une même ville, elles ont tout intérêt à travailler ensemble, voire à s’unir. Ils peuvent conserver des structures séparées, mais dès qu’il s’agit de mener des actions plus « spectaculaires », notamment violentes, la logique est celle du rassemblement : à 15, on est peu visibles ; à 30, on l’est davantage. C’est l’un des effets directs des dissolutions successives, et c’est un phénomène réellement nouveau. Dans la seconde moitié des années 2010, on ne voyait pas, par exemple, des actions violentes menées conjointement par le Bastion social et Génération identitaire. Chacun agissait de son côté, sans alliances de ce type.
Aujourd’hui, cette dynamique s’incarne dans toute une série d’événements que je décris dans mon livre. On peut citer notamment les mobilisations de Saint-Brevin-les-Pins contre l’implantation d’un Cada (Centres d’accueil pour demandeurs d’asile). Lors de la seconde mobilisation, ils sont quasiment une centaine de militants d’extrême droite sur la photo de revendication, avec des signatures de dix ou quinze groupes différents, issus de chapelles variées — ce qui est totalement inédit. On observe le même phénomène lors de la tentative de descente raciste à Romans-sur-Isère, après l’affaire de Crépol : ils sont environ 80, de mémoire, un dimanche soir, quelques jours seulement après les faits, venant des quatre coins de la France et de toutes les tendances possibles et imaginables. Ça, c’est clairement nouveau.
Action Française, GUD, implantation géographique et sport
Vous venez d’évoquer l’Action française. Dans le livre, vous revenez aussi à de nombreuses reprises sur le GUD. Pouvez-vous nous dire de quoi il s’agit et quelle est aujourd’hui l’influence réelle de ces deux organisations ?
Si l’on prend les choses chronologiquement, l’Action française joue un rôle important dans le renouveau de l’extrême droite radicale, même si Nicolas Lebourg considère qu’elle n’en fait pas strictement partie — j’emploie ici le terme dans un sens un peu plus large. L’Action française retrouve une visibilité particulière au moment de la Manif pour tous, entre 2013 et le milieu des années 2010. À cette période, elle apparaît comme l’une des organisations les plus structurées et les plus actives dans la contestation de rue. Cela lui redonne une forme de « street cred », et attire toute une génération de très jeunes militants — souvent adolescents à l’époque — qui cherchent un cadre pour s’engager politiquement. À Paris notamment, mais pas uniquement, l’Action française devient alors un point d’entrée. C’est le cas, par exemple, de Marc de Cacqueray-Valménier, qui rejoint l’Action française dans ce contexte. Il y a aussi, chez certains, une dimension de tradition familiale : dans son cas, ses parents sont proches de l’Action française, son père y est passé, et pour ses 14 ans, son cadeau d’anniversaire est un abonnement au journal du mouvement. L’Action française apparaît alors comme une organisation « cool », visible, dynamique.

Mais assez rapidement, cette nouvelle génération de militants se rend compte que cette « street cred » est relative. Il existe des groupes perçus comme plus radicaux — et donc, dans cet univers militant, plus « sexy ». En l’occurrence, le GUD, qui renaît difficilement au début des années 2010. Une partie de ces jeunes passés par l’Action française va alors basculer vers le GUD. Le groupe changera ensuite de nom — Bastion Social d’une part, et Zouaves Paris dans la capitale. La séquence la plus intéressante concernant le GUD, c’est sa reformation à Paris sous l’impulsion de Marc de Cacqueray-Valménier, fin 2022 après les grandes vagues de dissolutions. Et c’est là que l’on touche à l’absurdité de certaines dissolutions administratives. Dissoudre des structures comme le Bastion social ou Génération identitaire peut se discuter : ce sont des organisations avec une existence légale, des locaux, des comptes bancaires. Mais les Zouaves Paris, c’est avant tout une bande d’une quinzaine de militants néonazis qui agressent des gens dans la rue. Ce n’est pas une association loi 1901, il n’y a pas de compte bancaire « Zouaves Paris ». Dissoudre les Zouaves Paris, concrètement, cela revient à dire à quinze nazis : « vous n’avez plus le droit de vous appeler comme ça ». Ils changent simplement de nom. Cela ne sert pas à grand-chose, si ce n’est à produire de la communication politique et des effets d’annonce — notamment quand on s’appelle Gérald Darmanin et qu’on veut montrer qu’on lutte contre l’extrême droite. De fait, après la dissolution des Zouaves Paris, la même bande réactive le nom GUD Paris. Ce sont quasiment les mêmes quinze militants, à quelques variations près. Et c’est là que la dissolution est contre-productive : en réactivant le sigle GUD, les militants récupèrent un nom encore plus chargé symboliquement, avec toute la filiation historique, l’imaginaire des Rats noirs, etc. C’est trivial, mais central dans ces milieux : le « street cred », la radicalité, l’image comptent énormément. Être radical — ou jouer à l’être —, c’est attractif. Résultat : le GUD regagne de l’influence, attire de nouveaux militants, jusqu’à sa dissolution, en 2024. Après cette dissolution, ils perdent ce nom-là et en adoptent un nouveau, Hussards Paris, qui est nettement moins « vendeur ». Et mécaniquement, ils perdent aussi en influence. Il n’y a évidemment pas que ça, mais ce facteur symbolique joue clairement un rôle.
On considère souvent que Lyon est un des QG de cette extrême droite radicale. Est-ce que vous l’avez aussi constaté ? Et si oui, comment l’expliquer ?
Historiquement, Lyon est clairement une place forte de l’extrême droite radicale en France, et ce depuis au moins une quinzaine d’années. On peut l’expliquer notamment par l’implantation durable de locaux dans la ville. Il y en a eu plusieurs successivement. Sur les dix ou quinze dernières années, les plus significatifs sont la Traboule et l’Agogé, un bar et une salle de sport situés côte à côte. Ouvrir des locaux, pour n’importe quelle organisation politique, est un enjeu central. Cela permet d’avoir des lieux de sociabilité, une vitrine, un point de ralliement. Les militants peuvent s’y retrouver, s’organiser, préparer des actions, mais ces lieux servent aussi énormément au recrutement. Il est bien plus facile, pour une organisation d’extrême droite, de dire à des jeunes : « viens boire une bière dans notre bar, le bar cool de Lyon, pour la fête de la bière ou Halloween », que de leur proposer directement de distribuer des tracts ou de coller des affiches à trois heures du matin. La même logique vaut pour le sport. Dire à un jeune « viens faire de la boxe avec nous mercredi » est beaucoup plus attractif que de lui proposer une activité militante classique. C’est cette implantation historique de locaux, notamment dans le Vieux Lyon, qui a largement contribué à faire de la ville une place forte. Depuis la fermeture de ces lieux, on observe d’ailleurs une perte de vitesse relative de l’extrême droite radicale à Lyon.
Ce qui est intéressant, d’un point de vue géographique, c’est que ces dernières années on assiste à un déplacement partiel du phénomène. Là où l’extrême droite radicale était historiquement surtout implantée dans les grandes villes — Lyon, Paris notamment — on voit désormais une multiplication de groupes dans des villes moyennes, des petites villes, voire en milieu rural. Très concrètement, toutes les deux semaines, je découvre un nouveau groupe sur Instagram : « les nazis de telle ville », « les nationalistes-révolutionnaires de tel département », dans des territoires où il n’y avait jusque-là aucune structuration visible. Il pouvait y avoir les trois skinheads nazis du coin qui traînaient sur le parking d’un supermarché, mais pas de groupe politique organisé. Aujourd’hui, on observe une véritable structuration. Enfin, pour conclure sur la dimension géographique, un autre phénomène marquant ces derniers temps est l’implantation croissante de ces groupes en Bretagne. Historiquement, ce n’est pas une région où l’extrême droite, qu’elle soit radicale ou non, était particulièrement active. Or, ces derniers mois, la dynamique s’y est nettement accélérée, et les groupes locaux ont beaucoup fait parler d’eux.
À cela s’ajoute le phénomène des Active Clubs. Il s’agit d’un réseau transnational de groupes de sport se présentant comme « nationalistes », mais qui sont en réalité des groupes néonazis. Le modèle vient des États-Unis et s’est implanté en France il y a quelques années. En très peu de temps, ils ont revendiqué l’ouverture de plusieurs dizaines de sections sur l’ensemble du territoire, notamment en milieu rural. Je les recense dans le livre, et je dois dire que j’ai parfois découvert l’existence de certains endroits à travers les Active Clubs. Il y a par exemple une commune de 160 habitants dans la Manche où ils affirment avoir une section. Concrètement, c’est sans doute deux adolescents qui font du sport sur le terrain municipal, mais le fait même qu’ils aient pris contact avec ce réseau pour revendiquer une « section » n’est pas anodin.
Violences et menace “terroriste”
Vous documentez des violences racistes et politiques. Comment l’extrême droite radicale se positionne-t-elle aujourd’hui par rapport à la violence : est-ce un outil central, une option tactique, ou un discours surtout performatif ?
Ça dépend des organisations. Si on résume, l’Action française, même si ce sont un peu les plus « has been » du lot, cherche à intellectualiser la question, en mobilisant de grandes références historiques liées à l’histoire de l’Action française (la « violence au service de la raison »). Ils affirment ne pas être violents, tout en revendiquant l’existence d’un service d’ordre très musclé. Le message c’est « si vous venez vous frotter à nous, on saura se défendre ».
Génération identitaire, de son côté, a longtemps construit toute sa stratégie de communication sur la revendication de la non-violence. Cela ne veut pas dire que des militants n’aient jamais eu recours à la violence, mais, en tant qu’organisation, ils la refusaient officiellement. Ils jouaient beaucoup sur cette image, allant jusqu’à se présenter comme le « Greenpeace de droite ». L’idée était que la violence est un repoussoir pour le grand public, et qu’il fallait rompre avec l’image du skinhead néonazi violent pour apparaître comme un mouvement « respectable ». Cette stratégie a plutôt bien fonctionné pendant un temps, en termes de visibilité et de diffusion des idées. In fine, ils ont tout de même été dissous, ce qui marque aussi l’échec partiel de cette ligne, mais elle a joué un rôle réel pendant plusieurs années. Pour compléter ce point sur Génération identitaire, il faut aussi souligner un élément important : le sentiment, chez une partie de leurs anciens militants, d’avoir « joué le jeu » de la légalité pendant des années pour, au final, être dissous quand même. De là naît l’idée que respecter les règles du système ne sert à rien. Si l’on est dissous quoi qu’il arrive, autant assumer pleinement la violence, ou, à tout le moins, ne plus se restreindre. On observe très clairement ce changement aujourd’hui.
Du côté des nationalistes-révolutionnaires, on observe des allers-retours. Pendant la période du Bastion social, entre 2017 et 2019, ils ont eux aussi tenté de lisser leur image en s’inspirant de Génération identitaire. Cela n’a pas très bien fonctionné : ils ont rapidement été rattrapés par des affaires de violences. En théorie, pourtant, la ligne affichée était similaire — « nous ne sommes pas violents, nous sommes respectables ».
Depuis les dissolutions successives, et c’est l’un de leurs effets majeurs, le recours à la violence est en revanche beaucoup plus assumé, et devient même central. Le modèle qui s’est imposé est celui de groupes informels comme les Zouaves Paris. Or, ces groupes informels sont avant tout des groupes de bagarre, structurés autour de l’action violente et de l’agression. La « légende » des Zouaves Paris, au sein de l’extrême droite radicale, tient précisément au fait qu’ils incarnent cette violence pure : ils ont, pour ainsi dire, écrit deux tracts en quatre ans, et leur programme politique, c’est la violence. On voit d’ailleurs se diffuser de plus en plus un slogan comme « anti-antifa », qui résume bien cette logique. Il s’agit d’aller frapper les antifascistes, les « gauchistes », ou toute personne assimilée comme telle — des catégories très floues dans leurs représentations. La violence occupe donc aujourd’hui un rôle de plus en plus central dans la structuration de ces groupes. Cela se traduit par des actions de plus en plus directes et assumées, comme, récemment, la descente des Hussards Paris vers Strasbourg–Saint-Denis contre la projection d’un film de Costa-Gavras. La cible était très clairement la Jeune Garde, et ce type d’opération illustre bien la place désormais centrale de la violence dans ces milieux.
Toujours sur la question de la violence, l’extrême droite radicale parle de plus en plus de guerre civile. S’agit-il d’une rhétorique mobilisatrice ou observe-t-on de réelles formes de préparation paramilitaire et une menace terroriste structurée ?
Il y a effectivement l’émergence d’une menace terroriste structurée (même si le terme “terrorisme” peut faire débat). Les autorités évoquent une dizaine d’affaires terroristes d’extrême droite ces dernières années — Gérald Darmanin avait communiqué sur le sujet. Ce qui est certain c’est qu’on observe une augmentation nette du nombre d’affaires qualifiées comme telles. Il faut rappeler que la qualification « terroriste » est elle-même discutée. De nombreuses actions violentes d’extrême droite — parfois mortelles — n’ont pas été classifiées comme du terrorisme. Mais si l’on s’en tient strictement aux dossiers reconnus comme tels par les autorités, on constate bien une montée en puissance.
Cela dit, les profils impliqués dans ces affaires sont assez différents de ceux des jeunes militants sur lesquels je travaille principalement. On retrouve souvent des profils plus âgés : des quadragénaires, quinquagénaires, parfois des retraités, comme dans les dossiers de l’AFO (Action des forces opérationnelles) ou des Barjols, avec des projets d’attentats relativement structurés. On est là sur un autre type de sociologie. Concernant les plus jeunes, deux phénomènes méritent attention. D’une part, certains projets terroristes récents impliquent des profils très jeunes, parfois mineurs — ce qui n’est pas propre à l’extrême droite, mais que l’on retrouve dans différentes formes de radicalisation violente. D’autre part, et c’est à mes yeux le point le plus préoccupant, se pose la question de l’Ukraine.
Depuis l’invasion russe de 2022, un certain nombre de militants d’extrême droite sont partis combattre en Ukraine. Cela a été documenté, et je dois d’ailleurs publier prochainement un article sur le sujet. Parmi eux, il y a des individus très clairement néonazis, qui acquièrent sur place une expérience du combat et du maniement des armes. Certains ont déjà effectué des allers-retours en France, et tôt ou tard se posera la question de leur retour définitif. Deux militants, par exemple, ont été interpellés à leur retour d’Ukraine avec du matériel militaire — chargeurs de fusil d’assaut, lunettes de visée — même s’ils n’avaient pas d’armes à proprement parler. Ils ont été incarcérés, puis sont repartis. Ce type de cas n’est pas isolé. Ces derniers mois, on observe même une accélération du nombre de départs vers l’Ukraine de militants issus de l’extrême droite radicale. La question qui se pose est donc celle des « revenants ». De la même manière qu’on s’est interrogé, à juste titre, sur le retour de combattants passés par la Syrie, la problématique se posera pour les ressortissants français — ou d’autres pays européens — ayant combattu en Ukraine et acquis une expérience militaire. Avec une différence majeure : l’Ukraine est beaucoup plus proche géographiquement, frontalière de l’espace Schengen. Une fois entré en Pologne, il est extrêmement simple de circuler jusqu’en France. À mon sens, la principale menace liée à l’extrême droite radicale dans les cinq, dix ou quinze prochaines années se situe là. Elle dépendra évidemment de l’évolution du conflit — victoire, défaite, accord de paix, et dans quelles conditions — mais la question du retour de combattants formés est un enjeu majeur qu’on ne peut pas évacuer.
Russie-Ukraine, Israël-Palestine, Alain Soral et l’antisémitisme
Puisqu’on en parle : la sympathie du RN pour la Russie de Vladimir Poutine est régulièrement dénoncée. N’y a-t-il pas là un désalignement ? Comment l’extrême droite radicale se positionne-t-elle face à la guerre en Ukraine ?
L’opposition ne se résume pas à un clivage entre un RN pro-russe et des radicaux pro-ukrainiens. Il s’agit avant tout d’une fracture générationnelle.

Aujourd’hui, environ 95 % de la jeune génération militante d’extrême droite est pro-ukrainienne. Depuis Maïdan, en 2014, cette génération est très admirative de la révolution ukrainienne et de ce qui a suivi, notamment de l’ensemble de la mouvance nationaliste ukrainienne, autour du régiment Azov et de ses différentes incarnations. Depuis lors, cette génération est clairement pro-Ukraine.
À l’inverse, en 2014, au début de la guerre du Donbass, la génération précédente de militants d’extrême droite partait majoritairement combattre du côté russe. On observe donc un basculement générationnel très net.

Ce basculement a notamment été impulsé par des figures comme Marc de Cacqueray-Valménier, l’un des premiers militants français à se rendre sur place et à tisser des liens avec ces structures. Numériquement, aujourd’hui, j’ai connaissance de trois Français combattant du côté russe. Du côté ukrainien, y compris parmi des militants néonazis, on en compte des dizaines. Il y a aussi une dimension très symbolique, presque esthétique : être pro-russe est désormais perçu comme « has been », là où être pro-ukrainien est jugé beaucoup plus valorisant, notamment en raison de la communication très efficace autour du régiment Azov. Ce qui est particulièrement intéressant, c’est que la perception actuelle de la guerre en Ukraine chez ces jeunes militants fait directement écho à la représentation du front de l’Est dans la propagande nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. Beaucoup de Français engagés en Ukraine se revendiquent explicitement des unités de volontaires français de l’époque, comme la Légion des volontaires français contre le bolchevisme ou la division SS Charlemagne. Leur discours consiste à dire que la Russie d’aujourd’hui serait l’équivalent de l’Union soviétique d’hier : une menace « asiatique » et « bolchevique » déferlant sur l’Europe blanche. Dans cette vision du monde, combattre en Ukraine revient à défendre l’Europe blanche face à ces « hordes » — une rhétorique directement héritée de l’imaginaire nazi.
Toujours sur les questions internationales : comment se positionne l’extrême droite radicale face à la guerre en Israël-Palestine ? Cette question en amène une autre : beaucoup de commentateurs affirment que l’antisémitisme serait devenu marginal à l’extrême droite. Votre enquête confirme-t-elle cette idée ? Les événements depuis octobre 2023 changent-ils quelque chose à cet égard ?
L’antisémitisme n’est absolument pas marginal au sein de l’extrême droite, et encore moins au sein de l’extrême droite radicale. En revanche, ce qui est en partie vrai, c’est qu’en termes de discours public et de désignation de la « cible prioritaire », on observe une évolution qui remonte au début des années 2000. Cette évolution a notamment été théorisée par la mouvance identitaire, en particulier Génération identitaire. Après les attentats du 11 septembre 2001, l’idée s’impose que l’extrême droite française historique — très largement, voire structurellement antisémite — serait devenue « has been ». Le nouvel ennemi désigné serait désormais le Musulman, ou plus précisément l’« Arabo-musulman ». Bien sûr, dans leur vision du monde, les dimensions raciale et religieuse sont étroitement imbriquées. À partir de là, toute une partie de l’extrême droite recentre son discours sur l’islam : opposition à la construction de mosquées — comme l’action fondatrice de Génération identitaire à Poitiers contre une mosquée — puis, plus largement, sur les thèmes du “grand remplacement”, de “l’islamisation”, de “l’ensauvagement”, etc. Dans les discours contemporains de l’extrême droite radicale, l’ennemi le plus explicitement mentionné n’est donc plus le Juif, mais l’Arabo-musulman.
Cela dit, l’antisémitisme reste omniprésent en arrière-plan. Il est notamment central dans la théorie du « grand remplacement » telle qu’ils la formulent : il ne s’agirait pas seulement de flux migratoires ou de dynamiques démographiques, mais d’un processus délibérément orchestré. Or, qui serait à l’origine de cette orchestration ? Des « élites mondialistes », immédiatement associées, dans leur imaginaire, à des figures juives ou à des intérêts juifs — Rothschild, les lobbys, tout l’arsenal classique des tropes antisémites. Autrement dit, l’antisémitisme n’a pas disparu : il est simplement moins frontal, moins assumé publiquement.
Concernant les événements depuis octobre 2023, je ne pense pas qu’ils aient fondamentalement transformé cette réalité. En revanche, on observe une certaine confusion idéologique au sein de l’extrême droite radicale. Certains militants semblent hésiter sur la hiérarchie de leurs haines : qui détestent-ils le plus, les Arabes ou les Juifs ?

Historiquement, c’est intéressant à rappeler, les nationalistes-révolutionnaires — et notamment le GUD — se sont longtemps positionnés comme pro-palestiniens. Cela s’inscrit dans une tradition pseudo anti-impérialiste : l’idée selon laquelle ils soutiendraient toutes les « luttes nationales », avec ce discours consistant à dire « nous ne sommes pas racistes, chacun doit simplement rester chez soi : les Palestiniens en Palestine, les Français en France ». Dans ce cadre, leur antisionisme fonctionne très clairement comme un masque, ou une déclinaison, de leur antisémitisme. Depuis 2023, on observe en partie une réactivation de cette ligne : certains groupes continuent de se revendiquer pro-palestiniens, et les événements récents sont mobilisés pour illustrer ce qu’ils décrivent comme la « barbarie juive », justifiant à leurs yeux le soutien à la cause palestinienne.
En parallèle, d’autres groupes adoptent une position plus floue et sont incapables de trancher, ils développent un discours de type « ni-ni » : le conflit ne concernerait pas la France, il ne faudrait pas l’importer, « les deux camps se valent », et, au fond, qu’ils se massacrent entre eux.
Aussi sur l’antisémitisme, il y a un groupe que vous n’évoquez pas beaucoup dans le livre, c’est Egalité et Réconciliation d’Alain Soral – on sait pourtant que c’est quelqu’un qui a été très écouté par les militants d’extrême droite, qui a eu une grosse force de frappe sur Internet. A t-il eu et a-t-il encore une influence au sein de cette extrême droite radicale selon vous?
Oui, Alain Soral a très clairement eu une influence — et il en a encore, même si elle est aujourd’hui en déclin. Mais si j’en parle peu dans le livre, c’est parce qu’il existe, au sein de l’extrême droite radicale, une distinction assez nette entre deux sphères : la sphère en ligne et la sphère de la rue.

Autant Soral a été — et reste dans une certaine mesure — une figure centrale de la « fachosphère », avec une capacité de diffusion idéologique considérable sur Internet, autant, chez les militants de terrain sur lesquels je travaille, il n’est pas une référence majeure. Cela tient beaucoup à une logique de « street cred » très présente dans ces milieux : pour eux, parler sur Internet, produire des vidéos ou des discours en ligne, ce n’est pas considéré comme très valorisant. Ce qui compte, c’est d’être dans la rue, d’assumer physiquement ses idées. Certains militants sont même ouvertement moqueurs vis-à-vis des sphères en ligne. J’ai déjà vu des militants d’extrême droite se moquer des incels par exemple, les qualifier de « ratés », de « boloss », de « sous-hommes » qui passeraient leur temps à se plaindre derrière un écran.
Il y a aussi un désaccord idéologique de fond avec Alain Soral, notamment sur la « question raciale », pour reprendre leur sémantique. Sur l’antisémitisme, il n’y a évidemment aucun doute : Soral est profondément antisémite. En revanche, sa ligne politique sur l’immigration est plus ambiguë. Le projet d’« Égalité et Réconciliation » repose sur l’idée qu’un Arabe peut être un « bon Français », à condition de renoncer à sa culture arabo-musulmane — (qu’il boive du vin, mange du porc, etc). Autrement dit, chez Soral, la race ne serait pas totalement centrale, du moins en théorie. C’est précisément ce qui a nourri l’affrontement entre Soral et Conversano. Et sur ce point, les militants que j’étudie sont très clairement ailleurs. Ils sont engagés sur une ligne de plus en plus ouvertement raciale, assumant l’idée qu’être français — ou européen —, c’est être blanc. Dans cette perspective, un Arabe aura beau aller à l’église, manger du saucisson et boire du vin, cela ne change rien : il restera arabe, et donc, à leurs yeux, ne sera jamais un Français. Cette ligne est aujourd’hui de plus en plus explicite et revendiquée sans détour. On le voit par exemple dans les prises de position de Julien Rochedy, qui a récemment publié un livre et plusieurs vidéos sur ce que signifie « être blanc ». Il a notamment débattu avec Jean-Eudes Gannat — une figure assez en vue de cette mouvance — autour de la question des « patriotes de la diversité ». Leur conclusion est sans ambiguïté : non, ces personnes ne peuvent pas être françaises. Elles peuvent être « sympathiques », « intégrées », mais elles ne seront jamais vraiment françaises. Cette conception raciale, biologisante et de plus en plus décomplexée est aujourd’hui largement dominante chez les militants d’extrême droite radicale de terrain.
Sociologie
Sociologiquement, à qui a-t-on affaire aujourd’hui ? Est-ce que ce sont plutôt des bourgeois cathos bien nés ? Ou des prolos désocialisés comme à l’époque des skinheads britanniques ? En gros : y a t’il un profil type, en termes de classe sociale, d’âge, de genre et de territoires ?
C’est une question difficile, parce que sur l’extrême droite radicale on dispose de très peu de données sociologiques solides. L’accès au terrain est évidemment compliqué : ces militants ne vont pas répondre à des questionnaires. Il est impossible de faire du quantitatif classique sur leurs profils. Les informations dont on dispose proviennent donc essentiellement des dossiers judiciaires, c’est-à-dire des personnes qui ont été arrêtées, poursuivies ou condamnées. Dans ces dossiers, on trouve des éléments biographiques qui permettent au moins d’identifier des tendances.
Ce qu’on observe d’abord — et c’est assez classique historiquement —, c’est que parmi les cadres les plus visibles, les figures médiatisées de l’extrême droite radicale, on retrouve très souvent des profils issus de la bourgeoisie, voire de l’aristocratie. Marc de Cacqueray-Valménier, Jean-Eudes Gannat et d’autres correspondent assez bien à ce stéréotype : familles bourgeoises, catholiques traditionalistes…
Mais est-ce que cela signifie que l’ensemble des militants d’extrême droite radicale correspond à ce modèle ? Non. Je pense par exemple à la Division Martel, un groupuscule néonazi composé essentiellement d’adolescents. Dans les dossiers judiciaires, les profils qu’on voit n’ont rien à voir avec ceux de la grande bourgeoisie. Ce ne sont pas non plus, pour la plupart, des « grands prolos ». On est plutôt sur des trajectoires de petite bourgeoisie ou de classes moyennes : des jeunes issus de zones pavillonnaires, souvent en périphérie des grandes villes ou dans des banlieues lointaines, avec des configurations familiales assez classiques — mère au foyer, père commercial gagnant autour de 2 000 euros par mois, ce genre de choses. On est très loin du profil de Marc de Cacqueray-Valménier, qui a grandi à Saint-Cloud dans un environnement hyper bourgeois.
Rapports à la police et antifas
Je me souviens qu’il y avait eu une polémique lorsque le défilé du C9M de 2023 n’avait pas été interdit par la préfecture de police de Paris, dans un contexte où, par ailleurs, de nombreuses manifestations de gauche étaient interdites. Justement, quel est le rapport de cette extrême droite radicale à la police ? Recrute-t-elle dans les rangs de la police? Inversement, est-ce que la police a un rapport de tolérance vis-à-vis d’elle ?
Il y a deux questions distinctes, même si elles sont liées.
Sur la première — l’interdiction du défilé — il faut rappeler un point factuel : ces deux dernières années, la préfecture de police a bien tenté d’interdire la manifestation du C9M. Simplement, ces interdictions ont été cassées par le tribunal administratif. La manifestation a donc été autorisée mais à l’issue d’un contentieux juridique. Le cœur du débat est juridique, et il dépasse un peu mes compétences, mais l’argument avancé par les juges n’est pas infondé au regard du droit actuel. Pour interdire une manifestation, l’administration doit démontrer qu’il existe un risque de trouble à l’ordre public. Or, aussi choquant que cela puisse paraître politiquement ou moralement, défiler avec des drapeaux noirs, des croix celtiques, même avec les slogans qu’on y entend, ne constitue pas, en l’état du droit français, un trouble à l’ordre public suffisant pour justifier une interdiction. C’est sur ce point précis que la préfecture perd devant le tribunal administratif. On peut évidemment le regretter, critiquer ce cadre juridique, ou en dénoncer les limites, mais sur les deux dernières années, la controverse relève d’un débat strictement juridique. Et politiquement, même si cela reste discutable et en partie un effet de com’, il y a bien eu une tentative d’interdiction.

Sur la seconde question — le rapport entre l’extrême droite radicale et la police — on est face à quelque chose d’ambivalent. D’un point de vue idéologique et discursif, l’immense majorité des militants d’extrême droite radicale sont sur une ligne clairement hostile à la police. Le discours est très largement de type ACAB. Dans leur vision, les forces de l’ordre sont les « chiens du système », des exécutants qui obéissent à l’État et participent directement à leur répression, notamment à travers les dissolutions. Il y a d’ailleurs des épisodes concrets qui nourrissent cette hostilité. L’exemple le plus marquant est sans doute la tentative de descente raciste à Romans-sur-Isère. Une partie de l’action a été empêchée par le déploiement d’un dispositif policier, qui a bloqué l’accès au quartier visé et procédé à plusieurs interpellations. Dans les jours qui ont suivi, les discours de militants d’extrême droite étaient extrêmement virulents : ils accusaient la police de « protéger la racaille », dénonçaient les syndicats policiers se disant « patriotes », et affirmaient que la police faisait désormais partie des ennemis à combattre. De ce point de vue, idéologiquement, la ligne dominante reste très clairement anti-police.
Cela étant dit, cette hostilité de principe n’empêche pas certaines porosités. Il y a des cas avérés de membres des forces de l’ordre impliqués dans ces milieux. Et de ce point de vue, on observe davantage de militaires — ou d’anciens militaires — que de policiers, même si ces derniers ne sont pas absents. Un exemple parlant : lors des interpellations liées à la tentative de descente raciste après le match France-Maroc, une quarantaine de personnes sont arrêtées. Parmi elles, de mémoire, on trouve un policier et deux ou trois militaires ou ex-militaires. Le policier a été placé en garde à vue, interrogé par ses collègues, mais n’a visiblement pas été inquiété plus que ça. Cela montre l’existence de profils issus des forces de l’ordre dans ces mobilisations.
Vous le montrez dans le livre et vous l’avez dit : les dissolutions ne fonctionnent pas très bien. les organisations se reforment d’une autre façon. Vous avez réalisé en 2023 une enquête sur les antifas (Une vie de lutte plutôt qu’une minute de silence. Enquête sur les antifas, Seuil). Selon vous, et après votre enquête, est-ce que l’action des antifascistes empêche ou du moins ralentit l’implantation de cette extrême droite ?
Oui, dans un certain nombre de cas, l’action de mouvements antifascistes a effectivement pu ralentir, voire empêcher, l’implantation ou le développement de groupes d’extrême droite. Lorsqu’il y a des défaites physiques de l’extrême droite dans la rue, lors d’affrontements ou d’attaques, autrement dit lorsqu’il y a recours à la violence — que les militants antifascistes théorisent souvent comme de l’autodéfense —, on observe très concrètement que, dans certaines villes, les militants d’extrême droite cessent de venir dans la rue pendant des semaines, parfois des mois. Simplement parce qu’ils ont peur de se faire agresser. Cela a été particulièrement visible lors du mouvement des Gilets jaunes. Selon les villes, la situation variait au départ, mais on a vu des militants antifascistes affronter des groupes d’extrême droite radicale au sein des cortèges, jusqu’à ce que ces derniers soient progressivement chassés, y compris physiquement. Résultat : ils n’ont pas réussi à s’implanter durablement dans ces mobilisations.
On observe la même chose avec les dégradations de locaux, et là, ce sont les militants d’extrême droite eux-mêmes qui le reconnaissent. Lorsque le Bastion social s’est implanté dans plusieurs villes, ses locaux ont été régulièrement pris pour cible : vitrines brisées, façades repeintes, locaux saccagés. Or, quand on est un groupe politique d’une dizaine ou d’une quinzaine de personnes, essayer de faire vivre un bar ou un local dans ces conditions devient vite intenable. Cela demande du temps, de l’argent, de l’énergie, et crée des tensions constantes avec les voisins et les propriétaires, excédés par les saccages répétés. À terme, cela a conduit à la fermeture de plusieurs locaux. À Clermont-Ferrand, par exemple, le responsable local du Bastion social l’a dit très clairement : « On ferme parce qu’on n’en peut plus, ce n’est pas tenable. » De ce point de vue-là, l’action de certains groupes ou militants antifascistes a donc été efficace — de l’aveu même des « fafs ».

Rob Grams
Rédacteur en chef adjoint