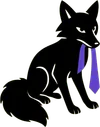Et si on sortait de l’Union européenne ?

Alors que la gauche institutionnelle préfère ignorer le sujet et que la France Insoumise s’est engluée dans une stratégie alambiquée et changeante, l’essayiste et journaliste Aurélien Bernier revient avec Que faire de l’Union européenne, un livre d’une lucidité rare. Son constat est limpide : on ne gouvernera pas à gauche en restant dans les traités européens qui sont supérieurs à notre droit national. Il ne s’agit pas d’un pamphlet souverainiste, mais d’une analyse rigoureuse, juridique et politique, d’une impasse majeure du camp progressiste. L’Union européenne ne sera jamais autre chose qu’un verrou néolibéral. Et la désobéissance «légale» n’est pas une solution réaliste. Il faudra assumer une sortie — et en payer le prix.
Il fut un temps — pas si lointain — où l’Union européenne était un champ de bataille politique pour la gauche. Un vrai sujet de débat, clivant, nourri par la conscience que l’application d’un programme de transformation sociale était rigoureusement impossible dans le cadre des traités européens. On se souvient encore du séisme de 2005, quand la population française disait « non » au traité constitutionnel européen. Un non vite piétiné, le même traité étant refourgué sous un autre nom malgré le refus des Français. Puis la crise financière de 2008 fut le prétexte pour étrangler encore plus les populations européennes, avec comme moment paroxystique le supplice infligé en 2015 à la Grèce de Tsipras par la Troïka — véritable exécution politique en place publique, pour avoir eu l’outrecuidance d’imaginer qu’un peuple pouvait refuser l’humiliation économique.
Et aujourd’hui ? Silence radio. L’émancipation des traités européens semble avoir quasiment disparu des radars de la gauche. Il suffit de jeter un œil au programme du Nouveau front populaire aux législatives 2024 pour s’en convaincre : l’UE y est à peine mentionnée, reléguée à quelques formules creuses sur la nécessité de « refuser les traités européens » (sans jamais dire comment) et de « taxer les plus riches au niveau européen pour augmenter les ressources propres du budget de l’Union européenne », comme si l’histoire des dix dernières années ne nous avait pas déjà prouvé que toute tentative de bifurcation sociale se heurte à une armature technocratique complètement verrouillée. Même les campagnes de la France Insoumise aux élections européennes manquent de fonds et de radicalité, alors qu’elles pourraient constituer un véritable moment de politisation sur ce sujet, comme je le développais ici.
L’émancipation des traités européens semble avoir quasiment disparu des radars de la gauche. Il suffit de jeter un œil au programme du Nouveau front populaire aux législatives 2024 pour s’en convaincre : l’UE y est à peine mentionnée, reléguée à quelques formules creuses sur la nécessité de « refuser les traités européens » (sans jamais dire comment).
Cette disparition du débat n’est pas un hasard. Elle est le symptôme d’un repli stratégique : ne pas toucher à l’illusion européenne, car électoralement ce n’est pas jugé porteur, et la FI souhaite maintenir ses possibilités d’alliances avec la gauche bourgeoise pro européenne PS et Ecolos. Mais on ne construira pas de projet de transformation sociale crédible sans affronter ce que l’Union européenne est : un bouclier juridique au service du marché, un levier pour imposer l’impuissance des populations comme horizon indépassable. Le livre d’Aurélien Bernier Que faire de l’Union européenne ? , qui vient de paraître aux Éditions de L’Atelier, a le grand mérite de prendre au sérieux ce sujet. Comme à son habitude, il est précis tout en étant parfaitement compréhensible.
Des verrous juridiques construits sous pression des lobbys patronaux
L’auteur commence par raconter à grands traits comment s’est construit le verrou juridique européen au service du libéralisme. L’architecture juridique européenne repose sur un postulat apparemment technique, mais éminemment politique : l’uniformité du droit, c’est-à-dire l’idée que les règles européennes doivent s’appliquer de façon identique dans tous les États membres, quels que soient leur contexte social, leur histoire ou leurs priorités démocratiques. Or, cette uniformité n’est pas neutre : elle suppose qu’une seule entité ait le monopole de l’interprétation de ce droit commun. C’est là qu’entre en scène la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) — indépendante, oui, mais surtout indépendante des peuples, des parlements, et des décisions issues du suffrage universel. Dans ce schéma supranationaliste, la libre concurrence, la liberté de circulation des marchandises ou des capitaux ne sont pas de simples objectifs économiques : ce sont des principes gravés dans le marbre des traités, plus contraignants que n’importe quel droit social ou écologique national. Et ce sont ces principes que la CJUE est chargée de protéger. Pas étonnant, donc, que la jurisprudence européenne ait systématiquement favorisé les intérêts du marché face aux protections sociales nationales.
Et ce système, les milieux d’affaires l’ont parfaitement compris. Dès les années 1960, des cabinets d’avocats représentant les grandes multinationales ont engagé une guerre juridique contre les législations nationales jugées trop protectrices ou trop interventionnistes. Chaque contentieux devient alors une opportunité de faire tomber une barrière, un droit du travail trop strict, une norme environnementale trop exigeante, un monopole public trop solide. La CJUE, en interprétant les traités toujours dans le même sens a fini par construire une jurisprudence qui érige les libertés économiques en dogmes indiscutables, et relègue les droits sociaux au rang de simples variables d’ajustement. Autrement dit, le droit européen devient un levier de dépossession démocratique. Loin d’être un espace de coopération solidaire, l’Union européenne s’est transformée en une véritable machine à dépolitiser les choix économiques, à les arracher au débat démocratique, et à les confier à des juges et technocrates inamovibles, eux-mêmes sous influence des lobbies économiques les plus puissants.
Dès les années 1960, des cabinets d’avocats représentant les grandes multinationales ont engagé une guerre juridique contre les législations nationales jugées trop protectrices ou trop interventionnistes. Chaque contentieux devient alors une opportunité de faire tomber une barrière, un droit du travail trop strict, une norme environnementale trop exigeante, un monopole public trop solide.
Aucun programme de gauche ne peut ainsi s’appliquer dans le respect des traités européens. Aurélien Bernier met en particulier deux exemples en avant : le contrôle des mouvements de capitaux et la nationalisation de la fourniture d’électricité et de gaz. Le contrôle des mouvements de capitaux désigne l’ensemble des mesures qu’un État peut prendre pour encadrer, limiter ou interdire certains flux financiers transfrontaliers. Il peut s’agir, par exemple, de limiter les transferts d’argent vers l’étranger, d’imposer des autorisations administratives pour certains investissements étrangers, ou encore de taxer fortement les sorties de capitaux spéculatifs. Historiquement, ces mécanismes ont été utilisés pour protéger la stabilité économique d’un pays, défendre sa monnaie, lutter contre la fuite des capitaux ou orienter l’investissement vers des secteurs d’intérêt national. Or, l’article 63 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) interdit explicitement toute restriction aux mouvements de capitaux entre États membres et entre États membres et pays tiers. Cette disposition prive les États d’un levier essentiel : elle empêche un gouvernement de gauche d’encadrer les flux financiers pour lutter efficacement contre l’évasion fiscale, les délocalisations industrielles ou la spéculation sur sa dette. Concrètement, cela signifie que même des mesures modérées comme une forte hausse de l’impôt sur les grandes fortunes ou de la taxation des dividendes pourraient être immédiatement contournées par des transferts massifs de capitaux vers le Luxembourg, la Suisse ou les îles Caïmans, sans que l’État puisse juridiquement les empêcher.
Concernant la nationalisation de la fourniture d’électricité et de gaz, mesure pourtant indispensable pour mettre en œuvre la transition énergétique, garantir l’accès à l’énergie pour tous à des prix bas, les directives européennes s’y opposent frontalement. Le droit communautaire impose en effet la libéralisation complète du secteur de l’énergie, avec séparation des activités (production, transport, distribution), l’ouverture à la concurrence, et interdiction de toute situation de monopole public. Ainsi, un État qui voudrait sortir du marché de gros européen de l’électricité — où les prix sont déterminés par le coût marginal de la dernière centrale, souvent à gaz, ce qui explique l’explosion des prix ces dernières années — pour instaurer un tarif régulé fondé sur les coûts réels de production, se heurterait à Bruxelles. De même, le retour à un monopole public intégral sur la production et la distribution d’énergie, à l’image de l’EDF d’avant les années 2000, est interdit par les directives européennes.
Le grand mérite d’Aurélien Bernier : mettre les mains dans le cambouis juridique
Alors comment sortir de cette impasse ? L’essai d’Aurélien Bernier analyse en détail l’architecture juridique de l’Union, démonte les discours magiques sur la « désobéissance » et pose les conditions d’une rupture sérieuse. L’auteur commence par rappeler une évidence parfois oubliée : le droit européen est supérieur au droit national, et la Constitution française impose d’être membre de l’Union européenne, via l’article 88-1 qui indique que « la République participe à l’Union européenne constituée d’États qui ont choisi librement d’exercer en commun certaines de leurs compétences ». Cette hiérarchie n’est pas théorique : elle est appliquée par les juges français. Le Conseil d’État, sur son site, l’écrit noir sur blanc : « Le juge administratif doit écarter l’application de la loi incompatible avec une norme européenne, y compris en référé. » Autrement dit, aucun gouvernement, même avec une majorité absolue, ne peut adopter de loi contraire aux traités européens. Ce sont les juridictions françaises, à commencer par les tribunaux administratifs, qui garantissent cette primauté.

Face à ce verrou, certains partis de gauche — le Parti de gauche hier, La France insoumise aujourd’hui — avancent l’idée de « désobéissance européenne ». Ils citent souvent l’exemple de la « règle d’or » des 3 % de déficit public, bafouée à d’innombrables reprises sans sanctions, pour affirmer que désobéir est non seulement possible, mais légal. Aurélien Bernier démonte cette illusion : la règle budgétaire est encadrée par un mécanisme politique, progressif, soumis à l’interprétation du Conseil et de la Commission. Elle n’est pas comparable aux règles du marché unique, du droit de la concurrence ou aux directives contraignantes. Et concernant ces règles beaucoup plus contraignantes, les cas de « désobéissance » actuelle sont en réalité des retards de transposition de directive, ce qui reste dans les marges de négociations, et est bien différent de cesser volontairement d’appliquer une norme déjà transposée. Dans ce dernier cas, l’État entrerait dans l’illégalité absolue : le Conseil constitutionnel pourrait potentiellement abroger la disposition législative pour non conformité à la Constitution française qui prévoit l’appartenance à l’Union européenne. Si ce n’est pas le cas, le Conseil d’Etat en empêchera l’application en annulant les décisions administratives qui en découleraient, en se fondant sur le principe de primauté du droit de l’UE.
Aurélien Bernier revient aussi sur les lectures biaisées ou opportunistes de certains épisodes récents. On a ainsi présenté comme une « désobéissance » la politique énergétique de l’Espagne et du Portugal pendant la crise de 2021-2023. En réalité, ces pays ont négocié une autorisation temporaire avec la Commission pour subventionner l’achat de gaz par les producteurs. Le marché a continué à fonctionner, les prix ont même permis des profits records à l’exportation vers la France. Même les fameux “opt-out” (la possibilité pour un État membre de ne pas participer à certaines politiques ou législations communes, tout en restant membre de l’UE) que la FI fantasme comme des soupapes de souveraineté sont en réalité concentrés sur des sujets conservateurs ou sociétaux. L’Irlande a obtenu une exemption sur l’avortement, la Pologne sur les droits LGBT. Mais aucun opt-out n’a jamais été négocié sur la concurrence, les services publics ou les politiques commerciales. Ces domaines sont sacralisés, car ils forment l’ossature du projet néolibéral européen.
Sortir de l’Union européenne : entre nécessité politique et complexité juridique
Personnellement, j’ai longtemps tenté, en toute sincérité, de concilier la critique de l’Union européenne avec les contraintes tactiques et électorales qui s’imposent à tout parti politique. À cette époque, j’ai sans doute fermé les yeux sur ce que je savais déjà : la véritable impasse que représente l’appartenance à l’UE pour toute politique de transformation sociale et l’impossibilité de la faire bifurquer. Cela fait désormais longtemps que je suis convaincu que la sortie de l’Union est une nécessité. Car non, la « désobéissance européenne » n’est pas une alternative plus simple, plus souple ou plus viable. Si elle se fait à droit constant, elle ne servira à rien puisque le Conseil d’Etat empêchera sa mise en œuvre, c’est son rôle. Si à l’inverse elle passe par un changement constitutionnel pour placer le droit français au-dessus du droit européen et ainsi toucher aux fondements économiques — austérité, libéralisation, droit du travail, concurrence — elle conduirait exactement aux mêmes blocages, aux mêmes conflits avec Bruxelles que la sortie elle-même, puisque la libéralisation économique est le cœur de la construction européenne, l’essence de son existence même. Le décor changera peut-être, mais la crise politique sera de même intensité. Autant s’y préparer lucidement, plutôt que de nourrir l’illusion qu’on pourra contourner le problème. Évidemment, le système politique et médiatique continuera à matraquer l’idée que la sortie ne conduira qu’à des catastrophes et au repli sur soi. Mais désormais l’exemple britannique est là pour montrer que, comme le rappelle Aurélien Bernier, « le Brexit n’a pas été suivi du cataclysme économique annoncé par les forces pro-européennes et Londres ne s’est pas coupée du reste du monde, ni même du continent. Ceci dit, le Royaume-Uni avait conservé une monnaie nationale là où la France aurait à affronter une difficulté supplémentaire : celle de la sortie de l’euro ».
La sortie de l’UE est une nécessité. Car non, la « désobéissance européenne » n’est pas une alternative plus simple ou plus viable. Si elle se fait à droit constant, elle ne servira à rien puisque le Conseil d’Etat empêchera sa mise en œuvre, c’est son rôle. Si à l’inverse elle passe par un changement constitutionnel pour placer le droit français au-dessus du droit européen et ainsi toucher aux fondements économiques — austérité, libéralisation, droit du travail, concurrence —, elle conduirait exactement aux mêmes conflits avec Bruxelles que la sortie elle-même, puisque la libéralisation économique est le cœur de la construction européenne, l’essence de son existence même.
L’essai d’Aurélien Bernier explore concrètement les voies de la sortie de l’Union européenne. Nous l’avons dit, l’appartenance à l’Union européenne est intégrée à la constitution française, il est impossible, donc, de rompre avec l’UE sans passer par une révision constitutionnelle préalable. Et là, deux voies sont possibles, toutes deux semées d’embûches.
Première voie : l’article 89 de la Constitution française. Il suppose qu’une réforme de la Constitution soit adoptée soit par référendum, après un vote favorable à l’Assemblée nationale et au Sénat, ou par le Congrès, où députés et sénateurs doivent réunir une majorité des 3/5. Or, le Sénat est élu par un collège d’élus locaux à dominante conservatrice. Il constitue un verrou structurel pour toute réforme progressiste. La gauche radicale peut gagner une élection présidentielle et disposer d’une majorité à l’Assemblée… sans jamais avoir le Sénat. Résultat : le Congrès est une impasse pour une gauche de transformation, à moins d’un improbable renversement du rapport de force territorial.
Deuxième voie : l’article 11, utilisé par Charles de Gaulle en 1962 pour faire adopter par référendum l’élection du président de la République au suffrage universel. Cet article permet au président de soumettre au peuple par référendum un projet de loi portant sur « l’organisation des pouvoirs publics », et pourrait théoriquement être mobilisé pour restaurer la pleine souveraineté législative de la France. Mais son utilisation pour une révision constitutionnelle reste juridiquement contestée. Le débat doctrinal n’est pas tranché, et le Conseil constitutionnel pourrait refuser un tel usage, de nombreux juristes considérant que son usage en 1962 par de Gaulle était un détournement de procédure, accepté à l’époque uniquement parce que le Conseil constitutionnel avait refusé de se prononcer sur une loi issue du référendum.
Aurélien Bernier ne l’évoque pas dans son livre, mais j’en profite pour préciser que si certains évoquent parfois le référendum d’initiative partagée comme outil potentiel pour enclencher une sortie de l’UE, cela ne tient pas juridiquement. Le RIP, introduit en 2008, permet de proposer une loi ordinaire, à condition de réunir un cinquième des parlementaires et 10 % des électeurs inscrits, mais pas une révision constitutionnelle.
Refuser les négociations de sortie
Bref, aucune issue n’est simple. Ce qui semble clair, en revanche, c’est que les forces progressistes ne pourront sortir de l’Union sans avoir conquis l’Assemblée nationale et le Sénat, ou sans avoir trouvé une faille constitutionnelle (via l’article 11) suffisamment forte pour passer outre les verrous parlementaires. Imaginons malgré tout que ce scénario ultra-favorable se réalise : le président de gauche radicale est élu, une majorité parlementaire soutient la réforme, la Constitution est modifiée, et un référendum pour sortir de l’UE est remporté. Comme le démontre Aurélien Bernier, rien n’est alors encore gagné. Car à ce stade s’ouvre le tunnel de l’article 50 du Traité sur l’Union européenne, qui définit les modalités de retrait d’un État membre. Celui-ci indique qu’un État qui veut sortir de l’Union européenne doit notifier formellement son intention de quitter l’UE. S’ouvrent alors deux années de négociation, à l’issue desquelles les traités cessent de s’appliquer, soit dès qu’un accord est conclu, soit automatiquement au bout de deux ans si aucun accord n’est trouvé.
Les forces progressistes ne pourront sortir de l’Union sans avoir conquis l’Assemblée nationale et le Sénat, ou sans avoir trouvé une faille constitutionnelle (via l’article 11) suffisamment forte pour passer outre les verrous parlementaires.
Aurélien Bernier a raison de penser qu’aucun accord ne serait trouvé. Comme il le rappelle, on entend souvent dire qu’un départ de la France signerait la mort de l’Union européenne, et que si nous menions un tel rapport de force, elle serait obligée de négocier et de se transformer. Mais comme l’écrit Aurélien Bernier, « nous ne sommes plus à l’époque de « l’Europe des six », quand Paris était incontournable ; avec 26 États membres, les institutions européennes pourraient continuer sans nous, au moins pendant un temps. La discontinuité territoriale poserait un réel problème pour l’Espagne et le Portugal, mais compte tenu de l’importance du transport maritime, du développement des réseaux énergétiques et de communication sous-marins, de la dématérialisation de certains échanges… celui-ci peut être dépassé. Si l’Union européenne résiste à cette épreuve, le scénario le plus probable est celui d’une sortie française sans accord avec elle. En effet, comment serait-il possible de trouver un compromis entre un projet de transformation écologique et sociale en France et un projet européen de libre-échange et de libre concurrence, entre un non-alignement français et l’atlantisme des institutions européennes? »
Problème majeur : pendant toute cette période transitoire de négociation, les règles européennes continueront de s’appliquer intégralement et le Conseil d’État y veillera à la lettre en France. Cela signifie que la France ne pourra toujours pas contrôler les capitaux, rétablir un monopole public, sortir du marché de l’énergie ou imposer de nouvelles règles commerciales. Tout acte politique contraire au droit européen sera immédiatement annulé par les juridictions françaises. Comme le souligne Aurélien Bernier, nous serions donc juridiquement entravés pendant au moins deux ans — une éternité dans une période de tensions politiques et économiques majeures. Le pays aurait voté pour la rupture, mais ne pourrait pas en voir les effets. Le gouvernement serait accusé d’impuissance, les oppositions libérales se déchaîneraient, les marchés financiers accentueraient la pression, les spéculateurs organiseraient la fuite des capitaux… l’usure politique commencerait dès le lendemain du référendum.
« Si l’Union européenne résiste à cette épreuve, le scénario le plus probable est celui d’une sortie française sans accord avec elle. En effet, comment serait-il possible de trouver un compromis entre un projet de transformation écologique et sociale en France et un projet européen de libre-échange et de libre concurrence, entre un non-alignement français et l’atlantisme des institutions européennes? «
Aurélien Bernier
Faut-il alors sortir de l’article 50 ? C’est bien ce que propose Aurélien Bernier : non seulement quitter l’Union européenne, mais également ne pas reconnaître la procédure prévue par les traités européens pour en sortir, en faisant primer notre propre ordre juridique. Cela suppose d’adopter une disposition constitutionnelle claire le permettant. Le cœur de la stratégie d’Aurélien Bernier repose donc sur une rupture juridique unilatérale, assumée comme telle, qui permette d’appliquer immédiatement le programme de transformation sans attendre le bon vouloir de Bruxelles. Une sortie de fait, même si la sortie de droit n’est pas encore accomplie.
À la fin de son ouvrage, Aurélien Bernier propose tout de même des voies alternatives à la sortie elle-même : en particulier supprimer la référence à l’Union européenne dans la Constitution sans en sortir formellement, ce qui permettrait au moins de voter des lois que les juges nationaux ne contrôleraient pas en se référant au droit européen, mais uniquement à la Constitution française. « Dès lors, la question de la sortie formelle des institutions européennes devient juridiquement assez secondaire. C’est la nature et le rythme d’adoption des lois nationales qui diront s’il s’agit d’une « désobéissance » ciblée sur une ou quelques thématiques ou d’une sortie de fait », écrit-il. L’auteur propose aussi deux autres voies : renationaliser seulement certains champs, comme les services publics par exemple, que la constitution française exclurait de l’application du droit européen, ou bien faire en sorte que la constitution européenne prévoit qu’un projet de loi validé par référendum puisse déroger aux traités.
Arrêtons de nous raconter des histoires
À mon sens, dans ces différentes alternatives à l’ordre existant, la plus développée par Aurélien Bernier, la sortie elle-même, est la plus pertinente, par clarté pour les populations et pour les mobilisations populaires qui seront nécessaires pour soutenir ce choix. En effet, à quoi bon tenter à tout prix de rester dans l’Union européenne ? Comme le rappelle Aurélien Bernier lui-même à juste titre, sortir de l’Union européenne ne signifie pas sortir de l’Europe. La confusion entre les deux termes est sciemment entretenue par le système politico-médiatique. L’Union européenne n’est qu’une institution parmi d’autres : elle ne résume pas l’Europe. « On oublie que les principales avancées en matière de droits humains et de démocratie sur le continent ne sont pas à mettre au crédit de la CEE ni de l’Union européenne qui l’a remplacée, mais du Conseil de l’Europe, une organisation intergouvernementale fondée dès 1949, qui comprend 46 États membres dont le Royaume-Uni, la Norvège et la Suisse. C’est elle qui crée la Convention européenne des droits de l’homme, qui entre en vigueur en 1953, et la Cour européenne des droits de l’homme chargée de la faire respecter. C’est le Conseil de l’Europe qui adopte la Convention culturelle européenne en 1954 et la Charte sociale européenne en 1961 ». Il va de soi qu’un gouvernement de gauche qui déciderait de sortir de l’Union européenne resterait par contre membre du Conseil de l’Europe.
« On oublie que les principales avancées en matière de droits humains et de démocratie sur le continent ne sont pas à mettre au crédit de la CEE ni de l’Union européenne qui l’a remplacée, mais du Conseil de l’Europe, une organisation intergouvernementale fondée dès 1949, qui comprend 46 États membres dont le Royaume-Uni, la Norvège et la Suisse. »
Aurélien Bernier
Une fois qu’on a compris tout cela, que fait-on ? Nous l’avons suffisamment écrit dans Frustration, le processus électoral est un mensonge qui se maintient par la résignation du peuple. Il est presque structurellement impossible qu’un gouvernement de rupture émerge en France. Et s’il émerge, ce sera pour reculer. Car tous les hommes politiques sont des Tsipras en devenir. Mitterrand a plié. Hollande a rampé. Aucun homme providentiel ne fera mieux. Le jargon sera différent ; la reddition sera la même.
Tout ce qui fut arraché à la domination l’a été par le tumulte. La rue, la grève, l’émeute, la désobéissance à l’ordre social — voilà les seuls gestes encore dotés d’une puissance réelle. Mais quand cette force collective surgit, elle doit avoir conscience que nos adversaires ne logent pas uniquement dans les palais républicains. Ils siègent dans des conseils d’administration, des fonds d’investissement au bout du monde, des think tanks merdiques, et à Bruxelles, au sein de cette Union européenne qu’ils ont construite pour rendre nos votes obsolètes, nos lois illégales, nos désirs caducs. A sa manière, avec ce livre synthétique et précis, accessible à tous, Aurélien Bernier nous aide dans cette prise de conscience. C’est un travail de pédagogie et de lucidité politique. C’est aussi un appel à se réveiller et à arrêter de se raconter des histoires.
Guillaume Étievant
Responsable éditorial