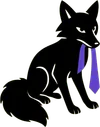Dans son dernier livre Ascendant Beauf, Rose Lamy s’attache à décrypter les ressorts du mépris culturel de classe et les conséquences sociales et personnelles qu’il produit. Elle nous livre dans cet article son analyse de la violence sociale -sous couvert d’humour- une fois de plus déversée par France Inter.
J’étais tranquille dans le TER de retour d’Auxerre quand ma cousine m’a envoyé une vidéo : une chronique de Daniel Morin sur France Inter. Il y racontait son voyage en train à Bourges comme un voyage dans le temps, une plongée chaotique dans l’époque médiévale. Un mois plus tôt, sur la même antenne, Tanguy Pastureau évoquait La Souterraine, dans la Creuse, elle aussi ramenée au Moyen Âge : « J’étais dans Les Visiteurs. Au petit-déj, je n’ai pas pris de sel, parce que j’avais peur de devoir payer la gabelle. »
D’autres souvenirs me sont revenus. En août, Amélie Nothomb évoquait Vierzon, qu’elle traverse pour se rendre au salon du livre de Brive : « Pour aller à Vierzon, il faut s’arrêter à la gare de Vierzon. C’est au-dessus de mes forces. Un lieu sinistre, lugubre. La perspective d’être livrée à l’obscurité de la gare de Vierzon donne une idée précise de ce qui est pour moi l’enfer. » Le 12 février 2025, dans Quotidien, Yann Barthès interroge la jeune navigatrice Violette Dorange sur le “point Némo”, ce point de l’océan le plus éloigné de toute civilisation. Elle commence à répondre quand Pablo Mira l’interrompt pour corriger : « Ça, c’est Châteauroux, attention. ». Dans la même émission, quelques semaines plus tôt, c’est la ville de Cholet, dans le Maine-et-Loire, qui était prise pour cible par l’humoriste Ana Godefroy : « Chaud, chaud, Cholet, il fait pas beau et qu’est-ce que c’est laid. Il fait pas chaud mais c’est mieux que Calais… ». L’humoriste Paul Mirabel avait lui aussi donné son petit avis sur Cholet : “n’y allez pas”.
Bourges. Châteauroux. Vierzon. Chollet. Quel est le problème de la sous-bourgeoisie médiatique avec les petites villes, et de la région Centre particulièrement, ramenées pour amuser la galerie au Moyen Âge, à l’enfer, à la laideur, au bout du monde, en somme à la non-civilisation ?
Le récit de l’excursion de Daniel Morin à Bourges commence par une question posée avec une faute de syntaxe volontaire, pour faire plouc : « Et comment qu’on y va à Bourges ? » (depuis Paris celà va de soi), mais, contre toute attente, une légère lueur d’espoir apparaît. Daniel Morin entame un discours sur le service public : « Je savais que le train en France, c’était de plus en plus compliqué, mais je ne savais pas ce qui m’attendait au départ de la gare d’Austerlitz. » À plusieurs reprises, il parle d’une « région totalement abandonnée », d’un « système ferroviaire mourant ». Et là, on se dit : si seulement. Si seulement il avait utilisé sa tribune pour décrire réellement les conditions matérielles d’existence de celles et ceux pour qui ce trajet n’est pas un exercice de style. Si seulement la cible de sa chronique avait été le désengagement de l’État, les politiques néolibérales qui entravent concrètement la liberté de circuler, de travailler, de voir ses proches, de vivre, et pas cet Autre social, le beauf ou le bouseux. Malheureusement, pour la bourgeoisie séparatiste, parquée à Paris et dans les grandes villes, ceux-ci ne sont que des personnages folkloriques convoqués occasionnellement pour animer les dîners mondains ou les chroniques.
Et comme souvent avec la gauche caviar, ce qui peut arriver aux ploucs et aux pauvres reste à l’état de mots vagues, abstraits, désincarnés. Cela fait quelques générations qu’elle ne les côtoie plus en société ou en famille. Les idées sociales sont devenues un exercice de pensée entre eux, sans lien avec le réel des uns et des autres. Alors, une fois les gages de progressisme donnés, le mépris de classe et la violence sociale peuvent tranquillement déferler. Bourges et ses habitants deviennent arriérés : « J’ai été précipité mille ans en arrière. »
Cette chronique est un festival de lourdeurs et de blagues pénibles, entre mimes d’annonces d’agents SNCF sur fond de musique médiévale : « Oyé oyé, merci de poser vos sacs et vos poules à l’avant de la voiture » et fantasmes de chariot de restauration en auberge crasseuse : « Dites-moi, aubergiste ambulant, qu’avez-vous à me proposer ? – De tout, Monseigneur : brochettes de petits rongeurs, galette de compost, sandwich au gazon, ragondin ou salade de lombrics. » Mais je ne suis pas là pour juger les goûts en humour des Parisiens. Ce qui m’intéresse, c’est de comprendre ma colère sourde.
D’abord, je trouve l’opération profondément cruelle. Daniel Morin, comme Tanguy Pastureau, Amélie Nothomb ou Paul Mirabel, se rendent en « province » pour vendre des livres ou des spectacles. Ils se réjouissent qu’un public y existe, que des billets de train, des hôtels, parfois un cachet, leur soient payés, pour venir dans des villes qu’ils tournent ensuite en dérision. Je n’arrive pas à me défaire de l’idée que celles et ceux qui les ont invités, ou qui ont assisté à leurs rencontres, entendent ces paroles. Il y a là quelque chose qui ressemble à une trahison : avoir donné de son temps et de son argent à un artiste qui rentre à Paris raconter publiquement le calvaire du temps passé en sa compagnie. Alors que je rentre moi-même d’Auxerre, je n’imagine pas une seconde prendre la parole pour me moquer de celles et ceux qui sont venus me voir la veille.
Ensuite, je suis frappée par son ignorance de la réalité de nos vies, car le Paris–Bourges, je le connais par cœur. Il revient à plusieurs reprises sur le fait que les TER n’ont pas de places attitrées. « Prenez une place où vous voulez, asseyez-vous vite, premier arrivé premier servi. Résultat, selon Daniel Morin : « Énorme bordel, chaises musicales, tensions, insultes… ARMAGEDDON. » Les TER n’ont jamais, ou très rarement, de places numérotées parce que ces trajets servent la plupart du temps à aller travailler. Les gens ont des abonnements, souvent payés par leur boulot, qui leur permettent de choisir leurs trains du matin et du soir en fonction de leurs obligations. C’est un peu comme s’offusquer qu’il n’y ait pas de places attitrées dans les RER. Daniel, il n’y a pas non plus de voiture-bar dans les TER – ce qui me fait douter de cette anecdote peut être inventée pour faire rire la galerie ? Et parfois il n’y a pas de toilettes ouvertes. Et souvent, on voyage debout parce qu’il n’y a plus assez de trains et notamment à Noël.
Dans son récit, une voyageuse est blessée en gare, un médecin est appelé. « Les blessures sont sévères. Si cette femme fait escale dans le centre du pays, elle va attraper la lèpre. » J’y vois une évocation humoristique du fait que nous serions moins bien soignés en « province ». C’est vrai, alors je ne saisis pas bien où se situe la blague. J’ai l’impression de revivre, à l’endroit des déserts médicaux, les blagues que faisaient ces mêmes hommes sur les féminicides avant MeToo. Je me souviens des commentaires sous un article intitulé : « Ivre, il tue sa femme pour des grumeaux dans la pâte à crêpe ? » : « Faut dire qu’on ne rigole pas avec les crêpes en Bretagne ! »
« Oyé oyé ! Y a-t-il un rebouteux dans le train ? Un sorcier, peu importe. ». Il ne fait pas si bien dire : récemment, dans Sept à Huit sur TF1, un reportage édifiant racontait le recours aux médecines alternatives, faute d’offre médicale en région. Peut-on blâmer les gens délaissés par le système de santé « officiel » de se laisser tenter par la sorcellerie ou les médecines alternatives ? Un plombier souffrant des cervicales, dans l’impossibilité de voir un spécialiste ou un kiné avant plusieurs années, consultait une kinésiothérapeute. Il a dit cette phrase, toute simple, qui m’a marquée : « Au moins, ici, dans ce cabinet, on est vus et écoutés. » Pour être vus et entendus par Daniel Morin, on repassera. Le sait-il, qu’un homme vivant en milieu urbain vit aujourd’hui un an et demi de plus qu’un homme vivant dans un désert médical ? Sait-il l’humiliation ressentie par des parents qui savent qu’ils ne soignent plus leurs enfants comme eux-mêmes ont été soignés ? La mise en concurrence permanente pour accéder à des soins élémentaires, la loi du plus fort qui opère ? Et toutes les vies que nous perdrons faute de soins et qui ne sont pas comptées?
Voilà probablement ce qui rend cette chronique insupportable : l’ignorance et l’arrogance d’être le centre de toute chose. C’est là que nous quittons l’humour, drôle ou pas, pour entrer dans un exercice cruel de mépris. Après quelques jours de rumination, j’ai fini par factoriser l’équation : la violence commence au moment précis où il renonce au “nous” pour se penser en “ils”, en excursion chez les Autres. Alors qu’il est un citoyen français, concerné par la baisse des moyens ferroviaires ou le manque de médecins en campagne, alors qu’il est supposé partager avec nous un destin commun et qu’il a une tribune pour le dénoncer il choisit de réaffirmer sa non-appartenance territoriale, culturelle (on mange du ragondin) et même temporelle, en nous renvoyant en 1025. Il fait le choix de la distinction.
Ainsi, une fois le voyage terminé, la chronique rendue et le petit frisson d’une excursion en terre inconnue digéré, il retournera à son entre-soi urbain bourgeois, là où l’on voyage mieux et où l’on est mieux soigné en continuant d’ignorer les victimes d’un système inopérant. On participe à la violence sociale quand on maintient des discours et des représentations qui perpétuent les inégalités, mais aussi quand on met tout en œuvre pour humilier celles et ceux avec qui on ne veut rien avoir à faire, même pendant deux heures trente de trajet.(Et pas 1h33, parce que même sur ça, il se trompe).
Rose Lamy