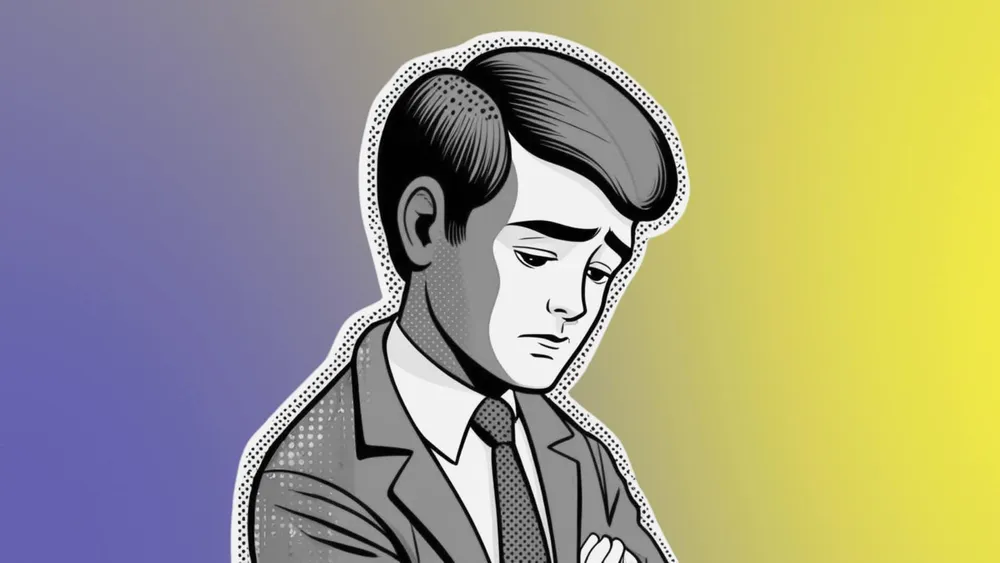
« De toute façon, on fonce dans le mur. On n’y arrivera jamais. Ils sont trop forts. Ils contrôlent tout … ». Les discours de vos collègues, parents ou amis sur l’état du monde sont parfois empreints d’une forte dose de résignation. Quelque chose de néfaste va nous tomber dessus et on ne pourra, de toute façon, rien y faire. Ce sentiment est souvent présent dans le monde du travail. À l’annonce d’une coupe budgétaire, d’une fermeture de lits hospitaliers ou d’un plan de licenciements, un commentaire s’invite dans les discussions entre collègues. Le fameux « Les gens ne feront rien » avec sa logique cumulative : si les gens ne font rien alors je ne ferai rien et, au final, les gens déploreront qu’on ne fasse rien pour lutter contre les injustices. La résignation, ce n’est pas un individu qui, à un moment donné, voit les choses de manière négative. C’est malheureusement une dynamique collective qui se répand et dégonfle les perspectives d’engagement des travailleurs dans l’action commune. Comme si on était chaud pour partir collectivement à l’assaut d’une grande forteresse mais qu’une conviction grandissait parmi nous : celle que le cortège allait se vautrer dans la première flaque d’eau, avant même d’atteindre le pont-levis. Il ne s’agit pas de parler en naïf ; les moyens dont on dispose pour agir nous paraissent parfois hors de portée. Il arrive que notre enthousiasme s’autorise une sieste. Passer par des moments de découragement est normal. Ces instants peuvent être difficiles à appréhender. Proposition en 5 tips pour composer avec les discours pessimistes et résignés.
I. Le pessimisme n’est pas un problème individuel, mais structurel
Un ami vous partage sa vision désabusée du monde ? Prudence avec les réponses du type : « Mais non, allez, faut y croire ! ». La posture du coach en pensée positive n’est vraiment pas nécessaire. Inutile de transformer chaque moment de pessimisme en une chanson de scouts. Si votre pote vous dit qu’il a l’impression d’étouffer dans ce monde de merde, évitez de lui dire : « Tout ça, c’est dans ta tête, pense po-si-tif ! T’as déjà essayé la respiration diaphragmatique ? ».
Ce genre de réplique propose un cadrage individualisant du problème : votre pote se sent mal et ça serait à lui de trouver les ressources et les solutions pour changer sa vision du monde. Le bonheur s’obtient en pratiquant une pensée heureuse. Rires enregistrés, générique de fin.
La perte de sens au travail, couplée à une organisation hiérarchique autoritaire, génèrent une insatisfaction générale et un sentiment d’absurdité dans la vie professionnelle.
C’est oublier toutes les raisons structurelles qui contribuent à notre pessimisme. Les travailleurs sont toujours plus précarisés et maltraités. Le démantèlement acharné du modèle social (retraites, santé, sécurité sociale, chômage,…) par le bloc bourgeois contribue à un sentiment de découragement. La perte de sens au travail, couplée à une organisation hiérarchique autoritaire, génèrent une insatisfaction générale et un sentiment d’absurdité dans la vie professionnelle. L’insécurité matérielle, les contrats précaires, le frigo vide affectent la santé mentale et physique des individus, contribuant à leur vision négative et incertaine de l’avenir. Oui, il y a quelques raisons, très concrètes, d’être pessimiste. Il est important d’envisager le pessimisme de nos proches et collègues, non pas comme l’expression individuelle d’un manque de positivité, mais comme la conséquence d’un contexte social et économique difficile. Mentionner les facteurs structurels qui nourrissent ce sentiment de découragement peut avoir un effet déculpabilisant sur vos interlocuteurs.trices. On a parfois l’impression de « booster » des personnes en leur proférant des discours positifs mais on ne parvient, souvent hélas, qu’à minimiser et invalider leurs sentiments. Nous ne sommes pas responsables de notre malheur. Offrons donc un véritable soutien en comprenant les réalités matérielles qui pèsent sur celles et ceux qui nous entourent.
II. Travailler la confiance de classe en combattant la vision négative des autres
L’un des moteurs de la résignation est la croyance en l’inaction et la passivité… chez les autres. Le cercle vicieux est alors lancé. Je ne me révolte pas parce que je pense que les autres ne se révolteront pas. Je ne peux pas lutter tout seul. Beaucoup de personnes pensent certainement la même chose. Pour briser cette dynamique, il faut réussir à insuffler une culture de la confiance en autrui. Comme on l’a dit plusieurs fois à Frustration, la conscience de classe (prendre conscience de nos intérêts communs en tant que groupe social) doit s’accompagner d’une confiance de classe (avoir confiance en la capacité des autres membres du groupe à comprendre, eux aussi, les enjeux afin d’en tirer les conclusions logiques).
La conscience de classe (prendre conscience de nos intérêts communs en tant que groupe social) doit s’accompagner d’une confiance de classe (avoir confiance en la capacité des autres membres du groupe à comprendre, eux aussi, les enjeux afin d’en tirer les conclusions logiques)
Comment cultiver la confiance de classe ? Dans les réflexes de pensée à gauche, on retrouve souvent des postures de dédain : « les gens » seraient devenus individualistes, égocentrés et sous influence des médias possédés par des milliardaires. De vrais « moutons » qui auraient tous viré à droite avec les années. Il s’agit d’une représentation erronée. Tout d’abord, le cliché de la télé abrutissante doit être combattu. En quinze ans, la proportion des gens qui s’informent par la télévision passe de 82% (2007) à 62% (2022). Ensuite, la plupart des gens ne prennent pas pour argent comptant ce que les éditorialistes ou Cyril Hanouna racontent. « L’attention oblique », c’est le terme trouvé par le sociologue Richard Hoggart pour désigner cette façon dont nous regardons et apprécions certains programmes télé en maintenant notre esprit critique. Nous gardons une distance par rapport à ce qui nous est matraqué. Les Français se montrent ainsi particulièrement défiants à l’égard des médias. À juste titre. Pour son livre « La droitisation française, mythe et réalités » (PUF, 2024), le sociologue Vincent Tiberj a compilé trente ans d’études et de sondages divers et variés. Il a ensuite construit des indices qui permettent d’observer la pénétration des idées de gauche ou de droite dans la population française. Ses résultats sont sans appel : la société est nettement moins raciste, homophobe et sexiste que dans les années 1980-90. Concernant les questions sociales, la majorité de la population est hostile à l’extension du capitalisme dans nos vies. Il existe de très bonnes raisons, très réalistes, de ne pas désespérer de nos semblables. Des conclusions qui ne se voient pas toujours sur un plan électoral, l’agenda de la politique institutionnelle se jouant largement sur des thèmes favorables à la droite et à l’extrême-droite. L’augmentation de l’abstention fausse par ailleurs largement les résultats électoraux.
III. Défaire les essentialisations
Les discours défaitistes s’articulent souvent autour de grandes abstractions et de projections globales qui confinent à l’inaction. Exemple : « Le problème, c’est le capitalisme, le néolibéralisme, l’Europe, … ». Comment ne pas se trouver faible et minuscule face à de tels mastodontes ? Il s’agit de s’opposer aux entités écrasantes et aux visions trop généralistes en nommant les vrais responsables. Ils sont à chercher parmi ceux qui détiennent le pouvoir économique et politique, au sein de la bourgeoisie possédante. Si des crimes sont commis contre l’environnement et le système social, il existe donc des criminels : des grands patrons et des élites qui privilégient leurs intérêts de classe, au détriment des intérêts du plus grand nombre. Il est possible de remonter la chaîne des coupables, loin du discours « On est tous responsables ».
Si des crimes sont commis contre l’environnement et le système social, il existe donc des criminels : des grands patrons et des élites qui privilégient leurs intérêts de classe, au détriment des intérêts du plus grand nombre.
Dans les discussions avec des personnes résignées, il est important de rendre les responsables tangibles et concrets, plutôt que de se perdre dans des abstractions impalpables. Donner des figurations concrètes, c’est rompre avec la notion floue de responsabilité collective et pointer les causalités là où elles sont réellement concentrées. Par exemple, les luttes locales menées contre les méga-bassines ou la construction d’une autoroute montrent que l’on peut directement s’attaquer aux coupables, sans se perdre dans des débats théoriques. Cela permet de reprendre le pouvoir sur l’histoire en montrant que ces systèmes d’exploitation sont portés par des individus issus d’une classe sociale précise dans des logiques de domination parfois très subtiles et non par une entité intangible et omnipotente, le « système ».
IV. Nos aspirations quotidiennes sont politiques
Beaucoup de nos comportements quotidiens, que ce soit dans nos relations ou dans nos actions au travail, ne sont jamais envisagés comme des actes politiques. Pourtant, ils en sont. Nous vivons dans une société capitaliste dans laquelle le capital domine de nombreuses facettes de notre existence. Mais, jour après jour, de manière souvent invisible, nous cherchons à briser cette logique dominante. Dans son livre « Crack Capitalism » (Libertalia, 2012), le sociologue John Holloway illustre bien ce phénomène par des exemples du quotidien : « Je suis une infirmière dans un hôpital privé et je produis du profit pour mes employeurs, mais en même temps j’essaie d’aider mes patients lors des moments les plus difficiles de leur vie. Je travaille sur une chaîne de montage dans une usine automobile et pendant mes quelques secondes libres, mes doigts sont absorbés à expérimenter les accords que je jouerai ce soir sur ma guitare dans le groupe. Je travaille sur une machine à coudre pour fabriquer des jeans, mais mon esprit est ailleurs, construisant une nouvelle maison pour mes enfants et moi. Je suis un étudiant travaillant dur pour obtenir de bonnes notes à mes examens, mais je veux trouver un moyen d’orienter mes études contre le capitalisme et vers la création d’un monde meilleur ». Dans tous ces cas, il y a une position en dehors du travail capitaliste, une projection contre et au-delà de notre situation piégée à l’intérieur du capital. Cette résistance se déploie dans nos vies ordinaires sous la forme d’espaces d’autonomie, des « brèches » (comme les nomme Holloway) qui ne sont ni pures ni parfaites : ces brèches peuvent parfois porter en elles les contradictions du système qu’elles cherchent à subvertir. C’est ainsi et ce n’est pas grave. En ce sens, les brèches sont à la fois des lieux de libération et de ruptures douloureuses. Nos résistances, bien qu’imparfaites, s’inscrivent dans un refus viscéral de subordonner nos vies à l’autorité du capital et à ses structures de domination.
Nos résistances, bien qu’imparfaites, s’inscrivent dans un refus viscéral de subordonner nos vies à l’autorité du capital et à ses structures de domination.
On pourrait penser que les petits instants où l’on parvient à s’extraire de l’appareil productif, du système économique dominant ne sont que des respirations ponctuelles. Des petits riens qui détournent notre radicalité en quelque chose de faible et d’insignifiant. Ce n’est pas le cas. Il y a une ligne de continuité entre lire un livre dans un parc, écouter la pluie sur les toits, marcher en montagne avec des ami.e.s et participer à un mouvement social d’ampleur. « Vivre pour la joie, le plaisir, ma dignité, mes aspirations profondes et non pour la douleur », tel est le sous-texte de tous ces comportements. L’important est d’être en contact avec la radicalité, les colères, les luttes et de mettre en lumière les résonances.
V. Passer de la perspective individuelle à l’action collective
Il est sans doute de plus en plus difficile de lutter contre la résignation. Mais c’est justement dans ces moments de découragement que la nécessité politique de la combattre prend sa pleine mesure. La question est alors de savoir comment changer cette atmosphère, comment faire naître une dynamique de changement ? C’est là que la force de la dynamique collective entre en jeu. C’est lorsque l’on se rend compte que quelques collègues sont prêts à prendre part aux luttes en brisant l’immobilisme que s’allume en nous l’étincelle des possibles. Si je m’oppose individuellement, je me marginalise. Si nous nous opposons collectivement, nous sommes puissants. Il existe des moments de débordement où des groupes sociaux se libèrent et développent une immense créativité collective dans des contextes hautement critiques.
Si nous nous opposons collectivement, nous sommes puissants
La joie d’agir collectivement ne naît-elle pas de ce simple fait ? Sentir que l’opinion majoritaire est prête au changement, voilà ce qui nous donne à nous même la force de franchir le pas. Dans les périodes de mouvements sociaux, vient toujours un moment de basculement, où la coagulation de toutes les énergies transforme l’incertitude en détermination et rend concrètes toutes les potentialités du changement. Dans ces instants de solidarité et d’action collective, on se dit alors : « Si les autres sont prêts à y aller, alors moi aussi, j’y vais ! ».
Maxime Devars
Contributeur extérieur

