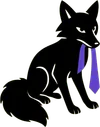Le plateau du Vercors, havre de paix familial. Crédit : Victor Nicolaï
Le 8 juillet 2025, la loi Duplomb, du nom de Laurent Duplomb, – actuel sénateur Les Républicains et ancien président FNSEA de la chambre d’agriculture de la Haute-Loire-, qui vise à “lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur”, est adoptée. Elle ré-autorise l’usage des néonicotinoïdes, des insecticides ultra toxiques, interdits en 2018, dans l’agriculture intensive. C’est une loi qui reprend quasiment mot pour mot les revendications de la FNSEA. Bien que le lobby agro-industriel fasse tout pour étouffer cette affaire, les études scientifiques sont nombreuses à établir un lien clair entre massification de l’usage des produits phytosanitaires chimiques et massification des cancers.
Le 8 juillet 2025, je n’avais pas trop la tête à suivre l’affaire loi Duplomb, j’étais à l’hôpital à Grenoble, c’est le dernier jour où j’ai pu parler à mon père. J’ai ravalé mes larmes un instant et j’ai rassemblé toute la force qui me restait, celle qui m’a été donnée par lui, par ma mère, par mes sœurs, pour lui dire que c’était si dur parce que c’était trop tôt, parce qu’on s’aimait, mais qu’on allait tout faire pour être fortes, pour être dans la vie. Il m’a dit “ça fait du bien d’entendre ça”.
Comment le capitalisme a tué mon père
Le 11 juillet, mon père est décédé d’un cancer fulgurant, multimétastatique dont l’origine n’a pas été identifiée, qui l’a emporté en cinq semaines. Onde de choc. Pas, ou peu de signes avant-coureurs, il était en forme. Mon père est mort à l’hôpital dans lequel je suis née, à 65 ans, d’un cancer ; mon grand-père (son père) est mort à 63 ans, d’un cancer. Mon père est mort quand j’avais 33 ans, mon père en avait 34 quand il a perdu le sien. Drôle de vie.
Il est mort à 65 ans, en ayant à peine eu le temps de profiter d’une vie post-salariat. Il travaillait encore, faisait des intérims de direction, nécessaires à une retraite faite de plaisirs, de quelques voyages, de coups de pouce aux enfants. Il avait commencé à travailler ado en faisant du secourisme, avait décroché à l’école à cause des horreurs qu’il avait vues, et c’est sans le bac en poche qu’il s’était lancé dans le social. Il venait d’une longue lignée de paysans bretons (les vrais, pas les industriels), les hommes mourraient tôt, il avait une revanche à prendre. Il était un grand professionnel et un humaniste, comme en ont témoigné les nombreuses familles accompagnées et les anciens collègues présents à la cérémonie.
65 ans, c’est selon l’Insee l’âge moyen de l’espérance de vie en bonne santé en France (c’est moins pour les personnes aux métiers les plus précaires et difficiles). Le projet initial de Macron, c’était de décaler l’âge de départ en retraite à 65 ans. Donc de nous faire bosser, puis mourir, sans interlude ou presque, sans pouvoir profiter d’un temps sans travail, sans réveil, sans compte à rendre, d’un temps de vie en étant encore en forme.
J’ai été de toutes les manifs anti-réforme des retraites, j’étais déjà tellement en colère à l’époque, pourtant mes parents étaient encore là tous les deux et je pensais qu’ils allaient en profiter. Je les ai vu charbonner toute leur vie dans le social et le médico-social, avec la justice sociale comme boussole, toujours. Et je me disais : ces parasites au pouvoir, qui selon moi n’ont jamais vraiment bossé, décident de rallonger nos vies au travail, de nous faire arriver à l’âge de la retraite épuisés et pour une partie, malades. J’ai la haine.
De la même façon, écouter Fleur Breteau, de Cancer Colère, expliquer que la moitié des cancers sont de cause environnementale, qu’ils seraient évitables avec de la volonté politique, si on voulait bien mettre les intérêts économiques de côté, m’a autant apaisée, parce que déculpabilisée, parce que donné une forme de réponse, que mise dans un état de rage et de dégoût absolu pour ce gouvernement, et pour ce système capitaliste en général.
Vraiment, il y a des moments où j’ai la haine. Alors on me dit : c’est une étape du deuil. Non ce n’est pas que ça : je suis en colère parce qu’on est exploités au travail, mal payés, parce qu’on est malades, parce qu’on bouffe de la merde, parce qu’on la respire dans nos villes, et dans nos campagnes. Je suis en colère parce que mon père a été mal pris en charge. Parce qu’on n’a pas eu le droit à un accompagnement à la fin de vie digne. Tout ça, ce sont principalement des choix politiques et économiques, visant à maintenir une petite élite bourgeoise, mafieuse, qui ne cache même pas la connivence de ses intérêts (on peut tranquillement affirmer que la loi Duplomb, c’est la FNSEA), en situation de domination totale. Mon père les aurait allègrement traités de “fumiers”, sans jeu de mots douteux.
Il y a des moments où je fais la liste de tous ceux que j’échangerais contre mon père. Elle est longue cette liste. Macron, Darmanin, Retailleau, Wauquiez, Duplomb, Borne, et tant d’autres… ça aussi, on me dit que c’est une étape du deuil : le marchandage. Mais non, je crois que ce n’est pas que ça. Je les donnerais sans aucun remord contre mon père, parce qu’il était si généreux, et dans la vie, quand eux sèment la mort. Il ne pouvait pas se les voir.
Comme Nicolas Framont dans Saint Luigi, je me pose ces questions : “Qui nous consolera du fait qu’eux vivent dans des corps plus sains, plus beaux et plus durables que nous ? Et que plus leur règne s’étend, plus nos chances de survie se réduisent ?”
Le capitalisme médical dans toute sa splendeur
Quand mon père a ressenti les premiers symptômes, il a consulté le seul médecin disponible à des kilomètres à la ronde, car mes parents habitent dans un désert médical. Donc ils n’avaient pas le choix, et ce dernier a au départ diagnostiqué une sorte de pneumonie. Bon, l’erreur est humaine. Sauf que mon père avait déjà eu un cancer il y a quinze ans, et même s’il était considéré guéri, il avait senti que là c’était grave. Il avait demandé à passer un scanner, le médecin a refusé. Comme ça n’allait pas mieux, quelques jours plus tard, mes parents sont allés aux urgences. Après une nuit à attendre dans un couloir, on leur a refusé une hospitalisation, ça relevait, selon le médecin, de la “médecine de ville”.
Nous avons donc perdu plusieurs semaines, à cause de facteurs qui là aussi sont des choix politico-économiques : les déserts médicaux, la toute puissance médicale (le refus d’accorder aux patients une légitimité dans leurs intuitions, une expertise de leur propre corps), puis le délabrement des services publics (et privés) de santé qui ont pour résultat un tri des patients au nom d’une nécessité de rapidité dans la prise en charge et d’une surcharge du système hospitalier, en particulier des urgences.
Et pourtant, j’ai bien conscience que mon père était un homme, blanc, de classe moyenne, ne subissant pas à priori de préjugés ou de discriminations. Il n’empêche, le désinvestissement dans nos systèmes de soins nous touche massivement.
Il aura fallu qu’ils aillent consulter à une heure trente de chez eux, leur ancien médecin traitant, pour que mon père soit enfin hospitalisé. Le diagnostic de cancer tombera quelques jours plus tard, ainsi qu’une succession de mauvaises nouvelles, nos cœurs faisant des bonds, se déplaçant entre nos entrailles et le haut de notre gorge au gré des annonces, des faux espoirs, du désespoir.
Nous avons vécu l’enfer, car voir quelqu’un que l’on aime mourir, dans la sidération, c’est l’une des pires épreuves de la vie, et l’une des plus partagées. Dans cet enfer, rien ne nous aura été épargné : il n’y avait plus de place en service de cancérologie, et pas de service de soins palliatifs, il est donc resté jusqu’au bout dans le service de médecine interne. Malgré le professionnalisme global et l’empathie des équipes, il était clair que ce service, qui accueillait le “tout venant”, n’était pas adapté. Il y avait du bruit, des gestes brusques, des rires sonores dans les couloirs quand nous, nous pleurions en nous disant les dernières choses importantes. Nous avons nous-mêmes créé une affiche indiquant “ce patient est en soins palliatifs” et un logo “silence” pour mettre sur sa porte.
Quand on a su qu’il n’y aurait pas de chimiothérapie, et qu’il n’en pouvait plus de souffrir, mon père a exprimé le souhait d’en finir. Sauf que ce n’est pas possible en France – la loi sur la fin de vie est actuellement examinée au Sénat. Cette loi a été très critiquée par les collectifs anti-validistes, et tant qu’existera le risque qu’elle soit utilisée pour mettre fin à la vie de personnes en situation de handicap, de vulnérabilité, qui sont en souffrance parce que notre société est profondément discriminatoire et ne donne pas accès à des conditions de vie dignes pour tout le monde, elle ne devra pas entrer en vigueur.
Pour mon père, la fin de vie fut une question de jours, qui ont été d’une grande violence pour lui, pour nous. La sédation a été mise en place trop lentement, ce n’était pas une sédation profonde comme prévu dans ces cas-là mais un “équivalent” car visiblement les protocoles sont compliqués, il bougeait, toussait, se levait dans une sorte de demi-sommeil, sourcils froncés. Luttant, probablement. A un moment, on n’en pouvait plus, alors je suis allée voir la médecin. Je lui ai demandé pourquoi on n’augmentait pas les doses, signalant qu’il était agité, que c’était atroce de le voir comme ça. Elle m’a répondu que “si on augmente trop d’un coup, ce sont des médicaments qui peuvent entraîner la mort”. Je lui ai répondu : “Mais il va mourir, non ?” Elle a acquiescé, gênée, contrainte par le risque qu’on se retourne contre l’hôpital, car l’euthanasie est illégale. Même si tout est allé très vite, il y a des images qu’on aurait préféré ne pas voir. Cette loi, dans une version améliorée, on en aurait bien voulu.
L’après : gérer sa souffrance et ne pas se faire avoir par les assureurs
Après son décès, j’ai ressenti l’impossibilité d’être au monde comme avant : rien n’a de sens, on doit réapprendre à vivre dans une nouvelle configuration.
Sandrine Collette dans On était des loups décrit très bien, par la voix de son narrateur qui vient de perdre sa femme, ce que l’on peut ressentir quand quelqu’un que l’on aime vient de mourir : “J’étais dans un état pas normal je le sentais tout était mécanique. J’étais détaché des choses et pourtant chaque geste et chaque regard me transperçait de douleur, je naviguais entre deux univers pas très nets (…) à cela je n’étais pas préparé.”
Je me suis sentie perdue, bien qu’entourée de mes proches, j’ai trouvé qu’on manquait terriblement de ressources pour affronter la mort, la tristesse, le deuil. J’avais besoin d’être guidée, de symboles, de mots pour en parler, d’en entendre aussi. J’imagine que ça vient en partie du fait qu’on vit dans une société moderne sécularisée qui manque de spiritualité, de rituels, qui occulte ces questions. J’ai trouvé sur Arte (on peut toujours compter sur Arte), quelques vidéos et podcast salutaires.
Dans cet océan de douleur et de sidération, cherchant à trouver des réponses, il fallait aussi remplir des dossiers et des dossiers, retrouver les codes, les mots de passe, dans ses mails ou son téléphone, pour avoir accès aux diverses plateformes (impôts, carte grise, abonnements en tout genre), photocopier quinze fois le certificat de décès, et à chaque fois, lire et relire une réalité que l’on n’a pas encore bien intégrée.
Car ça met du temps, intégrer l’information que quelqu’un n’est plus là, c’est irréel au début, c’est du temps long. On pourrait croire que le temps de l’administratif c’est aussi du temps long, mais non, là, d’un coup, tout doit aller vite. Remplir les dossiers de pensions de réversion, retrouver des papiers improbables, se connecter, écrire, remplir, signer, envoyer. Se retrouver dans des situations lunaires : ne pas pouvoir vendre un véhicule parce qu’il faut que le propriétaire de la carte grise (mon père) désigne un mandataire pour la vente avec un Cerfa. Péter des plombs parce qu’on n’arrive pas à se connecter, parce qu’on voudrait hurler à ces plateformes numériques de misère, “MAIS IL EST MORT”, l’impression que c’est la première fois que ça arrive, aucun humain en face. Des heures passées à faire ça.
Se prendre la violence du “questionnaire décès” des assurances sur le crédit, qui demandent le compte-rendu de l’hôpital, contacter l’hôpital et retrouver la même boule au ventre, devoir relire, encore, “cancer multimétastatique”, “décès”, devoir répondre aux questions : quand les symptômes ont-ils commencé ? Lesquels ? Date de la consultation ? Traitement ? Antécédents ? Il fumait ? En fait la question en sous-texte c’est : est-on bien sûr qu’il n’a pas fait exprès de mourir ? Qu’il ne l’a pas un peu cherché ? Et que donc, on pourrait ne pas vous donner l’argent auquel vous auriez droit ?
Je me suis dit : les personnes qui ne parlent pas bien français, qui ne maîtrisent pas l’informatique, qui sont seules, ou trop accablées par la douleur pour avoir la force de s’occuper de ça, comment font-elles ? Je n’ose imaginer la précarité liée au non-recours aux droits parce que c’est trop compliqué, parce que c’est trop douloureux.
Conclusion
Quand mon père était à l’hôpital, je pensais souvent à Gaza, aux hôpitaux bombardés, je me disais : je ne peux pas imaginer ce que ça fait, si sa vie était menacée non seulement par la maladie mais par une bombe. Là aussi, je me sentais très en colère, et très démunie. Les chefs d’État génocidaires, mon père il ne pouvait pas non plus se les voir, c’était viscéral.
Il me manquera tout le temps. Je sais que j’ai de la chance d’avoir connu tant d’amour, d’avoir hérité de ce que ma mère et lui nous ont transmis à mes sœurs et moi, mais il me manquera toute ma vie, dans tous les moments où il ne sera pas là et où il aurait dû l’être, où il aurait pu l’être, peut-être, si les choix politiques et économiques étaient différents.
Je voudrais conclure en citant la grande Annie Ernaux dans La femme gelée, déclarant son amour à son père et à l’homme qu’il était, en dehors des clous d’un patriarcat crasse : “Rien que des images de douceur et de sollicitude. Chefs de famille sans réplique, grandes gueules domestiques, héros de la guerre ou du travail, je vous ignore, j’ai été la fille de cet homme-là.” Moi aussi, j’ai été la fille de cet homme-là.
Juliette Collet