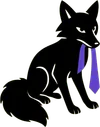L’obsession du cinéma français pour le réalisme social

Chez Frustration, notamment depuis les articles de Rob Grams sur son concept de « bourgeois gaze », ou dans cet article récent de Farton Bink, on s’intéresse beaucoup à la question des classes dans le cinéma. Aujourd’hui, Jules Adam Mendras se penche sur les nombreuses impasses qui découlent de la mise en scène des rencontres inter-classes dans le cinéma français, et sur la mystification qui émane de ce qui est perçu comme une certaine obsession pour un prétendu “réalisme” social, ô combien illusoire et bien souvent révélateur du regard bourgeois.
La récente sortie en salles de Classe Moyenne d’Antony Cordier a ravivé l’éternelle question sur la valeur sociale du cinéma français. Bien que le film adopte une approche scénaristique parfois très (très) didactique et ne prenne jamais parti, il a le mérite de proposer une lecture légèrement différente de celle de nombreuses productions grand public : il interroge les rapports de force que la classe populaire peut mobiliser lorsqu’elle se confronte à la bourgeoisie.
Dans Classe Moyenne, le couple Troussard (Laurent Lafitte et Élodie Bouchez), propriétaires d’une villa outrageusement luxueuse dans le sud de la France, emploie à l’année les Azizi, un couple de gardiens incarné par Laure Calamy et Ramzy Bedia. À la suite d’un différend avec leurs employeurs, ces derniers engagent une véritable guerre contre leurs patrons, qui les exploitent illégalement depuis des années. Sur fond de satire sociale, le film met en lumière la manière dont la bourgeoisie tire profit du travail de ses employés, tout en montrant comment ces derniers peuvent, par des actes de résistance et de sabotage, inverser ponctuellement le rapport de force.
Si le film s’achève sur une morale teintée de cynisme et peu courageuse, il parvient à éviter un travers récurrent du cinéma français consistant à réduire la question sociale à la rencontre improbable de personnages socialement incompatibles et dont la simple relation suffirait à abolir les inégalités qui les séparent.
Mais au-delà de cette mise en scène de la rencontre, le cinéma français à l’air guidé par un désir intarissable de dire quelque chose de la société. Qu’il s’agisse d’un drame ou d’une comédie, l’obsession reste la même : qu’est-ce que cela révèle de nos rapports sociaux et par quels procédés scénaristiques différents une vision sociologique bourgeoise et biaisée se retrouve-t-elle souvent mise en avant ?

Le réalisme social, critère de valeur du film français
Le cinéma français de fiction affiche, depuis quelques années, une volonté quasi anthropologique : capter au plus près la réalité sociale de celles & ceux qu’il met en scène.
Récemment, Vingt Dieux de Louise Courvoisier et Chien de la casse de Jean-Baptiste Durand étaient salués pour leur “fine observation des milieux rarement représentés au cinéma”. L’épreuve du feu d’Aurélien Peyre (2025) décrirait avec précision “la cruauté des conventions sociales et les questionnements amoureux” et Leurs enfants après eux de Ludovic et Zoran Boukherama (2024) capterait “à merveille les états d’âme de l’adolescence et restitue parfaitement l’atmosphère d’une ville ouvrière laissée en jachère par la fin de l’exploitation minière”.
Cette fascination des cinéastes français pour les jeunesses qui s’ennuient dans les régions rurales et agricoles, notamment durant l’été, est si récurrente qu’elle pourrait d’ailleurs faire l’objet d’un article à part entière…
Au-delà de prêter des intentions sociales aux réalisateur·ices, cette obsession critique tend à biaiser la réception des films car elle pousse à considérer qu’un film est « bon » s’il est « réaliste socialement ». Comme en témoigne cet article dithyrambique de Télérama à propos de Vingt Dieux :
“L’accent traînant, le teint frais rosé des protagonistes, le stock-car entre les bottes de foin et les pâturages du pays jurassien, les vaches laitières et tout ce qui entoure la fabrication du fromage certifient l’authenticité.”
Mais faut-il vraiment dépenser 12,90€ pour assister à la reproduction la plus fidèle possible de milieux sociaux trop complexes et pluriels pour être condensés en 90 minutes ?
Dans leur Sociologie du cinéma (Repères, 2021), Aurélie Pinto et Philippe Marty expliquent :
« Les cinéastes en quête d’une vérité sur le monde devraient tenir la sociologie à distance : c’est à la condition de ne pas être sociologique que le cinéma peut atteindre une connaissance du monde ou une vision de la réalité qui touche à l’essentiel. »
“Depuis que t’écoutes du Rachmaninov, tu danses plus la gigue ?”
Déclinaison très en vogue du film social depuis quelques années : le film « retour ». Le protagoniste, issu d’un milieu populaire qu’il a quitté pour suivre la trajectoire du parfait « transfuge » (avec beaucoup de guillemets) retourne sur les terres de son enfance, à priori toujours dans une région post-industrielle du Nord ou de l’Est, décor immédiatement lisible pour le public, mais dont les contours restent pourtant invisibles à l’écran. Ainsi, Hélène (Connemara) se réjouit de retrouver son Épinal natal sans que la ville ne soit d’aucun plan du film et Cécile (Juliette Armanet dans Partir un jour) retourne dans son Loire-et-Cher d’origine, qui pourrait être interchangeable à l’écran avec le Nord-Pas-de-Calais ou la Haute-Marne.
En tentant d’illustrer les difficultés de la re-confrontation à son milieu d’origine, ces films rejouent inlassablement la même mécanique : un personnage au regard méprisant sur son milieu d’origine, confronté aux reproches de ses proches qui dénigrent son nouveau style de vie.
Une mécanique parfaitement illustrée dans Partir un jour d’Amélie Bonnin, où la protagoniste, cheffe d’un restaurant gastronomique parisien, se retrouve jugée par ses parents, tenanciers d’un modeste relais routier dans le Loir-et-Cher. Un procédé moqué par la metteuse en scène Laurène Marx sur son compte Instagram, résumant le mécanisme de ce genre de films “retour” par la formule :
« Depuis que t’écoutes du Rachmaninov, tu danses plus la gigue ? »
Le mythe de la réconciliation
Peut-être encore plus significatif que cette volonté de « dire la société », une partie du cinéma français a adopté depuis quelques années un modèle narratif récurrent : la rencontre entre des classes socialement incompatibles sur le papier, destinée à produire émotions, situations comiques et empathie.
Le principe est à peu près toujours le même : un personnage ou un groupe de personnages doté d’un certain nombre de propriétés sociales croise par hasard ou par nécessité un autre personnage ou groupe dont les caractéristiques diffèrent totalement. Leur écart de capital ; économique (richesse matérielle), social (capacité à mobiliser des ressources par le réseau relationnel) ou culturel (niveau de références artistiques ou culturelles considérées comme légitimes) va faire naître un antagonisme que le film va inlassablement s’employer à résoudre.
Le banlieusard racisé à peine sorti de prison et l’homme d’affaire propriétaire d’un hôtel particulier parisien (Intouchables, au cas où) ; le frère chef d’orchestre de renommée internationale face à son cadet cantinier et saxophoniste dans la fanfare locale (En fanfare) ou encore le fils d’ouvrier d’usine issu d’une famille nombreuse et la petite bourgeoise du centre-ville, bonne élève et fille d’un père aimant et protecteur dont – vous remarquerez – on ne connaîtra jamais le métier (L’Amour Ouf).
Ces scénarios reposent sur l’obsession des cinéastes pour une rencontre entre des individus que la société ne permettrait pas. Le postulat est le suivant : la société les empêche de se rencontrer, les amenant à penser qu’ils n’ont rien à voir alors qu’ils partagent, en réalité, bien plus que ce qu’ils ne pensent.
C’est une mécanique que l’on retrouve dans une partie des films d’Eric Toledano & Olivier Nakache ou encore chez Michel Leclerc (La Lutte des classes, Les Goûts et les Couleurs, Le Mélange des genres).
Cette incompatibilité sociologique va être exploitée au maximum pendant la durée du film, chaque différence de capital symbolique devenant prétexte à des situations dramatiques ou comiques. Comme le résument très bien ici Aurélie Pinto et Philippe Marty :
« Par l’attention à des personnages socialement différenciés, dont les propriétés sociales se dégagent grâce à la forme chorale et aux conventions de la comédie (la caricature en particulier), le film permet de comprendre ce que les jugements de goût doivent aux oppositions sociales (au sein des classes dominantes, des classes moyennes, entre les hommes et les femmes) ».
Dans la majorité de ces films, le scénario va finir par transcender ces écarts, en débouchant sur des réconciliations sociales fondées sur la seule force des valeurs ou de la “nature humaine” des personnages : d’abord prisonniers du déterminisme social, ces individus vont finalement trouver un terrain de rencontre qui les rapproche.
En substance, les individus partageant des valeurs humaines similaires devraient être proches, quelque soit leur origine sociale.
Essentialisme de la rencontre
Ce fameux « terrain de rencontre » est particulièrement problématique, car il repose souvent sur une vision essentialiste des structures et des luttes sociales. D’un côté, le personnage issu de la classe dominante apparaît comme enfermé dans son milieu, aveuglé par l’accumulation des richesses et imprégné de valeurs de mépris envers les classes populaires. De l’autre, le personnage populaire rejette celui qu’il perçoit comme « riche » et « déconnecté de la réalité », loin de la terre ou du quotidien difficile qu’il connaît. Cette essentialisation tend à figer les rôles : l’individu des classes populaires, malgré les épreuves liées à sa condition, en ressortirait finalement plus épanoui que le bourgeois, grâce à un capital présenté comme « sympathique » (Driss dans Intouchables), « authentique » (Christophe dans Connemara) ou encore « attaché à ses racines locales » (Jimmy dans En Fanfare).

Le scénario évolue alors logiquement vers la résolution suivante : puisque ces individus sont profondément « bons » mais aveuglés par les structures sociales, ils sont alors capables de se rapprocher, de s’entendre, voire de s’aimer.
Dans aucun des cas cette résolution n’est envisagée d’un point de vue politique ou en termes de lutte des classes. La réconciliation reste toujours individuelle et affective : Philippe finit par comprendre que Driss n’est pas que « le délinquant de cité » dans Intouchables grâce à leur amitié ; Thibaut et Jimmy transcendent leurs différences sociales grâce à la musique dans En fanfare ; et Clotaire et Jackie finissent par se réunir dans L’Amour ouf grâce au lien indéfectible de… (spoiler alert) l’amour.
Ce qui change ici, ce ne sont pas les rapports sociaux, mais les traits humains des personnages, qui se transforment grâce à l’individu providentiel.
Or, dans la réalité, les propriétés sociales d’un individu évoluent bel et bien au cours d’une vie : par l’école, le travail, les rencontres. C’est ce que Fabien Truong appelle “l’expérience du vacillement social”, le moment où les habitudes et les règles qui structurent normalement la vie d’un individu commencent à bouger, quand les repères qui guidaient ses comportements et ses choix perdent leur efficacité au contact d’un nouveau milieu.
Un rappel que l’instantané social capté par un film n’est jamais figé, mais au contraire traversé de possibles évolutions.
Un mythe qui dépolitise
Cette idée selon laquelle les conflits sociaux pourraient se résoudre uniquement par la rencontre et la connaissance de l’autre pose problème car elle dépolitise la question des luttes de classes. En affirmant que l’amitié ou la compréhension mutuelle suffisent à s’entendre et à s’aimer, ces scénarios évitent soigneusement de remettre en cause les structures inégalitaires – économiques, sociales, d’accès, discriminatoires – et se soustraient ainsi à toute critique sociale. En nous vendant le mythe de la rencontre comme ressort narratif, les réalisateur·ices offrent une forme d’espoir et de consolation : le monde pourrait être plus juste si nous n’étions pas enfermés dans nos milieux.
Mais surtout, il est nécessaire de rappeler que la domination économique et sociale exercée par les classes supérieures persiste structurellement, par le travail et la volonté de leurs représentant·es de la bourgeoisie, et que la barrière entre classes dominantes et classes laborieuses ne se brise jamais simplement par la « bonne volonté » des premiers.
Cette narrative de la rencontre des classes entretient ainsi une posture déterministe en son sein car elle ne questionne jamais la hiérarchie sociale ni les acquis de la bourgeoisie.
Les personnages victimes de domination – économique, raciale ou de genre – ne subissent jamais cette domination directement de la part des personnages issus des classes supérieures ; c’est donc une perspective de la classe dominante qui prévaut.
Preuve en est, les ressorts humoristiques de ces films sont souvent des codes propres à la bourgeoisie : le personnage de Driss (Omar Sy) assimilant Les Quatre Saisons de Vivaldi à la musique du répondeur des Assédics révèle une violence symbolique implicite derrière le gag comique.
En vendant le mythe de la sympathie ou de la gentillesse comme résolution, les films n’invitent jamais les classes populaires à contester, voire se révolter contre cette hiérarchie sociale et contribuent ainsi à perpétuer un un idéal républicain façonné par la classe bourgeoise.
On pourrait conclure trop rapidement que l’évitement de la critique sociale au profit des récits d’amour ou d’amitié ne concerne que le cinéma populaire, jugé plus consensuel et moins clivant (entendez vendeur). Pourtant, si le cinéma mainstream français présente cette rencontre de classe comme salutaire, le cinéma d’auteur n’échappe pas, lui non plus, à une certaine fétichisation des classes laborieuses. Convaincu de proposer une approche plus fine sociologiquement que les grosses productions, il aboutit souvent à des récits qui n’incitent pas davantage à la révolte sociale. En multipliant les manifestes et les brûlots sur le déterminisme, les cinéastes d’auteur enferment leurs personnages dans une seule dimension sociale, invitant le spectateur à éprouver la vie des classes populaires le temps d’une séance de cinéma.
De la verticalité à l’horizontalité des fractures
Plus largement, il faudrait interroger cette vision d’une société réduite à une fracture strictement verticale. Les écarts sociaux et la violence symbolique qu’ils engendrent ne se jouent pas uniquement entre des classes populaires et des élites dominantes. Cette vision entretient par ailleurs une dichotomie ancienne sur des classes populaires « gentilles et authentiques » qu’on opposerait aux classes dominantes parisiennes déconnectées de la réalité.
Un contre-exemple éclairant se trouve dans Le Goût des autres d’Agnès Jaoui, sorti en 2000. Le film met en scène la rencontre de deux personnages socialement incompatibles, Jean-Jacques Castella (interprété par Jean-Pierre Bacri), chef d’entreprise self-made rouennais au capital économique important et Clara Devaux (Anne Alvaro à l’écran), comédienne de théâtre, au mode de vie bohème et détentrice d’un haut capital culturel qui lui enseigne l’anglais. Le premier va tomber amoureux de la seconde et le film va explorer les écarts sociaux qui les séparent. Mais au lieu d’un fossé vertical entre « dominants » et « dominés », il propose une lecture plus horizontale : deux personnages qui, chacun à leur manière, exercent une forme de violence symbolique sur l’autre ; économique pour l’un, culturelle pour l’autre. Comme l’explique très justement Fabien Truong dans son article
« Des intentions sociologiques : ce que Le Goût des autres dit de la société… et de la sociologie » :
« Chacun est persuadé d’être socialement méprisé par l’autre ».
Contrairement à un récit figé, les trajectoires de Castella et Clara Devaux évoluent au fil de leur rencontre : l’un essaye avec maladresse de s’approprier les codes symboliques des milieux artistiques quand l’autre assouplit son mépris initial pour ce petit patron qu’elle jugeait “beauf”.
Pour autant le film ne cherche pas à nous vendre une résolution miracle par la rencontre, les trajectoires des deux personnages continueront à évoluer indépendamment de l’autre mais leur simple fréquentation aura suffit à nous faire éprouver l’expérience sociale. Ni dans une mythologie de la rencontre, ni dans une compassion condescendante pour les classes populaires, Le Goût des autres réussit à penser les structures sociales autrement au sein du cinéma français.
Contrechamps
Loin de moi la volonté d’apposer ici un regard emprunté sur des grands succès du cinéma français. J’ai moi-même apprécié certains des films cités, et il m’arrive de rire à des scènes qui reprennent le schéma narratif de l’incompatibilité sociale. Mais au-delà de ce plaisir immédiat, une question persiste : quel regard biaisé le cinéma propose-t-il sur la société ?
Et pourquoi les contre-exemples semblent-ils si rares ?
On peut penser, par exemple, à Pas son genre de Lucas Belvaux (2014), où Clément (Loïc Corbery), professeur de philosophie du Quartier latin convaincu “qu’une fois qu’on a passé le périphérique, on est à un siècle de Paris partout” est muté dans un lycée d’Arras. Il y rencontre Jennifer, jeune coiffeuse, mère célibataire et passionnée de karaoké, dont il tombe amoureux. Le film n’échappe certes pas à certains clichés classiques comme l’opposition de la sincérité heureuse du “prolo” à la mélancolie distante du bourgeois mais Pas son genre a au moins le mérite de faire d’Arras un véritable personnage de la narration et d’offrir à Jennifer une trajectoire qui lui permet, in fine, de conserver l’ascendant sur Clément.
Dans la même veine, Simple comme Sylvain de la réalisatrice montréalaise Monia Chokri met en scène une autre professeure de philosophie (figure décidément prisée par chez les scénaristes pour symboliser le bourgeois déconnecté) interprétée par Magalie Lépine-Blondeau, tombant amoureuse de l’entrepreneur chargé de rénover son chalet à la campagne (Pierre-Yves Cardinal). Si le film dépeint une société québécoise, et s’éloigne donc quelque peu de notre contexte, il a le mérite de poser une question essentielle : le désir sexuel peut-il – à lui-seul – transcender la condition sociale sur la durée ?
Pourtant, là encore, le récit n’échappe pas au stéréotype éculé du charpentier rustique, viril et très “bon coup”, en opposition à l’intellectuelle cérébrale plus puritaine.
Dans ces deux films, c’est une fois de plus la rencontre amoureuse qui demeure au centre du dispositif narratif, bien plus que toute évocation des luttes collectives susceptibles de transformer réellement les rapports de pouvoir, ces dernières restant, décidément, confinées aux marges du cinéma populaire français.
Le renouveau viendra peut-être en s’inspirant de cinémas venus d’outre-Atlantique ou des rives du Pacifique. Anora, récente Palme d’Or du cinéaste indépendant new-yorkais Sean Baker, abordait avec finesse l’incompatibilité sociale dans le rapport amoureux et la révolte intime que peut incarner un personnage socialement dominé. Quant à Parasite de Bong Joon-ho, il illustrait brillamment comment, à travers une série d’actes de sabotage, la classe exploitée coréenne peut renverser le rapport de force avec ses employeurs.
Mais pour cela, il faut d’abord s’affranchir du réalisme social.
Jules Adam Mendras