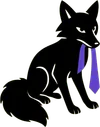Ces derniers mois, les plans de licenciements se multiplient en France : ils ont triplé en un an, selon la CGT. La liquidation judiciaire du groupe Brandt s’inscrit dans cette longue liste. Mais derrière ce désastre social se cache un scandale politique et industriel : ce géant de l’électroménager, qui s’éteint en provoquant le licenciement de plus de 700 salariés, avait été cédé il y a une dizaine d’années avec le soutien financier de l’État à un milliardaire condamné par la justice algérienne par la suite.
La fermeture de Brandt et de ses deux sites industriels, près d’Orléans et à Vendôme, marque la fin d’une histoire industrielle longue de plusieurs décennies. On l’a aujourd’hui oublié, mais ce groupe avait été nationalisé en 1982, avec Thomson, pour protéger la production d’électroménager en France. Il a ensuite été revendu à un groupe privé italien en 1992, puis au groupe espagnol Fagor en 2005 et enfin en 2014 à Cevital (contraction de « c’est vital »), premier groupe privé d’Algérie, présent avec 28 filiales dans l’agroalimentaire, l’industrie, la distribution, les médias et les services. Il emploie environ 18 000 salariés dans le monde et réalise plus de quatre milliards de dollars de chiffre d’affaires annuel, en croissance de 30% cette année. Son fondateur et principal actionnaire, Issad Rebrab, est l’homme le plus riche d’Algérie et figure parmi les grandes fortunes mondiales. Selon Forbes, la richesse de sa famille est estimée à 4,6 milliards de dollars. Difficile, dans ces conditions, de présenter la liquidation de Brandt comme une fatalité financière. C’est pourtant ce que font tous les médias. « La marque fondée en 1924 est confrontée à la concurrence de l’électroménager chinois, coréen ou turc, et à la crise du marché de l’immobilier, qui provoque celle de l’équipement des foyers. » , raconte Le Monde. « L’entreprise subit notamment les conséquences des temps difficiles vécus par le secteur du gros électroménager, lié à la crise de l’immobilier. », répète L’Express. Bien sûr, ces difficultés sont réelles, mais le groupe gigantesque qui détient Brandt avait tout à fait les moyens de préserver son activité, d’investir sur le long terme pour réorienter son activité, plutôt que de laisser tomber les salariés, qui y travaillaient parfois depuis des décennies. Raconter éternellement la liste des plans sociaux sans jamais s’interroger sur ceux qui en sont la source est malheureusement la pratique quasi systématique du traitement médiatique du capitalisme contemporain. Les licenciements apparaissent alors comme des fatalités tombées du ciel, qu’on déplore sur le mode de l’empathie pour les salariés concernés, tout en prétendant ne rien pouvoir faire pour eux.
Un propriétaire condamné par la justice algérienne
La responsabilité initiale de ce fiasco incombe à l’État français, et plus précisément au gouvernement Hollande, avec Arnaud Montebourg en figure de proue et son « redressement productif », un slogan qui ne dupait déjà plus grand monde en 2014, lorsqu’il choisit de faire confiance à Issad Rebrab et à son groupe Cevital pour reprendre Brandt, ce qui est présenté alors comme un succès politique. L’État accompagne l’opération par un prêt public de 47,5 millions d’euros, et Arnaud Montebourg se félicite publiquement de l’arrivée de cet actionnaire étranger, censé relancer durablement l’activité industrielle. Il affirme « rêver qu’il y ait plusieurs industriels algériens comme Issad Rebrab qui sauvent des entreprises en France ». Le profil de l’acquéreur apparaîtra pourtant, par la suite, pour le moins problématique. Suite à la chute de Bouteflika, on assista en Algérie à une judiciarisation importante des affaires de corruption, sous la pression du mouvement populaire de protestation Hirak. Dans ce contexte, Issad Rebrab est arrêté en avril 2019 pour des infractions bancaires, douanières et fiscales, notamment des transferts illégaux de capitaux. En décembre de la même année, il est condamné à 18 mois de prison, dont six mois ferme, assortis d’une lourde amende. Libéré début 2020 après environ huit mois de détention, il est ensuite interdit, en 2023, d’exercer toute fonction de direction dans des entreprises commerciales, tout en conservant, rassurez-vous, le droit d’en percevoir les dividendes.

Benoudina samirC’est pourtant cet homme d’affaires que l’État français a soutenu sans réserve lors de la reprise de Brandt. Plus récemment encore, le 16 janvier 2025, Arnaud Montebourg persistait à défendre ce choix en déclarant : « On revient ici dix ans après le sauvetage et on a trouvé un actionnaire qui a respecté ses engagements et qui a investi dans la recherche et le développement ». Ce n’est pas surprenant : les hommes politiques passent leurs temps à se faire berner par les grands patrons d’entreprise, qu’ils admirent.
Un projet coopératif empêché par l’État
Face à la liquidation judiciaire de Brandt, une autre voie existait pourtant. Les salariés de Brandt ont porté un projet de société coopérative et participative (SCOP), fondée sur une reprise partielle de l’activité. Ce projet promettait de sauver 295 emplois sur les 443 des deux sites de production, en s’appuyant sur un recentrage industriel et une gouvernance démocratique. Mais là où l’État avait su mobiliser 47,5 millions d’euros pour accompagner un groupe privé étranger en 2014, il s’est montré cette fois-ci bien plus frileux face au projet coopératif. Le soutien de l’État à la SCOP s’est limité à environ 5 millions d’euros, un montant dérisoire, jugé pourtant « considérable » par Libération. Il en manquait seulement 8 de plus pour boucler le projet. Le gouvernement a donc sciemment choisi de laisser mourir Brandt. « C’est un fleuron français qui s’éteint », ont déploré Roland Lescure et Sébastien Martin, les ministres de l’Économie et de l’Industrie, alors qu’ils en sont directement responsables. Cette différence de traitement est insupportable : lorsqu’il s’agit de soutenir le capital privé, l’argent public est mobilisé sans hésitation. Lorsqu’il s’agit d’un projet collectif, porté par les travailleurs eux-mêmes, l’engagement devient minimal. Cela rappelle la tentative de reprise de l’usine chimique Vencorex à Pont-de-Claix (Isère) par ses salariés, il y a quelques mois, sous forme de société coopérative d’intérêt collectif (SCIC). Le tribunal de commerce a jugé leur offre irrecevable, principalement en raison de l’absence de financements réunis à temps, le gouvernement macroniste ayant préféré laisser un groupe chinois racheter le site et détruire la majorité des emplois, même s’il reste encore quelques espoirs d’en sauver avec un nouveau projet.
Derrière les discours sur la réindustrialisation et la souveraineté économique, ce sont toujours les salariés qui paient le prix de choix politiques qui privilégient le capital au détriment du travail. L’État déverse chaque année 270 milliards d’euros sans aucune condition dans les comptes en banque des entreprises, et in fine de leurs actionnaires. Par contre, dès qu’il s’agit de sortir le chéquier pour quelques millions d’euros afin de permettre à des salariés de reprendre leur outil de travail, l’État disparaît soudainement. Il n’y a plus de volontarisme, plus de « souveraineté industrielle », plus de discours sur la valeur du travail. En revanche, quand il s’agit d’accompagner, de faciliter, voire de banaliser les licenciements économiques, les réformes se succèdent à un rythme soutenu. Ces dernières années, le droit du travail a été méthodiquement affaibli : assouplissement des plans de sauvegarde de l’emploi, réduction du contrôle administratif, raccourcissement des délais de recours aux prudhommes, plafonnement des indemnités en cas de licenciement illicite, affaiblissement du rôle des représentants du personnel. Tout est fait pour accélérer les fermetures de sites et sécuriser juridiquement les employeurs, y compris lorsque les entreprises sont bénéficiaires ou largement subventionnées par l’argent public.
Une commission d’enquête de l’Assemblée nationale, pourtant peu suspecte de gauchisme, dénonce dans un rapport, paru en juillet dernier, un rôle largement passif des pouvoirs publics, incapables d’anticiper les restructurations, de contrôler sérieusement les plans sociaux, ou de conditionner les aides publiques au maintien de l’emploi. Dans ce contexte, prétendre que les fermetures d’usines relèveraient d’une fatalité économique liée à la conjoncture est une manière d’évacuer toute responsabilité politique et patronale et ainsi de naturaliser des choix qui sont, en réalité, parfaitement délibérés. Face à cette logique, il ne reste qu’un levier : la mobilisation sociale. Les Portugais l’ont bien compris. Jeudi dernier, face à une nouvelle offensive contre les droits des travailleurs, une grève générale a paralysé le pays. Transports à l’arrêt, administrations bloquées, écoles fermées, entreprises en grève : pendant une journée, l’économie a été bloquée. Plus de trois millions de salariés ont participé à cet arrêt de travail, sur une population active totale de près de 5,5 millions de personnes. Si c’est possible là-bas, c’est possible ici : il suffit pour cela de retrouver l’esprit du 10 septembre et l’énergie qu’il nous avait insufflée.
Guillaume Etiévant
photo de couverture : Benjamin Lemaire – Virtuo Presse
Guillaume Étievant
Responsable éditorial