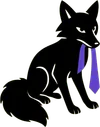Bad Bunny au Super Bowl :une brèche dans la vitrine impériale ?

En chantant en espagnol et en faisant exister une autre définition de l’Amérique au cœur du Super Bowl, Bad Bunny a déplacé, même légèrement, le centre symbolique de l’un des plus puissants dispositifs de soft power états-uniens. Une brèche réelle (modeste mais tangible) qui révèle à la fois ce que la pop mondiale peut encore ouvrir comme espaces de représentation, et jusqu’où le spectacle mainstream accepte de laisser passer le politique.
La mi-temps du Super Bowl (la grande finale annuelle du championnat de football américain) est tout sauf un simple entracte festif : c’est l’un des dispositifs de soft power les plus puissants produits par les États-Unis. Événement sportif le plus regardé du pays, suivi par des dizaines de millions de personnes et diffusé à l’échelle mondiale, le Super Bowl fonctionne comme une vitrine idéologique où se condensent spectacle, capitalisme et récit national. La mi-temps, en particulier, n’est pas un bonus mais un moment stratégique, pensé comme une scène impériale ultra-normalisée : sponsorisation extrême, mise en scène millimétrée, narration consensuelle, célébration d’une culture pop supposément universelle mais en réalité profondément marquée par les intérêts et l’imaginaire états-uniens. Historiquement, les artistes qui y sont invités répondent à des critères précis : être bankables, capables de rassembler plusieurs générations, et surtout suffisamment lisses pour ne pas troubler l’ordre du spectacle. Rien n’y est laissé au hasard, et certainement pas les corps, les langues ou les symboles qui s’y déploient. Insister là-dessus est essentiel : la mi-temps du Super Bowl n’est jamais neutre. Qui est invité à s’y produire, dans quelle langue elle ou il s’exprime, quelles références culturelles sont mobilisées ou effacées, tout cela dit quelque chose de ce que l’empire américain accepte de montrer de lui-même, et des limites très concrètes qu’il impose à toute forme de dissidence ou de décentrement culturel.
Bad Bunny n’est pas qu’une superstar de plus propulsée par les algorithmes de la pop mondiale : il est d’abord un artiste portoricain, issu d’un territoire colonisé par les États-Unis, devenu en quelques années l’une des figures centrales du reggaeton et du trap latino à l’échelle globale. Le fait qu’il chante majoritairement en espagnol, sans chercher à se plier aux exigences linguistiques du marché anglo-saxon, constitue déjà en soi un geste politique en particulier dans un moment où l’ICE, la milice fasciste de trump, traque les migrants mexicains et dans une industrie où l’anglais reste la langue dominante de la légitimité et du succès international. Dans ses textes, ses clips et ses performances, Bad Bunny travaille régulièrement des thématiques qui dépassent largement le cadre festif auquel le reggaeton est trop souvent réduit : les rapports de classe, les inégalités sociales, la précarité, mais aussi la remise en cause des masculinités virilistes et hégémoniques. Il affiche une esthétique fluide, joue avec les codes de genre, porte des vêtements et des attitudes qui brouillent les normes, et s’est positionné à plusieurs reprises en soutien aux luttes LGBTQ+, notamment face aux violences et aux discours réactionnaires en Amérique latine et à Porto Rico. Surtout, Bad Bunny reste profondément ancré dans les luttes portoricaines : dénonciation du colonialisme états-unien, critique de la dette imposée à l’île, colère face à l’exploitation économique et à l’abandon politique après les catastrophes naturelles. Il n’est donc pas un outsider, mais il n’est pas non plus une pop star états-unienne standardisée : sa trajectoire incarne une tension permanente entre intégration au marché global et affirmation d’une identité culturelle et politique qui résiste, au moins partiellement, à l’effacement.
Lors de sa prestation à la mi-temps, Bad Bunny a subtilement mais clairement inséré une idée simple (et pourtant radicale dans le cadre du Super Bowl) : l’Amérique ne se limite pas aux États-Unis. Plutôt que de se cantonner à une célébration folklorique, il a transformé le plateau en une sorte de plaidoyer symbolique en nommant, les uns après les autres, des pays d’Amérique latine, d’Amérique du Sud et du Nord, tout en affichant leurs drapeaux et en terminant avec un message sur l’unité pan-américaine, montrant l’Union comme une constellation de nations et de cultures, et non comme un monopole linguistique, géographique ou identitaire. Ce déplacement symbolique n’est pas anodin dans un contexte marqué par le retour offensif de Donald Trump sur le continent : enlèvement du président vénézuélien Nicolás Maduro, intensification des sanctions économiques contre Cuba, jusqu’à provoquer une pénurie de pétrole aux effets dévastateurs, et menaces ouvertes contre la Colombie. À ce moment précis, faire exister une Amérique plurielle sur la scène du Super Bowl revient aussi à rappeler que la domination états-unienne sur le continent ne se joue pas seulement par la culture, mais par la contrainte politique et économique. Ce geste est d’autant plus fort qu’il replace la notion d’“America” dans son sens continental originel, un terme que les États-Unis ont historiquement confisqué pour désigner exclusivement leur propre nation, invisibilisant ou folklorisant les peuples latino-américains dans le récit médiatique dominant. Dans le contexte du Super Bowl, un spectacle soigneusement calibré par l’industrie et par le soft-power états-unien, ce moment peut sembler minuscule à première vue : une énumération ici, des drapeaux là. Mais symboliquement, c’est énorme, parce que c’est une fissure dans le récit hégémonique états-unien. Et comme souvent face à des récits qui challengent le statu quo, la réaction n’a pas tardé à arriver en termes crus. Le président Donald Trump a qualifié publiquement le spectacle de “l’un des pires de tous les temps” et d’un “affront à la grandeur de l’Amérique”, critiquant la langue, la performance et le message qui, selon lui, ne reflètent pas les valeurs américaines traditionnelles. Sans être révolutionnaire, ce geste est une fissure dans le récit dominant, une ouverture par laquelle peuvent passer d’autres récits, d’autres voix et d’autres définitions de ce que signifie être Amérique aujourd’hui. Une fissure dans le “monolithe” médiatique, qui, même si elle est partielle, jette une lumière sur le fait que l’identité américaine est plurielle, traversée par des histoires, des langues et des géographies qui excèdent les frontières politiques des États-Unis. Certains ont même interprété la performance de Bad Bunny comme un acte d’art politique en soi. L’article de Jacobin souligne que son show ne se contentait pas de célébrer l’identité latino, mais enjoignait à une forme de défiance contre la xénophobie et le colonialisme états-unien, en utilisant la scène du Super Bowl non pas pour divertir seulement, mais pour mettre en lumière, par ses choix linguistiques et esthétiques, les réalités historiques de Porto Rico et la place des Latinos dans les Amériques.

L’engouement suscité par Bad Bunny lors de la mi-temps du Super Bowl ne peut pas se comprendre uniquement à l’aune du succès musical ou de la performance scénique. Il relève aussi d’un enjeu de représentation : pour des millions de personnes racisées, hispanophones, immigrées ou issues de diasporas latino-américaines particulièrement ciblées par la politique raciste de Trump et sa milice ICE, voir un artiste s’exprimer en espagnol, sans s’excuser ni se traduire, et affirmer une autre géographie du monde que celle imposée par les États-Unis, produit un effet de reconnaissance rare dans un espace médiatique aussi normé. Cette identification est d’autant plus forte que Bad Bunny incarne un moment générationnel précis : celui d’une pop mondialisée, massivement consommée, mais non-anglocentrée, qui refuse de passer par la validation culturelle états-unienne pour exister. À cela s’ajoute une fatigue très nette du modèle US classique du halftime show, souvent réduit à une nostalgie tiède, consensuelle et dépolitisée, où l’on recycle les mêmes figures rassurantes (de Bruce Springsteen à U2, de Coldplay à Maroon 5) pour ne froisser personne.. Mais surtout, cet engouement s’inscrit dans un contexte politique trumpiste durci, marqué par l’intensification des discours xénophobes, la criminalisation des migrant·es et les scandales répétés liés à l’ICE, devenue l’un des symboles les plus violents de la politique migratoire états-unienne. Dans ce climat, la visibilité d’un artiste latino affirmant sa langue, son héritage et une définition non exclusive de l’Amérique prend une charge affective et politique décuplée. L’enthousiasme autour de Bad Bunny n’est donc pas seulement musical : il est profondément politique, émotionnel, et lié à un besoin urgent de contre-récits face à un pouvoir qui s’acharne à invisibiliser, expulser et déshumaniser les non-blancs.
Mais même si la prestation de Bad Bunny au Super Bowl a ouvert une brèche, étroite je le concède, dans le récit médiatique dominant, il serait illusoire d’y voir autre chose qu’un déplacement limité. La pop mainstream demeure profondément intégrée au capitalisme global et aux compromis politiques qui l’accompagnent. De nombreux artistes célébrés comme “progressistes” ou “inclusifs” adoptent, dès que l’on sort du terrain sociétal consensuel, des positions bien plus problématiques, parfois alignées avec des logiques impérialistes ou favorables à des États-nations contestés. De plus, le show de la mi-temps du Super Bowl apportait son lot de surprises, réunissant une galerie de personnalités au-delà de l’unique tête d’affiche. Aux côtés de Bad Bunny sont apparus sur scène Lady Gaga et Ricky Martin pour des performances musicales, tandis que des caméos et danses ont impliqué des célébrités comme Pedro Pascal, Cardi B, Jessica Alba, Karol G et d’autres figures, transformant la scène en un véritable moment « all-star » et enrichissant la portée culturelle du spectacle. La présence de Lady Gaga a été largement discutée. Il faut rappeler que cette dernière s’etait produite à plusieurs reprises en Israël et avait tenu des propos dithyrambiques à son égard, sans jamais s’engager publiquement contre la politique génocidaire menée contre les Palestinien·nes. D’autres figures, pourtant engagées sur certaines causes sociales, se sont également abstenues de toute prise de position critique ou de rejoindre les appels internationaux au boycott des institutions culturelles israéliennes. Cette contradiction pose une question centrale : peut-on réellement dissocier l’icône pop, l’émancipation symbolique qu’elle incarne et les positions politiques concrètes qu’elle légitime, par ses choix ou par ses silences ? Dans le cas de Bad Bunny, il y a indéniablement quelque chose à saluer : sa présence au Super Bowl déplace légèrement le centre et rend visible une autre manière d’être latino dans l’espace pop global. Mais la machine absorbe vite ce qui ne la menace pas. La radicalité n’est tolérée qu’à condition de rester symbolique, sans jamais remettre en cause les structures de pouvoir qui produisent, financent et consomment ces spectacles.
La prestation de Bad Bunny au Super Bowl nous dit toutefois que même les machines culturelles les plus verrouillées ne sont jamais totalement étanches. Que des langues, des récits et des corps longtemps relégués à la marge peuvent, parfois, s’imposer au centre, fût-ce brièvement. Reste à savoir ce que ces brèches deviennent une fois le spectacle terminé : si elles se referment aussitôt, absorbées par le marché et le consensus, ou si elles laissent des traces durables, capables de nourrir d’autres formes de visibilité, moins symboliques et plus conflictuelles. La question n’est donc pas seulement ce que Bad Bunny a fait au Super Bowl, mais ce que celles et ceux qui regardaient choisiront d’en faire ensuite.
Farton Bink
Vidéaste et autrice