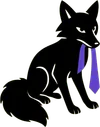« À pied d’oeuvre » : à pieds joints dans le tourisme social

Dans le dernier film de Valérie Donzelli, À pied d’oeuvre, sorti en salles le 4 février dernier, un photographe à succès, incarné par Bastien Bouillon, abandonne tout pour se consacrer à l’écriture et découvre la pauvreté. Cette adaptation du roman de Franck Courtès a suscité l’irritation de Rose Lamy, autrice d’Ascendant Beauf (Seuil, 2025). Explications.
“Va voir À pied d’œuvre, je t’en supplie et après on débriefe.” Alors que je me tiens éloignée du cinéma social français qui m’exaspère autant qu’il me déprime, j’ai cédé ce week-end à la tentation. Je me suis rendue au cinéma à pied : 40 minutes de marche rapide dans le froid bruxellois devraient me mettre dans de bonnes dispositions. Sur le chemin, je me dis que je vais payer 14 euros et quelques pour un film que je ne vais pas aimer. Je n’ai pas la carte illimité UGC, mais celle de Cinéville, le regroupement des cinémas indépendants alors que je préfère les comédies et les blockbusters. Pourquoi je continue à me mentir comme ça ? Petit pop-corn sucré, décharge de dopamine. Nous sommes une dizaine dans une petite salle, des têtes aux cheveux blancs qui dépassent des sièges rouges. C’est la séance de 16h15. “Ils doivent tous être français et retraités.”
C’est l’histoire d’un Parisien qui arrête son métier de photographe à succès pour se consacrer à l’écriture de son quatrième roman. Une histoire contemporaine et très située socialement, celle de la grande fatigue des cadres, du désenchantement des diplômés qui ont le luxe de refuser un système qui leur a pourtant assuré d’occuper une place dominante. Il constitue un exemple édifiant de ce que Rob Grams appelle le Bourgeois Gaze dans son essai du même nom paru cette année aux éditions Les Liens qui Libèrent. L’intrigue se déroule à Paris, dans un milieu intellectuel et littéraire qui se vit comme le centre du monde. On y retrouve les marqueurs classiques de l’idéologie bourgeoise présentée comme une norme universelle : croyance dans la méritocratie, mythe romantique de l’artiste maudit et solitaire, et obsession à parler des pauvres à leurs places.
Les trois premiers romans du personnage principal ont rencontré un succès d’estime et se sont vendus à cinq mille exemplaires chacun. Ce qui est bien, mais pas top pour son éditrice qui ne veut pas de son prochain manuscrit. On ne vit pas avec des droits d’auteur correspondant à cinq mille exemplaires vendus, et l’on vit même rarement de “sa plume” lorsqu’on demeure un petit ou moyen vendeur comme lui. Son avance sur droits ayant été consommée, s’il veut continuer à écrire, ce sera sans le soutien économique de sa maison d’édition.
Au lieu de renoncer, notre héros choisit de se consacrer entièrement à l’écriture de son prochain roman grâce à des petits boulots sur des applications de type Uber ou Yoojo, plateformes emblématiques de la dérégulation du travail et qui organisent la mise en concurrence permanente de travailleurs avec ou sans papiers, précaires, pour des tâches de transport, de manutention ou de services domestiques.

Dans cette nouvelle vie, Paul est morose, silencieux. Il arrache des haies sans gants de jardinage, ce qui relève presque de l’automutilation, ne parvient pas à faire l’amour quand l’occasion se présente. C’est à se demander si l’on ne confond pas ici la pauvreté avec la dépression sévère. Son corps s’abîme, il change d’apparence physique et son entourage s’inquiète. Le père de Paul s’indigne : “Je ne sais pas pourquoi tu t’entêtes à faire ces boulots de merde !”. Il répond : “C’est peut être le prix de ma liberté »
C’est la mode de faire mine de renoncer à de l’argent ou des opportunités par vertu morale ou ici, pour l’amour de l’art et de la liberté. La renonciation valorisée devient un capital moral qu’on pourra ensuite monnayer contre une bonne réputation, des interviews, des contrats d’édition, ou adaptations cinématographiques.
« Bifurquer permet de se construire un itinéraire d’exception qui augmente notre valeur sur tous les marchés de l’emploi, du couple mais aussi de la coloc ou de l’amitié. Surtout lorsqu’on est doué pour faire du storytelling. C’est sûr que rester pendant quarante ans dans la même boîte, mariée au même conjoint en vivant dans la même ville, c’est moins prometteur pour votre storytelling », écrit Anne Humbert dans son essai Tout plaquer
L’idée que l’on peut refuser le confort matériel pour la liberté, c’est ce que j’avais nommé dans Ascendant Beauf le blanchiment de capitaux.
“Ainsi, il y a ceux qui décident de quitter un travail dans la finance pour se lancer dans la céramique en touchant le RSA, ou d’autres qui annoncent bifurquer à la remise des diplômes de leur école d’élite AgroParisTech : « Nous avons décidé de chercher d’autres voies, de refuser de servir ce système et de construire nos propres chemins. » Les plus vertueux·euses – ou les plus cyniques – refusent même un héritage, ou le reversent à une association, pensant ainsi pouvoir renoncer à leurs capitaux de classe. Mais soyons réalistes : si l’intention est bonne, ces personnes ne perdent rien, même quand elles font mine de renoncer. Elles sont programmées pour finir la course en tête. Il y a un autre capital à gagner en sacrifiant un peu de patrimoine économique ou de rémunération. Ces nouveaux choix, ces faux choix, deviennent des capitaux méritocratiques, moraux, qu’on échangera contre du pouvoir même symbolique plus tard, contre des interviews, des contrats d’édition ou des abonnements sur les réseaux sociaux. C’est une opération de blanchiment, le recyclage d’un privilège hérité auquel on donne l’apparence d’un mérite obtenu par un choix de rupture.”
Ainsi, on voudrait nous faire croire que Paul se sacrifie pour l’art, mais il ne tombe pas. Il descend en rappel vers la précarité, solidement harnaché à ses capitaux. Son harnais de sécurité est économique, d’abord : quelques centaines d’euros mensuels de droits d’auteur, fruits d’une carrière antérieure. Mais il est surtout culturel et social. Il a de l’érudition, un parcours professionnel qui lui offre des possibilités : il pourrait être professeur de photographie à temps partiel, comme le suggère son père. Serveur. Surveillant. Son apparence est un capital supplémentaire : il est blanc et rassure les clients qui lui disent qu’il n’a pas le profil habituel. Il dispose d’un réseau mobilisable à tout moment. Son ex-femme, ses enfants. Une amie de la famille lui prête un studio, il emprunte la voiture de son père pour devenir chauffeur privé. S’il est déficitaire temporaire de capitaux financiers, il n’est pas pauvre, car il peut à tout moment décider pour que cette “résidence d’écriture” s’arrête.
Ces hommes précaires avec lesquels il s’est mis en concurrence sur ces applications, diminuant ainsi leurs conditions matérielles d’existence, où sont-ils aujourd’hui ? Ont-ils, eux aussi, gagné un récit à monnayer ? Il a collecté des scènes de leurs vies pour les ramener dans son milieu social bourgeois ou littéraire, où il est bien prévu qu’il rentre. Cette matière première retravaillée, stylisée, n’est rendue audible que parce qu’elle est énoncée par un homme socialement légitime. Ce film, cette trame narrative, c’est sûrement le nouveau variant du mythe du transfuge qui a inondé les scénarios et le monde de l’édition ces dernières années et auquel plus personne ne croit. Avant, on sélectionnait de “bons pauvres”, ceux qui s’en étaient sortis pour nous raconter comment les choses se passaient chez les péquenauds. La bourgeoisie vibrait à la lecture de ces récits exotiques sur les sans dents, et se félicitait d’accueillir en son sein ces rescapés de classe. Preuve de sa générosité et de son ouverture d’esprit.
Désormais, elle se relève les manches, se salit les mains et part elle-même en tourisme social pour rapporter de bonnes histoires. Ce long métrage raconte l’ambivalence d’une classe sociale déchirée entre un mépris viscéral pour les pauvres et son devoir moral de combattre les inégalités sociales. Il croit dénoncer les riches clients complaisants qui exploitent les travailleurs pauvres, sans réaliser que “jouer aux pauvres” participe à la domination en brouillant les lignes de fracture de classe. Même si elle se donne bonne conscience, la bourgeoisie qui produit ces œuvres, est le groupe social ennemi des travailleurs pauvres. Et pendant qu’elle prend toute la place, ceux qui vivent réellement la pauvreté n’ont ni récit à monnayer ni public pour les écouter. Les féministes ont coutume de dire aux hommes “Ne nous libérez pas, on s’en charge”. J’ai envie de dire à la bourgeoisie “Ne nous racontez pas, on s’en occupe”.
Rose Lamy